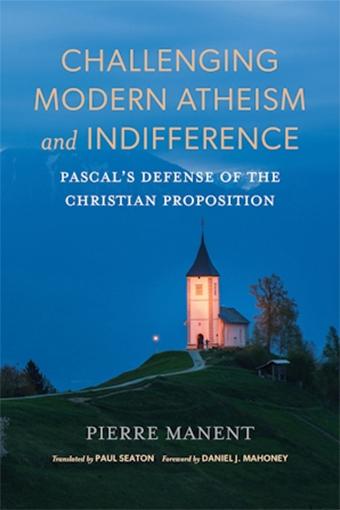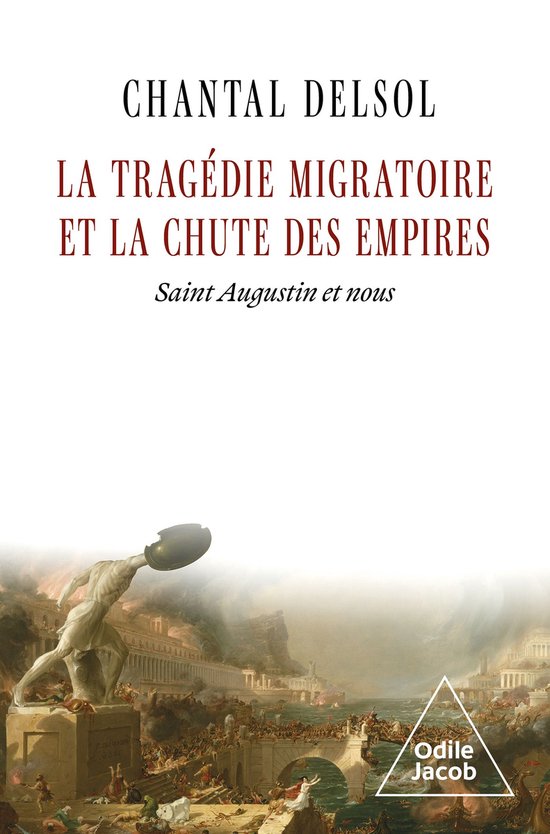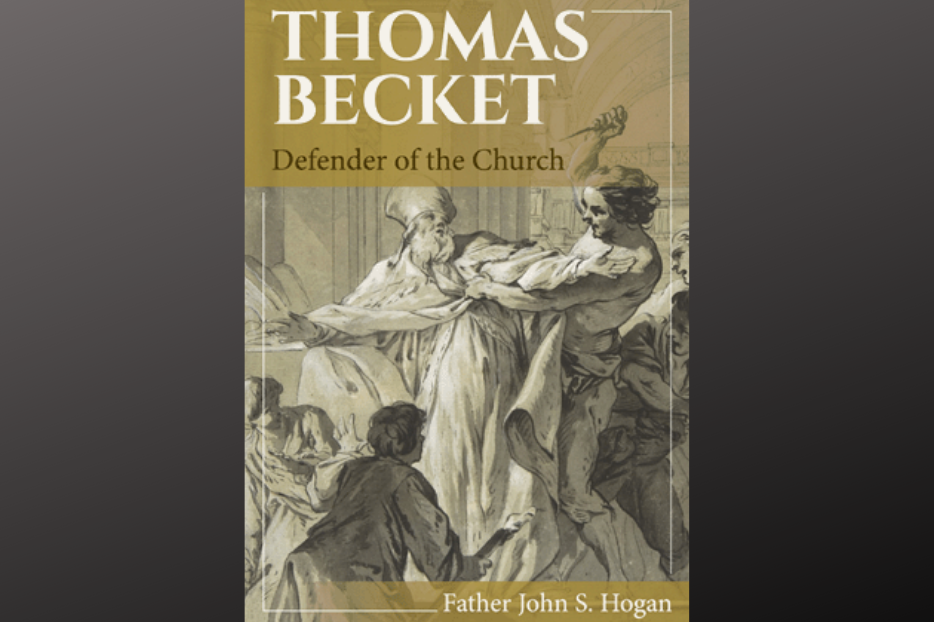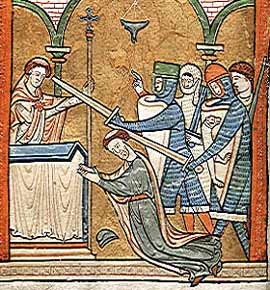De sur le CWR :
Le regretté George Pell et ses ennemis, deuxième partie
Le défunt cardinal Pell a été vilipendé par des médias australiens anti-catholiques et il se pourrait qu'il ait été piégé par des employés avides du Vatican pour l'éliminer.
En 2014, le pape François, nouvellement élu, décida d'assainir les finances du Vatican. Il nomma le cardinal australien George Pell (1941-2023) premier préfet de son nouveau Secrétariat pour l'Économie. Pell était perçu comme un cardinal pragmatique, rigoureux et intelligent, capable de mobiliser ses pairs et de les inciter à redresser la situation.
Pell a ordonné des audits, établi des directives et lancé une enquête sur les finances des différents services du Vatican. On pourrait croire qu'une simple tentative d'instaurer la transparence dans les finances du Vatican ne susciterait aucune controverse. Ce serait une erreur.
Alors même que Pell commençait à mettre au jour des problèmes, une série d'accusations d'abus sexuels sur mineurs ont été portées contre lui en Australie en 2017. Alors qu'il aurait pu rester à Rome et éviter le procès comme d'autres l'ont fait, il a choisi de retourner dans son pays natal pour laver son nom.
La police de Victoria n'a apparemment ménagé aucune dépense pour tenter de dénicher des informations compromettantes sur George Pell — et lui seul — remontant à 2013. Elle a présenté des dizaines de témoins devant le tribunal en 2018, mais ces prétendus témoins n'ont pu fournir que des accusations et des témoignages flous, ce qui explique pourquoi le jury n'a pas pu parvenir à un verdict.
Leur indécision n'est pas surprenante, car les deux accusations les plus graves portées contre Pell paraissent ridicules à quiconque assiste régulièrement à la messe catholique. Deux garçons ont affirmé que Pell s'était exhibé devant eux après la messe, dans la sacristie de la cathédrale. Mais comment Pell aurait-il pu raisonnablement faire cela, alors qu'il portait ses habits liturgiques ? Pourquoi ne se serait-il pas trouvé à l'extérieur de l'église, comme tous les autres prêtres après la messe du dimanche (y compris Pell lui-même), en train de discuter avec ses paroissiens ? Où étaient les autres prêtres qui accompagnent habituellement l'évêque à la messe ? Et n'aurait-il pas été incroyablement stupide pour un prêtre de s'exhiber dans un lieu public comme la sacristie, où un paroissien pouvait arriver à tout moment pour demander la bénédiction d'un nouveau chapelet ?
Malgré le caractère absurde des accusations, Pell a été reconnu coupable lors d'un nouveau procès. Condamné à la prison en 2019, il y a passé 404 jours, presque entièrement à l'isolement, privé même du droit de célébrer la messe.
Mais Pell a fait appel de cette décision devant la Haute Cour d'Australie, et celle-ci a cassé son jugement en 2020. Après sa libération, il a publié ses journaux de prison pour financer les frais de sa défense.
Pell souffrait de problèmes cardiaques depuis 2010, en partie à cause de son travail épuisant et de ses nombreux déplacements. Bien que ces problèmes cardiaques rendaient toute intervention chirurgicale dangereuse, il décida de se faire poser une deuxième prothèse de hanche en raison de douleurs constantes. Il craignait également que la santé déclinante du pape François n'entraîne prochainement un nouveau conclave et « était déterminé à faire entendre sa voix » ¹ alors que les cardinaux se réunissaient en amont. Le décès de Pell fut inattendu car il semblait se porter bien immédiatement après l'opération, mais sa mort fut attribuée à son état cardiaque.
Avec le recul, il est aisé de constater qu'une série de coïncidences fascinantes s'est produite durant le mandat de Pell comme préfet du Secrétariat à l'Économie. Au moment même où il enquêtait sur des irrégularités financières au Vatican, il fut contraint de quitter Rome et de comparaître devant un tribunal pour des accusations si fragiles qu'elles en sont à peine crédibles. Durant cette même période, plusieurs personnes au sein du Secrétariat d'État, dont un cardinal, furent impliquées dans un système financier de détournement de fonds et d'extorsion, ce qui entraîna leur condamnation (bien qu'ils aient fait appel) en 2023. Après sa libération, Pell découvrit qu'en 2019 – alors qu'il était lui-même en procès – une personne au Vatican avait transféré 2 millions de dollars à un individu en Australie, apparemment sur ordre de ce même cardinal. En 2021, Pell demanda publiquement au cardinal de s'expliquer sur l'identité du destinataire de ces 2 millions de dollars et sur les raisons de ce transfert. Le monde attend toujours une réponse convaincante.
Il est clair que le cardinal George Pell avait de nombreux ennemis. Il a été diffamé par des médias australiens anti-catholiques et il est possible qu'il ait été piégé par des employés du Vatican avides de pouvoir pour l'éliminer. Au fil des ans, des manifestants anti-catholiques (dont certains offensés par ses propos sur l'homosexualité) ont organisé des piquets de grève devant ses messes, l'ont menacé et ont tagué sa cathédrale d'attaques personnelles.
Nous pouvons éprouver plus de sympathie pour un groupe de personnes qui se sont publiquement opposées à Pell. Les Australiens victimes d'abus sexuels (ou leurs proches) ont peut-être cru, à tort, que la condamnation de Pell leur permettrait de se venger de leurs agresseurs. Bien que les abus sexuels soient notoirement difficiles à prouver de manière concluante, des affaires récentes très médiatisées ont montré que lorsqu'une victime confronte publiquement les véritables agresseurs, d'autres victimes se sentent souvent libres de témoigner également, révélant ainsi l'existence d'un comportement criminel récurrent, et non d'un incident isolé ou non vérifiable. Aucune autre victime ne s'est manifestée pendant ou après les procès publics intentés à George Pell.
Mais Dieu connaît la vérité sur George Pell, non seulement sur sa culpabilité ou son innocence concernant ces accusations, mais aussi sur le fait qu'il soit désormais un saint au Ciel.
On pourrait certes contester la sainteté de Pell, car il se montrait parfois brusque lorsqu'il était attaqué verbalement et s'exprimait avec une franchise qui pouvait heurter la sensibilité de beaucoup. Mais il était aussi disposé à s'excuser, à rectifier ses propos et à reconnaître ses erreurs. Il n'a jamais manifesté d'animosité envers ceux qui l'avaient accusé et condamné à tort, allant même jusqu'à plaisanter avec ses amis en disant qu'être en prison, c'était comme être « en retraite spirituelle » .
Au lieu de cela, il a obéi au commandement de notre Seigneur : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ses journaux de prison évoquent également les réflexions d'un prêtre catholique lors d'un moment de solitude paisible avec Jésus-Christ, et non celles d'un homme âgé, coupable et confiné à l'isolement, qui sait qu'il finira probablement ses jours en prison. Cela aurait pu arriver à Pell.
Si certains saints ont été facilement identifiés comme des hommes et des femmes saints de leur vivant — seuls quelques athées étaient perplexes quant à la sainteté de Mère Teresa de Calcutta, par exemple —, ce n'est pas toujours le cas.
À la mort de saint Jean de la Croix en 1591, deux prêtres répandirent de diffamation à son sujet à travers l'Espagne, et malheureusement, on les crut. Un siècle plus tard, leurs mensonges furent démentis, ses écrits examinés en détail, des miracles se produisirent par son intercession, et Jean fut canonisé. On pourrait raconter des histoires similaires concernant saint Gérard Majella, la bienheureuse Anne Catherine Emmerich et d'autres saints, ainsi que de nombreux martyrs.
En mars 2025, un garçon de dix-huit mois est tombé dans une piscine et a cessé de respirer pendant cinquante-deux minutes. Il aurait dû mourir ou, à tout le moins, subir de graves lésions cérébrales, cardiaques ou pulmonaires. Ses parents, qui avaient rencontré le cardinal Pell en 2021, ont prié sans relâche pour son intercession afin de sauver leur enfant pendant cette période où il était, littéralement, en danger de mort. Contre toute attente, le bébé a survécu, a été débranché de l'assistance respiratoire et n'a présenté aucune séquelle.
Est-ce un miracle ? Dieu accordera-t-il des grâces surnaturelles à ceux qui implorent l’intercession de George Pell, ne serait-ce que pour nous convaincre de l’injustice subie par ce prêtre catholique fidèle et dévoué ? L’avenir nous le dira.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons espérer que ceux qui considéraient George Pell comme leur ennemi réfléchiront à leurs propres erreurs passées, demanderont pardon et prieront pour ceux qui leur ont fait du mal. Car c’est précisément ce que le cardinal George Pell, à l’exemple de Jésus-Christ, a fait pour eux.
Notes de fin :
1 Tess Livingstone, George Cardinal Pell : Pax Invictis (San Francisco : Ignatius Press, 2024), 27.
2 Ibid., 465.
3 Matthieu 5:44