Un téléfilm sur Pascalina Lehnert, secrétaire du pape Pacelli, est présenté sur ZENIT.org :
Lumières sur le pontificat (Giovanni Preziosi - Traduction d'Isabelle Cousturié)
« Sœur Pascalina. Au cœur de la foi » : ce téléfilm consacré à sœur Pascalina Lehnert, secrétaire, bavaroise, de Pie XII, a été diffusé le dimanche de Pâques en Italie, attirant plus de 4 millions de téléspectateurs. Très documenté du point de vue historique, le film révèle des détails importants sur Pie XII, sa vie et rôle durant la seconde guerre mondiale.
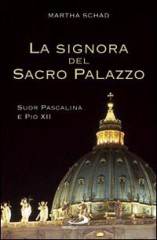 Le film, produit par la télévision publique allemande ARD, en collaboration avec la chaine italienne RAI et la Maison de production Betafilm, s’inspire de la biographie écrite par l’historienne allemande Martha Schad, « la Dame du sacré palais », retraçant la vie de Pascalina Lehnert qui a été, pendant 40 ans, la proche et fidèle collaboratrice de Pie XII, avant et après son élection.
Le film, produit par la télévision publique allemande ARD, en collaboration avec la chaine italienne RAI et la Maison de production Betafilm, s’inspire de la biographie écrite par l’historienne allemande Martha Schad, « la Dame du sacré palais », retraçant la vie de Pascalina Lehnert qui a été, pendant 40 ans, la proche et fidèle collaboratrice de Pie XII, avant et après son élection.
Sœur Pascalina, née Joséphine Lehnert le 25 août 1894 a Ebersberg, en Bavière, de Georg, un fonctionnaire des postes de religion protestante, et de Marie Dierl, catholique, a vite eu le désir de devenir religieuse mais son père, fortement opposé à cette idée, s’acharnait à entraver sa vocation, n’hésitant parfois pas à utiliser des méthodes plutôt brusques pour l’en dissuader.
 Le mardi 28 février dernier, Mgr Piotr Mazurkiewicz (1), secrétaire général de la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne)(2), était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques liégeois et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de la communication que Mgr Mazurkiewicz a prononcée, à titre personnel, portait sur la laïcité dans l’Union européenne (3). Ce thème s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres « Neutralité ou pluralisme : dialogue entre religions et philosophies non confessionnelles ». Voici la transcription officieuse de l’exposé réalisée par un auditeur (les intertitres sont de sa plume) :
Le mardi 28 février dernier, Mgr Piotr Mazurkiewicz (1), secrétaire général de la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne)(2), était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques liégeois et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de la communication que Mgr Mazurkiewicz a prononcée, à titre personnel, portait sur la laïcité dans l’Union européenne (3). Ce thème s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres « Neutralité ou pluralisme : dialogue entre religions et philosophies non confessionnelles ». Voici la transcription officieuse de l’exposé réalisée par un auditeur (les intertitres sont de sa plume) : Victor Scribe présente le "petit traité des grandes questions historiques" :
Victor Scribe présente le "petit traité des grandes questions historiques" :
 On la fête aujourd'hui : Waudru est issue d'une famille de la haute aristocratie franque. Son père, Walbert ou Waubert, semble avoir été maire du palais de Clotaire II et sa mère,
On la fête aujourd'hui : Waudru est issue d'une famille de la haute aristocratie franque. Son père, Walbert ou Waubert, semble avoir été maire du palais de Clotaire II et sa mère,