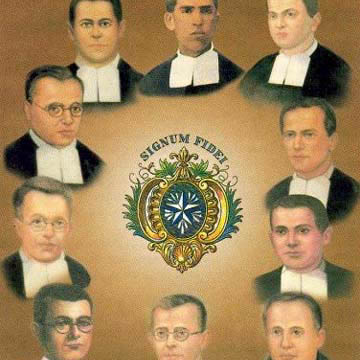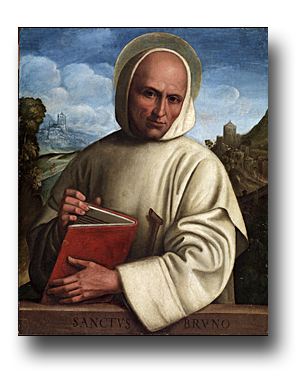Le dialogue entre le grand rabbin de Rome Riccardo Di Segni (photo) et le journaliste Juif « dissident » Gad Lerner – vient de faire l’objet d’un livre récemment publié en Italie sous le titre « Ebrei in guerra » — et qui consacre un chapitre entier consacré aux relations entre l’Église de Rome et Israël. Avec des observations très intéressantes, d’autant plus après le oui du Hamas à la libération de tous les otages et après les déclarations du Secrétaire d'État du Vatican Pietro Parolin à l'Osservatore Romano, à l'occasion du deuxième anniversaire du massacre du 7 octobre.
Di Segni précise d’emblée que « la condition juive est complexe, la religion et la nation sont étroitement liées ». Et ce sont précisément les réponses de l’Église catholique à cette complexité, avec ses hésitations et ses contradictions, qui ont rythmé ces les hauts et les bas des relations entre les deux religions ces dernières décennies.
D’après le grand rabbin de Rome, ce dialogue a atteint son apogée avec Benoît XVI qui « a écrit des choses très importantes et positives sur le judaïsme ».
Benoît XVI a su aller au cœur de l’incompréhension entre ces deux confessions. « Alors qu’aux yeux des chrétiens, il est incompréhensible que les Juifs ne croient pas dans le Christ, pour les Juifs en revanche il paraît incompréhensible que les chrétiens y croient. Cette incompréhension mutuelle peut être une source d’agressivité ou à des impasses dans la communication, on peut en revanche l’éviter en renvoyant cette question à la fin des temps et en réfléchissant plutôt à ce qu’on peut faire ensemble aujourd’hui ». Et c’est bien cet « aspect pratique du dialogue qui qui a prévalu en substance avec Benoît XVI, malgré sa fermeté de principe ».
Et c’est bien ce qui s’est passé avec Benoît XVI. Dans le premier des trois volumes de son « Jésus de Nazareth », il commente le Discours sur la Montagne en attribuant à ce qu’avait écrit sur le sujet le rabbin américain Jacob Neusner, qui s’était imaginé vivre à l’époque de Jésus et l’écouter, le mérite de lui avoir « ouvert les yeux sur la grandeur des paroles de Jésus et sur le choix devant lequel nous met l’Évangile », pour « la franchise et le respect » avec lequel ce Juif croyant disait ne pas pouvoir suivre Jésus.
Et s’il fallait démontrer encore une fois combien Benoît XVI allait au cœur des deux confessions, on peut citer son rejet de l’expression « frères aînés » que tant de papes, à commencer par Jean XXIII jusqu’au pape François, ont utilisée pour s’adresser aux Juifs. Pour lui, cette expression « n’est pas très appréciée de ces derniers, d’autant que dans la tradition juive, le ‘frère aîné’, c’est-à-dire Ésaü, est également le frère abject ». À ses yeux, les Juifs sont plutôt « nos ‘pères dans la foi’ », selon une expression qui « décrit plus clairement notre lien avec eux ».
Mais avec François, bien des choses ont changé, et pour le pire, selon le rabbin Di Segni.
Le livre de Lerner fait allusion à un signal prémonitoire. Il s’agit de la visite de François au Grand Temple de Rome, le 17 janvier 2016, au cours de laquelle le pape « a soigneusement éviter de citer l’État d’Israël » et donc « le lien particulier avec la terre » qui caractérise le peuple Juif.
D’ailleurs, à l’époque, le grand rabbin de Rome n’avait pas caché son mécontentement face à ce silence : « Bien des signes – avait-il dit – rappellent le rapport essentiel et religieux que nous entretenons avec la terre qui nous a été promise. Comprendre ce lien ne devrait pas poser de difficulté pour ceux qui respectent la Bible, et pourtant c’est encore le cas ».
Et en effet, en ce qui concerne l’existence de l’État d’Israël, le Saint-Siège a toujours adopté « une perspective qui n’est pas religieuse en soi mais qui repose sur les principes communs du droit international », comme l’a expliqué le jésuite Juif et citoyen israélien David Neuhaus, grand expert du dialogue judéo-chrétien dans « La Civiltà Cattolica » du 16 mai 2024.
Il est évident que l’on touche là un point particulièrement sensible des relations entre l’Église catholique et Israël, et le rabbin Di Segni n’a pas manqué de le souligner dans son livre :
Les chrétiens et les juifs, dit-il, ont en commun la Bible hébraïque, mais « les interprétations peuvent être radicalement différentes. Dès les pages initiales du premier livre, la Genèse, le thème de la promesse de la terre aux descendants des patriarches est central, à tout le moins du point de vue juif ». Mais « pour les chrétiens, le thème central est autre, c’est l’annonce du Messie ». Pour pendant des siècles, leur conviction a été que les Juifs n’auraient pas pu retourner dans leur terre sans reconnaître d’abord en tant que Messie ce Jésus qu’ils avaient tué.
Mais aujourd’hui « cette vieille réponse ne fonctionne plus », poursuit Di Segni, « un croyant catholique devrait se poser un problème d’interprétation. Le pape Benoit XVI avait bien dit quelque chose en ce sens, même si ce n’est pas aussi explicite du point de vue doctrinal ».
Mais avec François ? Le jugement du rabbin Di Segni sur l’avant-dernier pape est très critique.
Concernant le conflit à Gaza, « le pape a très clairement choisi son camp au lendemain du 7 octobre, quand il avait d’emblée qualifié d’acte terroriste tant l’action du Hamas que la réponse redoutée du côté israélien, quelle qu’elle puisse être. »
Ce constat repose notamment sur l’audience à égalité que le pape avait donnée le 22 novembre suivant à des familles d’otages juifs détenus par le Hamas et à des parents de terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, à grand renfort de déclarations que la guerre menée par Israël était elle aussi « du terrorisme », et même « un génocide ».
Après le 7 octobre, déclare Di Segni, « on aurait pu s’attendre à un peu d’empathie et de solidarité de la part de ses amis ». Mais au contraire, « nous avons eu droit à une équidistance glaciale, pour ne pas dire à un alignement avec l’autre camp […], jusqu’à faire l’éloge du gouvernement iranien », comme ce fut effectivement le cas après une audience du pape avec Ebrahim Raïssi, si l’on s’en tient au compte-rendu publié par le président iranien de l’époque.
Quant aux racines de cette attitude de Francois, elles sont à chercher, selon le grand rabbin de Rome, dans « deux raisons particulières » : la première étant « le souci du sort des chrétiens dans les pays arabes », avec les « compromis avec les régimes islamistes » qui s’en sont suivis ; la seconde étant « la provenance d’origine du pape François, davantage tiers-mondiste qu’occidentale ».
Que la provenance géographique de Jorge Maria Bergoglio ait eu une influence sur sa vision géopolitique est une thèse également partagée et soutenue par David Neuhaus, dans l’article de « La Civiltà Cattolica » que nous avons cité.
Il n’est donc pas étonnant que François ait fait l’objet de nombreuses critiques publiques de la part de représentants du rabbinat et du judaïsme dans le monde entier. Sans que jamais ce pape fasse mine de les prendre en compte.
En effet, on a beaucoup parlé des silences de François envers le judaïsme.
Et dernièrement encore avec sa décision improvisée d’expédier de quelques brèves salutations l’audience accordée le 6 novembre 2023 à une délégation des rabbins d’Europe, sans même prendre la peine de lire le discours préparé pour l’occasion.
Sans oublier le précédent du 9 mai 2019 concernant son habitude de critiquer ses opposants en les traitant de « pharisiens », dans le sens d’hypocrites, de cupides, de légalistes et de vaniteux.
À l’occasion d’un entretien avec le pape François, les rabbins Di Segni et Giuseppe Laras l’avaient prié de cesser d’employer le terme de « pharisien » de manière offensante. Et le cardinal Kurt Koch, responsable des relations avec le judaïsme, avait tenté de remédier à la situation en préparant pour le pape un discours à lire devant un colloque international à l’Université pontificale grégorienne qui était justement consacré au thème « Jésus et les pharisiens ».
Ce discours mettait en lumière que dans le Nouveau Testament, il n’y a pas que des controverses entre Jésus et les pharisiens. On y fait également l’éloge de deux pharisiens comme Gamaliel et Nicodème. Jésus lui-même déclare que certains pharisiens sont « proches du règne des cieux » parce qu’ils mettent en avant le commandement de l’amour de Dieu et du prochain. Sans parler de la fierté avec laquelle l’apôtre Paul se décrit comme pharisien. Tout le contraire du stéréotype négatif souvent utilisé par le pape.
Mais de manière incompréhensible, François avait renoncé à lire ce discours, se bornant à saluer les participants.
Quant à l’accusation de « génocide » adressée à Israël de la part du pape François, il y a bien eu plusieurs tentatives de la part de la Secrétairerie d’État et de la salle de presse du Vatican d’en atténuer les effets, sans résultat.
Avec le nouveau pape Léon XIV, le chapitre sur Israël reste encore à aborder. Mais à tout le moins, jusqu’à présent, il le fait avec davantage de clarté, en adoptant des positions distinctes et parfois éloignées, comme on a pu le voir après les bombes sur l’église catholique de Gaza et à l’issue de son entretien tendu avec le président israélien Isaac Herzog, confirmé par des communiqués respectifs très dissonants. Au cours de son interview avec Elise Ann Allen dans le livre sorti le 18 septembre, il est très peu question d’Israël, mis à part cette mise au point sur le « génocide » :
« Officiellement, le Saint-Siège considère qu’on ne peut faire aucune déclaration sur le sujet, pour le moment. Il existe une définition très technique de ce que pourrait être le génocide, mais de plus en plus de personnes soulèvent cette question, dont deux associations israéliennes pour les droits de l’homme ».
— — —
Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l'hebdomadaire L'Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur diakonos.be en langue française.
Ainsi que l'index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.