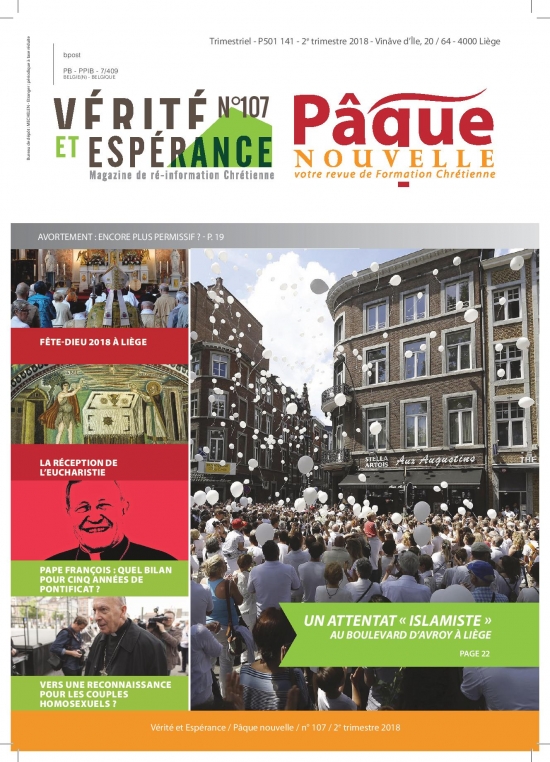D'Anne Bernet sur le site de l'Homme Nouveau :
Énigmes historiques ou machines de guerre ?

« Les grandes énigmes historiques », filon longtemps inépuisable - le recours aux analyses d’ADN a apporté récemment des réponses définitives à quelques-unes des plus excitantes …- de l’édition, auront eu l’incontestable mérite, par les efforts d’intelligence, de recherches, de logique qu’elles exigeaient, de susciter des vocations d’historiens passionnés. Sont-elles, cependant, en leur genèse, aussi innocentes qu’il y parait ?
La parution d’un recueil grand public, mais signé des meilleurs spécialistes et enrichi de fortes bibliographies, Les énigmes de l’histoire de France, (Perrin. 400 p. 21 €.) supervisé par Jean-Christian Petitfils, invite, en le lisant, à se poser des questions.
Exceptée le débat, qui restera sans doute ouvert, de la localisation du site d’Alésia et des raisons de la défaite de Vercingétorix, auquel le terrain comme le nombre de combattants semblaient promettre la victoire, des faits plus récents, telle l’arrestation de Jean Moulin à Caluire ou le voyage à Baden-Baden de De Gaulle en 1968, tous ces récits ou presque, en effet, concernent des affaires dont les contemporains parfois, les politiques, les idéologues et l’historiographie à leur service toujours, se servirent pour porter des coups violents à l’Église, au catholicisme, à la monarchie.
Il y a là, à n’en pas douter, plus qu’une coïncidence.
Prenons les Templiers. Pour les médiévistes sérieux, tout est clair : Philippe le Bel trouve son intérêt à abattre la puissance financière plus encore que militaire de l’Ordre du Temple, inutile depuis la perte du royaume latin de Jérusalem. La seule vraie question, toujours disputée, est de savoir qui a lancé les premières accusations contre l’Ordre, et si le roi y a cru ou non, selon que chacun le voit cynique et pragmatique, ou pieux et naïf. Les textes médiévaux concernant le Temple, de mieux en mieux étudiés, ont permis d’écarter les assertions concernant une « règle secrète », des pratiques païennes parmi les moines soldats, la conversion cachée de certains d’entre eux à l’Islam. Rien, comme le rappelle Alain Demurger, auteur du chapitre, n’y renvoie au moindre ésotérisme, encore moins aux origines de la maçonnerie ni aux trésors, spirituels et matériels supposés découverts sous le temple de Salomon. Tout cela est un fatras inventé à compter du XVIIIe siècle à partir de rien, et grossi à l’infini par une foule d’illuminés, certains sachant fort bien ce qu’ils faisaient, afin d’accréditer l’existence d’un secret gnostique détenu par les Templiers, lesquels auraient été, pour cette raison, éradiqués par la papauté et la monarchie. Le Da Vinci Codene fut que le dernier avatar de cette énorme fumisterie, qui aura écarté de l’Église des multitudes de crédules manipulés.
Créer artificiellement des zones d’ombre et des « mystères » autour de Jeanne d’Arc, la vouloir bâtarde d’Isabeau de Bavière et de Louis d’Orléans, gloser sur sa santé mentale, la prétendre échappée au bûcher de Rouen, c’est nier la réalité du miracle johannique et la possibilité que Dieu soit intervenu dans les difficultés du royaume de France. Ainsi que le dit Jacques Trémolet de Villers, le seul mystère de Jeanne tient à la grandeur du miracle qu’elle incarne, et c’est précisément ce qui dérange.
À travers la Saint-Barthélemy, et les pamphlétaires huguenots l’avaient fort bien saisi, qui s’en servirent d’abondance, c’est la légitimité monarchique, le rôle du roi, accessoirement de la reine mère, qui sont dénoncés afin de remettre en cause la dynastie des Valois.
Affirmer que Ravaillac fut manipulé par les ultimes partisans de la Ligue, c’est accuser les catholiques d’avoir trahi les intérêts de la France dans une sombre alliance avec l’ennemi espagnol, donc faire du pape et de l’Église un péril pour l’État et la cohésion nationale … S’interroger sur la nature des liens entre Anne d’Autriche et le cardinal de Mazarin, ou sur la volonté de Louis XIV de minimiser le rôle de Mme de Montespan, sa maîtresse et la mère de princes légitimés, dans l’Affaire des Poisons, c’est encore saper les fondements sacrés de l’ordre royal. Tout comme disserter gravement, même contre tout bon sens, sur l’éventualité que le Masque de fer fût le frère jumeau du Roi Soleil, ou que l’on ait caché au couvent de Moret l’existence d’une fille à la peau noire née du souverain et de sa femme …
Toutes ces histoires enflent, grossissent, sortent sur la place publique à l’époque des Lumières et comment douter que cela soit voulu, calculé pour atteindre le trône et l’autel ?
Cela devient évident avec l’agitation autour de l’affaire du collier de la Reine, née de l’aveuglement du cardinal de Rohan, pourtant bon diplomate admiré pour son intelligence, et de la vindicte de Marie-Antoinette, qui ne comprit pas qu’elle serait la première victime d’une « médiatisation » qu’il eût fallu à tout prix éviter …
Ne revenons pas, Philippe Delorme le fait à la perfection, sur le drame Louis XVII, désormais éclairci. Faire croire à la survie du petit roi, c’était saper, et d’abord dans le cœur des fidèles déçus par la réalité de la Restauration, le sentiment de la légitimité bourbonienne.
Dans un registre plus scabreux, feindre de ne pas comprendre les circonstances exactes du décès du prince de Condé, retrouvé pendu à une « espagnolette qui ressemblait à une petite baronne anglaise », c’était faire peser sur Louis-Philippe des soupçons de crime d’intérêt assez répugnants, ce qui arrangeait autant la droite légitimiste que la gauche républicaine.
Mêmes manœuvres de déstabilisation politique concernant les morts suspectes de la Troisième République, telles les circonstances, montées en épingle du décès de Zola, icône de la gauche et du progrès fatalement assassiné par un complot réactionnaire.
Quant à l’abbé Saunière, et à l’or de Rennes-le-château, ils servirent à jeter un discrédit supplémentaire sur l’Église, comme si les énormes trafics de messes d’un prêtre indigne n’y avaient pas suffi.
Tout cela, au fil du temps, aura toujours visé les mêmes buts : favoriser la rupture de la France avec un modèle politique et religieux qu’il convenait d’éradiquer.
Il faut se féliciter du sérieux d’un ouvrage qui remet, sauf rares exceptions, l’histoire à l’endroit et démolit les mythes fabriqués dans l’intention de nuire.
Malheureusement, ils ont la peau dure et rencontreront toujours des adeptes pour les préférer à la vérité historique.
Les énigmes de l’histoire de France, (Perrin. 400 p. 21 €.) supervisé par Jean-Christian Petitfils

.jpg)


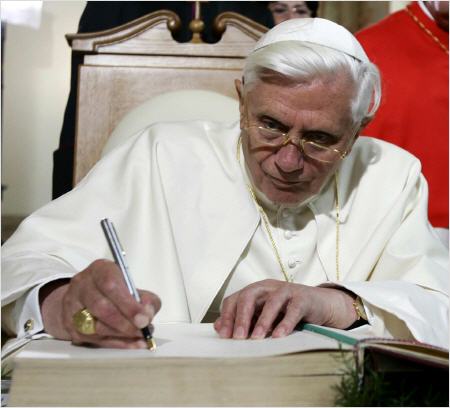

 « Le 25 juillet 1968,
« Le 25 juillet 1968,