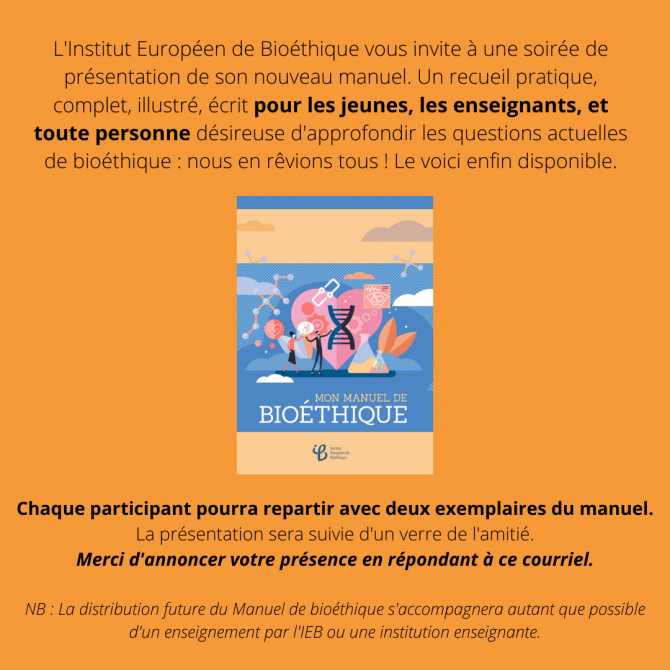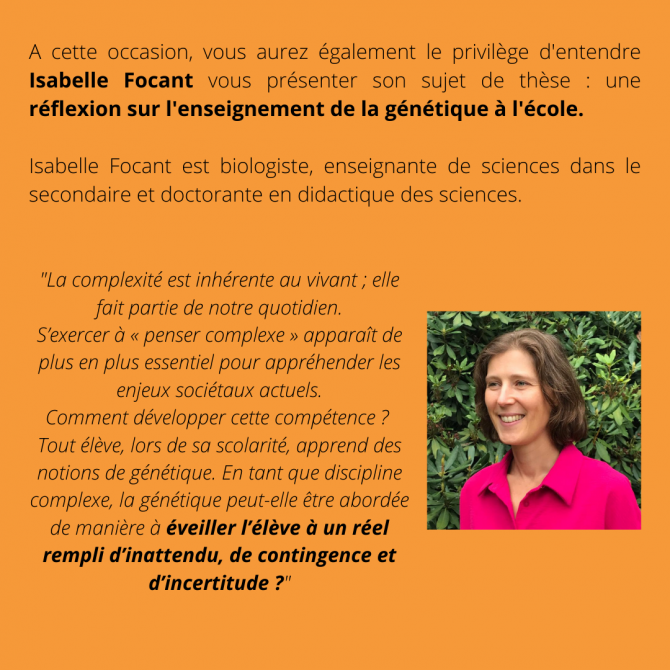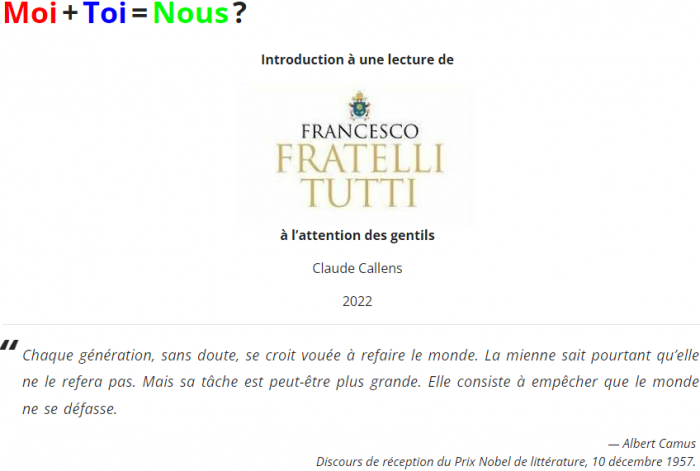On célèbre cette année le huit centième anniversaire de la rencontre de François d’Assise et du sultan d’Égypte Al-Malik al-Kâmil ? Qu’en sait-on historiquement ?
La scène se déroule durant la cinquième croisade. En 1219, les croisés étaient alors ensablés devant la ville portuaire de Damiette, en Égypte, que le sultan défendait avec succès. Deux chroniqueurs de l’époque racontent que François est arrivé dans le camp des croisés et qu’il est passé voir le sultan, avec un compagnon nommé Illuminé, lors d’une période de trêve et de négociation de paix. On sait que certains parmi leurs proches les ont prévenus du danger et ont tenté de les décourager. Les récits rapportent que François et Illuminé sont revenus quelques jours plus tard, sains et saufs.
Que se sont dit François et Al-Kâmil ?
On pense que le dialogue fut plutôt paisible et respectueux. Sur son contenu, les versions divergent. L’hagiographie franciscaine avance que François a cherché activement le martyr, ou du moins qu’il était prêt à cette éventualité. D’autres récits mettent l’accent sur son désir de convertir son hôte musulman. La première raison n’exclut pas l’autre. En créant ce qui allait devenir l’ordre franciscain, François cherchait à recréer une vie apostolique, en prenant pour modèle les apôtres et leur désir de pauvreté et d’humilité. Ceux-ci ont tous prêché l’évangile aux infidèles et tous ont été martyrisés. Il est logique que François ait vu ainsi son destin, mais il a fait preuve d’humilité et de respect envers le sultan. Ce dernier, qui vivait entouré de chrétiens et de juifs, ne voulait pas se convertir, mais ne voulait aucun mal à un visiteur comme François. L’épisode, événement mineur dans la Croisade, est passé presque inaperçu sur le moment. Certains chroniqueurs ne le mentionnent pas.
Comment l’événement s’est-il intégré dans l’histoire franciscaine ?
L’épisode fait débat dès les premières hagiographies. À partir du XIVe siècle, la mémoire de François fait l’objet d’une tension au sein de l’ordre entre deux courants : les spiritualistes et les conventuels. Un des biographes du saint a écrit que François était prêt à convertir le sultan, mais que la division des siens l’a obligé à abandonner la mission en Égypte.
À partir de quand le geste de François est-il devenu un symbole du dialogue interreligieux ?
Au XXe siècle, de nombreux auteurs et théologiens ont voulu faire de François un apôtre du dialogue avec les musulmans. Cette relecture historique s’est renforcée avec le concile Vatican II, et plus encore après les attentats de 2001. Giulio F. Basetti-Sani (1912-2001), frère franciscain, a affirmé que François avait pour but, à Damiette, d’entreprendre un dialogue pour la paix. Selon lui, le saint d’Assise avait compris que la croisade était contraire à l’amour prêché par l’Évangile et aurait tout fait pour l’en empêcher. Ne pouvant convaincre les papes, François aurait d’abord cherché à rejoindre un mouvement pacifiste en France, puis serait parti dans les rangs des croisés pour les enjoindre de renoncer. De nombreux franciscains ont suivi cette théorie. Des auteurs littéraires ont également défendu cette vision de François. Le romancier grec Níkos Kazantzákis, dans Le Pauvre d’Assise, présente un François initialement favorable à la croisade qui change d’avis en voyant les tueries et les pillages commis par les soldats chrétiens lors du siège de Damiette. Dans Frère François, Julien Green raconte que le saint a tenté d’éviter l’assaut des croisés et qu’en désespoir de cause il est allé chez le sultan. Selon lui, en échangeant avec cet homme érudit et agréable, François a acquis une très bonne image de l’islam. En réalité, rien n’indique cela. N’oublions pas le contexte de l’événement, un temps de violence.
Comment vos travaux sont-ils reçus par les héritiers de François ?
Les franciscains, très impliqués dans le dialogue interreligieux, et particulièrement avec les musulmans, m’invitent régulièrement. Je leur dis que l’image de François homme de dialogue est un joli mythe, mais pas la réalité. Je suis entendu par beaucoup, mais certains n’arrivent pas à accepter ma thèse.
Qu’en est-il dans le monde arabo-musulman ?
L’épisode y est très peu connu. Je n’ai quasiment rien trouvé dans les sources ou auprès de mes collègues. D’un point de vue arabe, on regarde aujourd’hui les croisades moins dans leur dimension religieuse que comme un phénomène précurseur du colonialisme européen.
Propos recueillis par Philippe Clanché.
* Professeur d’histoire à l’université de Nantes, spécialiste des études médiévales, auteur de Le Saint chez le Sultan. La rencontre de François d’Assise et de l’Islam. Huit siècles d’interprétation (Seuil, 2007).
On peut aussi lire - avec la prudence qui s'impose - cette étude parue ICI.