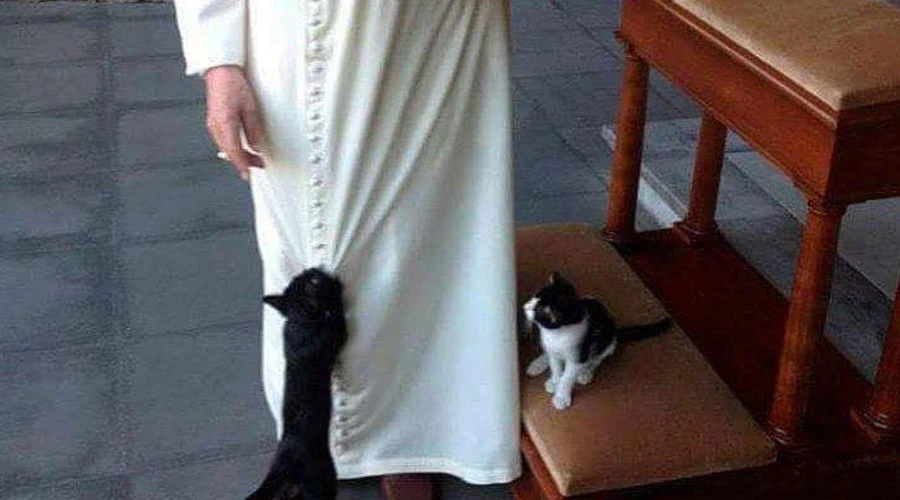D'Alexandra Greeley sur le National Catholic Register :
Ce que doivent endurer les chrétiens en terre musulmane
Histoires vraies de chrétiens courageux vivant leur foi en terre musulmane

Détail de la couverture du livre "The Perscuted" de Casey Chalk (photo : Sophia Institute Press)
9 août 2022
La persécution des chrétiens par les musulmans est un sujet omniprésent, certaines sources publiant le nombre annuel de morts. Pour sensibiliser le public à ces atrocités, l'auteur Casey Chalk a écrit The Persecuted : True Stories of Courageous Christians Living Their Faith in Muslim Lands, publié par Sophia Institute Press (2021).
Comme l'écrit Pieter Vree, rédacteur en chef du magazine New Oxford Review, dans la préface du livre, "la persécution des chrétiens n'a rien de nouveau." Il ajoute : "Notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même fait face à la persécution, au harcèlement, aux menaces et aux tentatives de lapidation tout au long de son ministère..." Même le pape François, lors d'une messe à la Casa Santa Marta, a parlé de la façon dont un groupe dissident des talibans à Lahore, au Pakistan, a fait exploser un groupe de prière chrétien.
Mais au lieu d'aborder cette calamité à l'échelle mondiale, Chalk se concentre sur les problèmes d'un seul homme et de sa famille qui ont fui le Pakistan pour Bangkok, en Thaïlande, puis ont été contraints de retourner au Pakistan. L'homme, Michael D'Souza, moitié sud-asiatique et moitié portugais, est né et a grandi à Karachi, au Pakistan, et était un fervent catholique.
À la fin des années 1990, il s'est marié et travaillait à Karachi pour une école affiliée à l'Église anglicane, mais au début des années 2000, les débuts des persécutions musulmanes ont commencé, et il a été renvoyé de l'école. En 2006, deux mollahs se sont présentés à son domicile et lui ont ordonné de se convertir à l'islam, ce qu'il a refusé. Les visites à son domicile se poursuivent pendant plusieurs années, et il reçoit même des visites lorsqu'il travaille comme sacristain à l'église Saint-Antoine.
Les agressions contre D'Souza et sa famille se sont poursuivies malgré son déménagement dans d'autres villes du Pakistan. En octobre 2012, lui et sa famille sont retournés vivre dans un autre quartier de Karachi. En se rendant à la cathédrale Saint-Patrick pour rendre visite au père Peter John, il a vu placardées sur les murs d'une mosquée voisine des photos de lui disant qu'il avait insulté l'islam. Cette nuit-là, D'Souza a fui Karachi pour se rendre dans une ville voisine où des membres de sa famille l'ont exhorté à fuir le Pakistan. Il a également demandé conseil au père Peter John, qui l'a exhorté à quitter le pays.
La famille D'Souza est arrivée à Bangkok fin novembre 2012, mais bien qu'ils aient des visas de tourisme, les fonctionnaires thaïlandais ont commencé à causer des problèmes. D'Souza a rejoint la paroisse rédemptoriste Holy Redeemer, où un ami leur a donné l'argent pour payer les fonctionnaires thaïlandais du centre de détention. Un an plus tard, D'Souza a demandé le statut de réfugié au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, mais sa demande a été rejetée, laissant la famille avec peu d'options. La famille s'est liée d'amitié avec des paroissiens de l'église Holy Redeemer qui leur ont apporté un soutien financier. Un paroissien les a même hébergés dans un appartement.
Puis, à la mi-2014, Casey Chalk et sa famille ont déménagé à Bangkok et sont devenus des paroissiens actifs du Holy Redeemer. Comme Chalk l'a découvert, D'Souza était un paroissien dévoué, et après s'être présenté à D'Souza, Chalk et sa femme ont commencé leurs efforts pour aider à financer et soutenir la famille. Dans le reste du livre, Chalk explique en détail comment D'Souza a lutté pour trouver du travail et rester en tant que réfugié en Thaïlande. Malheureusement, comme l'écrit l'auteur, "il y a beaucoup de demandeurs d'asile et de réfugiés pakistanais en Thaïlande, probablement entre sept mille et douze mille personnes. La plupart d'entre eux sont des catholiques et des chrétiens évangéliques."
Puis en 2017, la famille a finalement décidé de retourner au Pakistan parce qu'elle avait enduré tant de souffrances à Bangkok, et quelques semaines après le départ des D'Souza, Chalk et sa famille sont retournés aux États-Unis. Au cours des années suivantes, Chalk est resté en contact avec la famille D'Souza et s'est efforcé de trouver un recours contre la persécution musulmane dont il est victime au Pakistan.
Comme le dit Vree à propos de Chalk :
Il a mis un visage humain sur la souffrance qui est souvent cachée derrière des statistiques. Nous avons besoin d'entendre les histoires de familles comme celle des D'Souza parce que nous et eux sommes membres du même corps, le corps du Christ. Leur douleur est notre douleur, leur perte est notre perte, et leur joie est notre joie.
Alexandra Greeley Convertie au catholicisme, Alexandra Greeley est écrivain culinaire, critique de restaurants et auteur de livres de cuisine. Elle se passionne pour tous les aspects du monde de l'alimentation, qu'il s'agisse d'interviewer des chefs, de soutenir les agriculteurs locaux ou de faire le lien entre nourriture et foi.