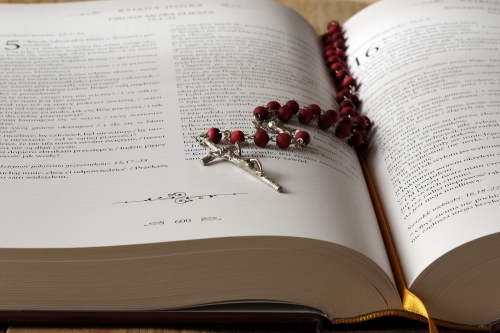Dans le cadre de conférences organisées à l’Université de Liège, l’Union des étudiants catholiques liégeois et le groupe de réflexion sur l’éthique sociale avaient invité, voici quelque temps déjà, le philosophe Rémi Brague, professeur ordinaire à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à la Ludwig-Maximilian Universität de Munich. Membre de l’Institut, celui-ci a reçu le Prix de la Fondation Ratzinger-Benoît XVI. Elle rejoint la dénonciation, renouvelée aujourd’hui par le pape émérite (Un texte inédit de Benoît XVI sort en Italie ), de l’anthropologie mortifère que l’Occident postchrétien fait peser sur le monde.
 Voici, en synthèse, un rappel de cette conférence intitulée : « Eclipse de Dieu, éclipse de l’homme ». Elle n’a pas pris une ride :
Voici, en synthèse, un rappel de cette conférence intitulée : « Eclipse de Dieu, éclipse de l’homme ». Elle n’a pas pris une ride :
Mort de Dieu, mort de l’homme
Le titre est une métaphore empruntée à l’œuvre du philosophe juif Martin Buber (Vienne 1878-Jérusalem 1965) illustrant le thème de la mort de Dieu que l’on rencontre aussi chez Max Weber (Le désenchantement du monde, 1917) et, bien sûr, Friedrich Nietzche (le Gai Savoir, 1882) : plus que de triomphe, c’est un cri d’inquiétude auquel répond celui de la mort de l’homme que l’on trouve chez Léon Bloy, Nicolas Berdiaev ou André Malraux. Il a été repris et rendu célèbre par Michel Foucauld (Les mots et les choses, 1966) ramenant cette idée à la critique d’une incohérence logique : si le prototype disparaît, alors la copie doit aussi s’effacer. La thèse de Rémi Brague est moins innocente : selon lui, la disparition de Dieu à l’horizon de l’humanité pourrait, de fait, entraîner celle de l’humanité elle-même, sinon physique en tout cas ontologique: la disparition de ce qui fait l’humanité de l’homme.
Echec de l’athéisme ?
Pour Rémi Brague, l’athéisme est un échec. Sa faveur croissante dans l’opinion publique n’est pas une objection pertinente. Pour un philosophe, la quantité de gens qui défendent une opinion déterminée n’est pas un argument en soi : ni pour, ni contre. Mais d’autres succès spectaculaires sont à mettre au crédit de l’athéisme :
Au niveau théorique d’abord, la science moderne de la nature n’a plus besoin d’une religion « bouche-trou » lorsqu’on cherche une explication du monde. Mais, on peut ici se demander si une religion a vraiment jamais prétendu expliquer comment le monde fonctionne. Quoi qu’il en soit, le Dieu horloger de Voltaire a vécu. Cette victoire théorique se complète d’une victoire dans la pratique politique, laquelle montre que les sociétés d’aujourd’hui peuvent s’organiser sans avoir besoin d’un principe supra humain de légitimité. Reste que toutes les religions ne cherchent pas à réglementer la société : on oublie trop à cet égard que le christianisme n’édicte pas de règles de conduite fondamentalement distinctes de celles que la raison naturelle a ou pourrait trouver par ses propres forces. De fait, le Décalogue qui est ce qu’il a retenu de la Torah des juifs n’est jamais que le « kit » de survie de l’humanité : un minimum.
Quoi qu’il en soit, les deux « victoires » de l’athéisme sont énormes dans l’histoire de l’humanité. Mais elles appellent tout de même deux observations :
D’une part, l’athéisme n’est pas nécessairement l’affirmation militante de convictions agressives. Ce peut être d’abord un principe de méthode : une mise entre parenthèses du divin. C’est pourquoi on a inventé des termes comme « agnosticisme », « sécularisme » ou « humanisme » (un parti politique belge d’origine chrétienne a même adopté ce qualificatif). D’autre part, cet agnosticisme lui-même ne concerne pas que les questions religieuses : le positivisme philosophique se contente de connaissances « positives » sur le monde, sans chercher les causes dernières des phénomènes qu’il appréhende.
Est-il légitime que l’homme existe ?
Malgré tout cela, l’athéisme contient un défaut mortel, même sous sa forme atténuée de l’ agnosticisme. Il y a, en effet, une question sur laquelle l’athéisme n’a rien à dire dès lors que la racine de l’homme serait l’homme lui-même : s’il n’existe aucune instance supérieure à l’homme, comment celui-ci pourrait-il affirmer sa propre valeur? Si c’est l’homme lui-même qui se juge, comme dirait Chesterton, c’est le signe du fou, dont l’histoire politique nous montre maints exemples.
Au tournant des XVIIIe-XIXe siècles, Fichte, radicalisant la philosophie de Kant, croit avoir trouvé la solution : le divin est donné dans la loi morale qui est présente en nous et dont nous aurions tous conscience. Donc, il n’y a pas besoin de foi en Dieu mais, en revanche, il y a quelqu’un en qui nous avons besoin de croire : c’est l’homme.
Croire en l’homme, malgré ce théâtre de grand guignol que représente l’histoire ? Nous avons eu, au XXe siècle, deux régimes explicitement athées : l’un anti-chrétien parce qu’anti-juif, l’autre anti-juif parce qu’anti-chrétien. « J’ai honte d’être un être humain » disait alors la philosophe allemande d’origine juive Hanna Arendt. Et aujourd’hui la question de la légitimité de l’être humain se fait encore plus concrète parce que nous avons, à grande échelle, les possibilités techniques d’en finir avec l’humanité. Or, comme disait Leibniz, les possibles ont une tendance à exister.
Mais, à supposer même que l’athéisme ne tue personne, est-il capable de donner des raisons de vivre ? L’homme n’est peut-être pas le gentil du film hollywoodien, c’est peut-être le méchant ou, comme disait le philosophe angliciste allemand Hartmann, la « sale bête » universellement prédatrice, universellement envahissante ne se contentant pas de sa niche écologique mais faisant irruption partout : si l’homme disparaissait, alors tout de même la nature serait libre.
Que faire avec ce genre d’argument ? Une réponse serait de dire qu’il y a un instinct de survie et que l’homme peut bien continuer à exister sans s’occuper de sa propre légitimité. Mais alors, le seul animal qui se pose la question des raisons de ce qu’il fait renoncerait à la raison à propos d’un problème qui met en jeu son existence.
Cette impasse rationnelle n’appelle qu’une issue raisonnable : c’est de trouver un point de référence extérieur qui puisse dire qu’il est bon qu’il existe des hommes, un levier d’Archimède qui soit en droit de dire, justement parce qu’il n’est pas homme, que celui-ci, malgré tout, doit être sauvegardé et, conclut Rémi Brague, pour nommer ce point de référence extérieur, si vous trouvez un meilleur terme que Dieu, vous me faites signe.
Dans son célèbre « Drame de l’humanisme athée » publié à la fin de la seconde guerre mondiale, le Père Henri de Lubac estimait que si l’on peut construire une société sans Dieu, elle serait inhumaine. Moins optimiste, Rémi Brague ajoute qu’une telle société serait séculaire au sens propre du terme, c’est-à-dire que raisonnablement, elle ne pourrait donner que la vie d’un individu humain en sa longévité maximale.
JPSC

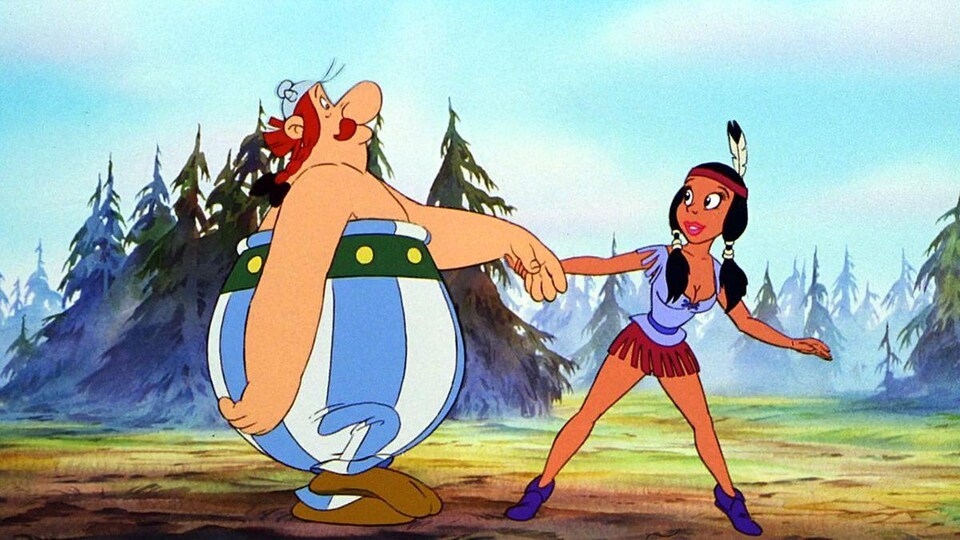

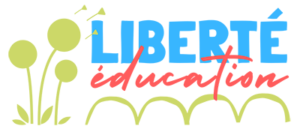
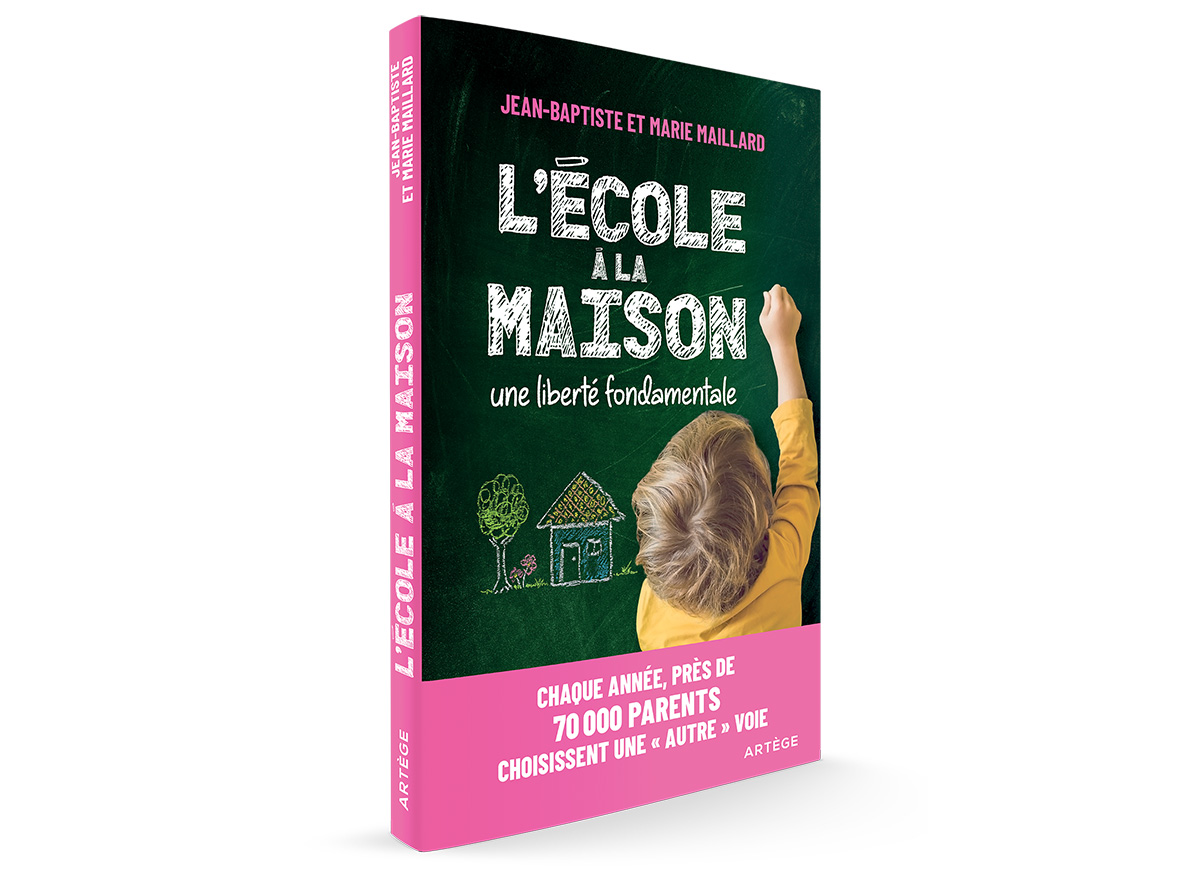
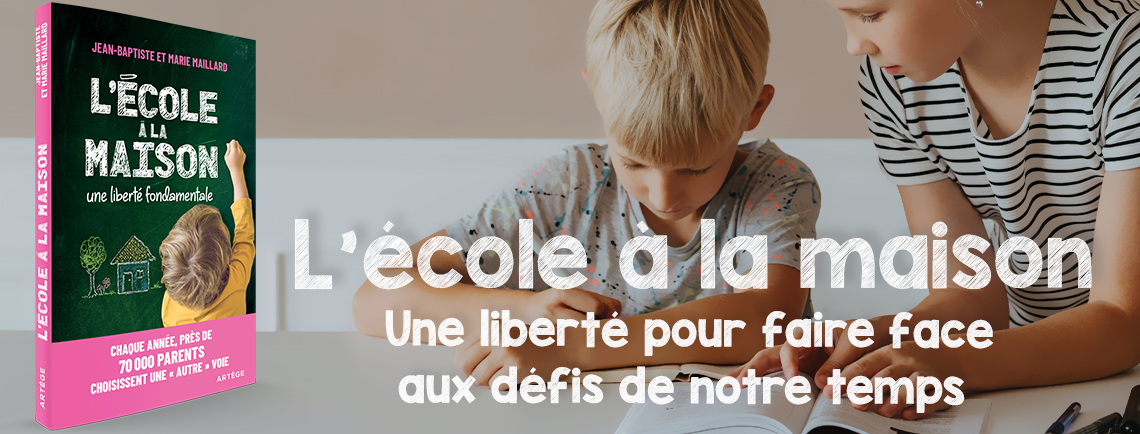
 Les auteurs :
Les auteurs :