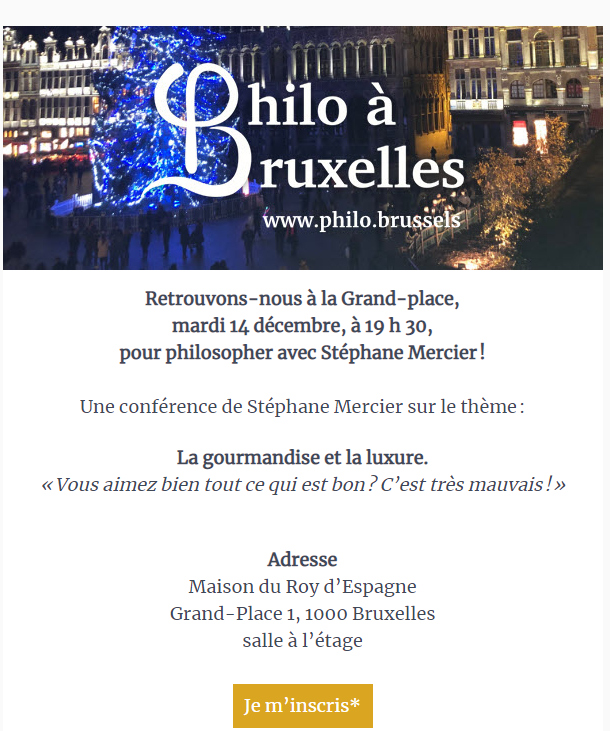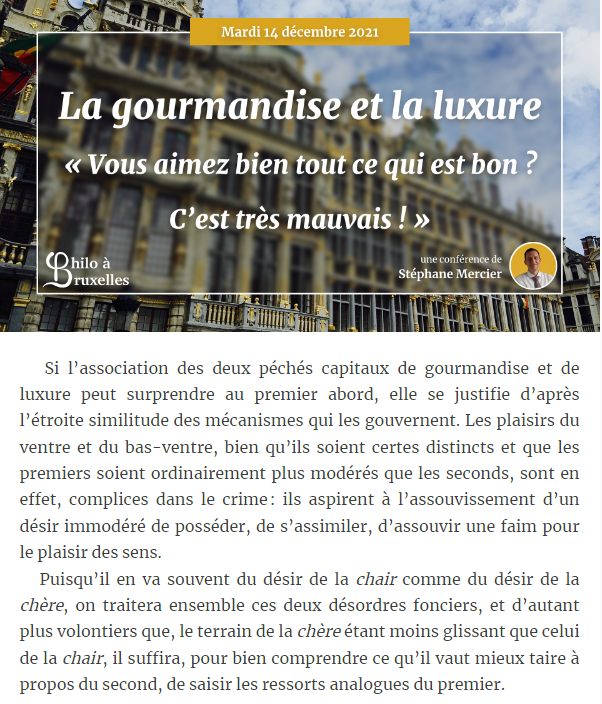De Ralph SCHMEDER, responsable du Service de presse du diocèse de Liège :
La menace d’une nouvelle guerre scolaire ?
Chère lectrice, cher lecteur,
D’habitude, le mois de décembre est un mois paisible. Le temps de l’Avent, dont les lumières éclairent l’obscurité de l’hiver naissant, conduit vers la fête de la Nativité, fête de la paix. Qu’en sera-t-il cette année puisque le cours de religion dans nos écoles est une fois de plus en danger ?
Le 22 novembre laissera des traces d’une autre époque, avec un triste air déjà vu de guerre scolaire. Lors d’une déclaration conjointe, des parlementaires issus du Parti Socialiste, d’Ecolo et du Mouvement Réformateur, trois partis de la majorité de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont présenté les conclusions du groupe de travail en charge d’un examen du cours d’Education à la Philosophie et à la Citoyenneté (EPC). Sans avoir consulté les représentants des cultes, ils recommandent l’augmentation de ce cours à deux heures par semaine dans l’officiel et la suppression de l’obligation du cours de religion. L’enseignement libre serait alors le seul réseau où le cours de religion serait encore clairement inscrit dans le programme.
Dès l’annonce de ce projet, le porte-parole francophone de la conférence des évêques, Tommy Scholtes, a immédiatement réagi : « Cela me paraît une grave erreur de sortir les cours de religion ou de morale de la grille scolaire habituelle des élèves. Si la constitution en son article 24 demande qu’on organise un cours, ce n’est pas pour le sortir de la grille. C’est oublier que la religion et la morale font partie de manière constitutive de la vie sociale et culturelle des jeunes citoyens que sont les élèves. Transférer de manière facultative le cours en le rendant à option, c’est laisser place à toutes sortes d’initiatives qui seront organisées en dehors des écoles et donc du contrôle d’une inspection scolaire. »
A l’heure où j’écris ces lignes, la première vague d’indignation dans le monde catholique est déjà passée, et on peut espérer que l’Eglise (comme d’ailleurs les autres religions) puisse encore faire entendre sa voix pour répondre à cette nouvelle attaque. Même si ce projet ne concerne que les écoles officielles, on peut penser qu’il ne s’arrêtera pas là. Tôt ou tard, on remettra aussi en question le cours de religion dans le réseau des écoles catholiques. Le mardi 23 novembre, j’ai assisté à une réunion « en distanciel » du conseil presbytéral, où l’assemblée (y compris notre évêque et son vicaire général) s’est prononcée à l’unanimité pour la nécessité de se défendre par rapport à ces tentatives de plus en plus ouvertes de faire disparaître l’enseignement de la religion chrétienne dans nos écoles.
Un confrère curé témoignait : « Dans les écoles communales de mon Unité pastorale, déjà à l’heure actuelle, il n’y a plus eu de cours de religion depuis deux ans, et à la catéchèse de profession de foi, on sent déjà clairement la différence de niveau de culture religieuse entre les enfants qui fréquentent l’officiel et ceux qui sont dans une école catholique ».
Comment réagir ? Les représentants des cultes n’ont plus les mêmes appuis politiques que par le passé. Faut-il lancer des pétitions, écrire des cartes blanches dans la presse ? La mobilisation des parents, qui devraient réclamer le droit à une formation aux valeurs chrétiennes, est une autre possibilité qui pourrait avoir un certain poids.
Toute cette discussion est un bon exemple de cette « guerre froide » malheureuse qui divise notre société, entre ceux qui veulent réduire la pratique d’une religion à une affaire strictement privée et ceux, dont je suis, qui restent persuadés que les valeurs (morales et spirituelles) véhiculées par les religions sont des biens publics constitutives de notre société. Une « société laïque », est-ce une société dirigée par une certaine laïcité dont l’idéologie est le combat contre les religions établies, notamment le catholicisme et l’islam ? Est-il encore permis de rêver d’une société où il y a de la place pour toutes les convictions, où on peut s’enrichir mutuellement, dans le respect de ceux qui se réclament du Dieu de Jésus-Christ, d’Allah ou de Bouddha ?
Mais que ces rumeurs de guerre idéologique ne nous empêchent pas de nous préparer intérieurement à la fête de l’Incarnation de Dieu dans notre monde. Déjà il y a 2000 ans, un petit nouveau-né, venu au monde dans une étable à Bethléem, a fait frémir les puissants de son temps. Et pourtant, il est venu pour annoncer la paix de Dieu et pour inaugurer ce qu’il appellera lui-même le « Royaume des cieux ».

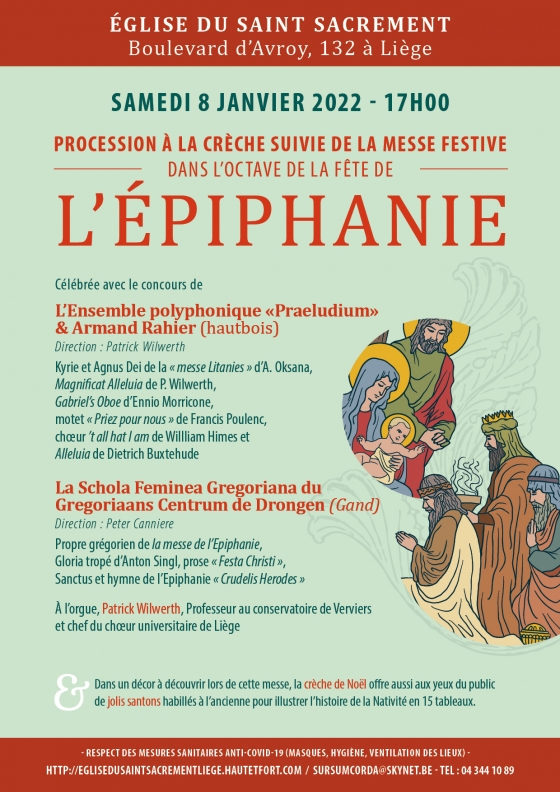
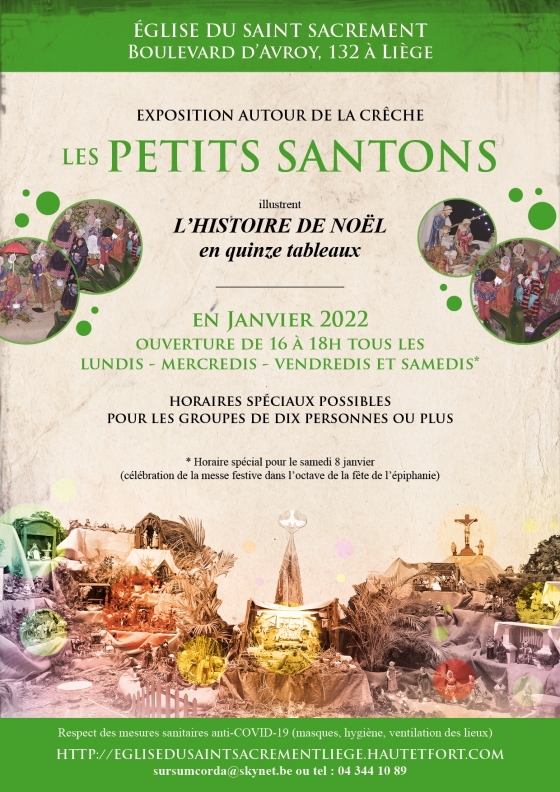

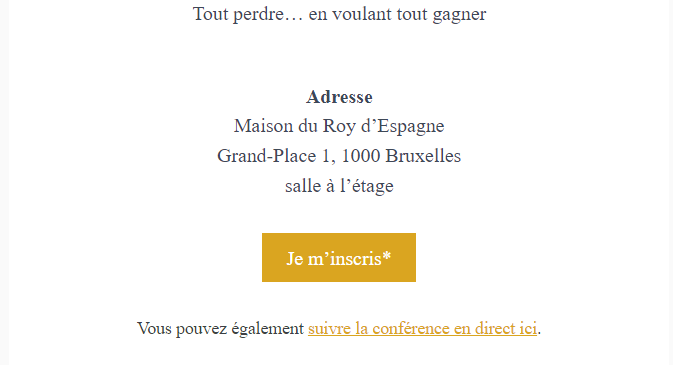
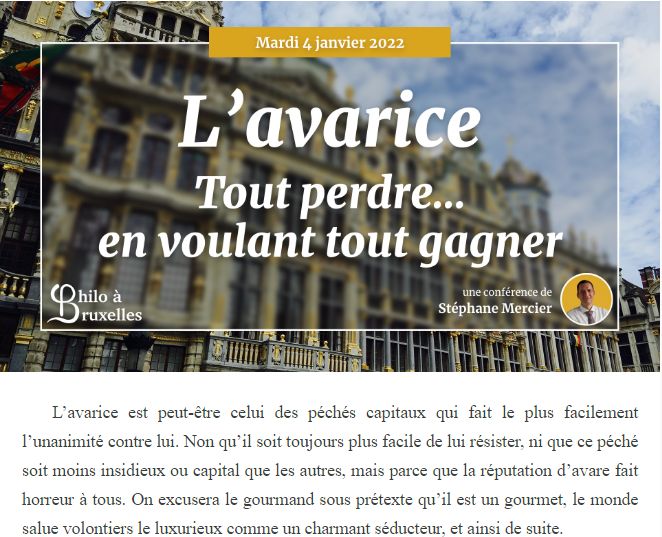
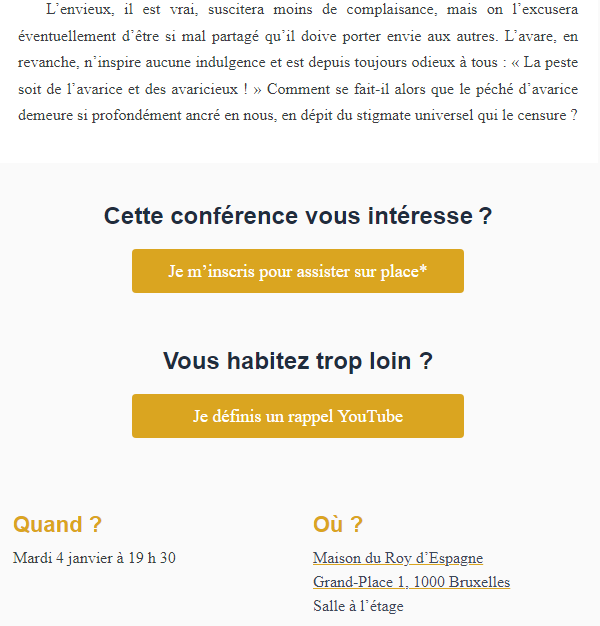
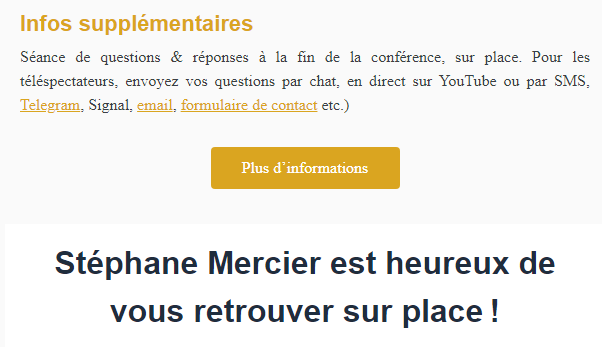

 « La publication samedi 18 décembre par le Vatican d’un document répondant à des questions sur le motu proprio Traditionis custodes restreignant la messe tridentine a suscité une vive incompréhension de la part des milieux traditionalistes mais aussi chez de nombreux fidèles.
« La publication samedi 18 décembre par le Vatican d’un document répondant à des questions sur le motu proprio Traditionis custodes restreignant la messe tridentine a suscité une vive incompréhension de la part des milieux traditionalistes mais aussi chez de nombreux fidèles. Le 28 novembre 2021, les fidèles du « novus ordo missae » (1970) ont pu enfin redécouvrir l’une des plus essentielles formules théologiques définies par l’Église au IVe siècle : la consubstantialité, mettant fin à la traduction erronée « de même nature que le Père ». Une réflexion d’Annie Laurent lue sur le site web de la revue « France Catholique » :
Le 28 novembre 2021, les fidèles du « novus ordo missae » (1970) ont pu enfin redécouvrir l’une des plus essentielles formules théologiques définies par l’Église au IVe siècle : la consubstantialité, mettant fin à la traduction erronée « de même nature que le Père ». Une réflexion d’Annie Laurent lue sur le site web de la revue « France Catholique » :