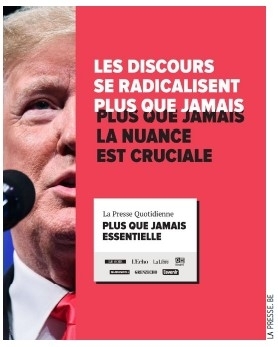De l'Institut Européen de Bioéthique :
GPA : à Rome, un large panel d'experts appelle à l'interdiction internationale de la pratique
Les 5 et 6 avril derniers, s’est tenue à Rome une conférence internationale pour l’abolition universelle de la gestation par autrui (GPA).
Cette réunion d’experts internationaux s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Casablanca, signée le 3 mars 2023 à l’occasion de la conférence de lancement de cette initiative (voy. actualité IEB 14/3/23).
Plus d’une centaine d’experts de 75 nationalités ont depuis lors signé cette déclaration visant à inviter les États et les organisations supranationales à adopter des mécanismes juridiques garantissant l’interdiction de la pratique des mères porteuses.
Par ailleurs, les experts ont pu à nouveau insister sur la nécessité, au niveau des États, d’interdire et de lutter concrètement contre la pratique de la GPA, et, sur le plan international, de « s’engager dans une Convention internationale en vue de l’abolition universelle de la gestation pour autrui », comme le prévoit la déclaration de 2023.
La tenue de cette conférence dans la capitale italienne résonne avec le projet actuel d’adoption d’une loi érigeant en délit le recours à la gestation pour autrui en droit italien, y compris en dehors du territoire italien.
Parmi les experts signataires de la déclaration de Casablanca, l’on note la présence du Professeur René Frydman, gynécologue obstétricien, « père » du premier bébé éprouvette en France, et auteur du récent ouvrage « La tyrannie de la reproduction ».
La réunion de Rome a pu compter sur la présence de divers experts issus du monde scientifique (en particulier de nombreux juristes), associatif, médiatique ou intergouvernemental. À ce titre, était notamment présente Reem Alsalem, Rapporteure spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles.
Par ailleurs, Olivia Maurel, née de GPA et porte-parole de la Déclaration de Casablanca, a pu témoigner des conséquences traumatiques de la pratique des mères porteuses sur les enfants objets de ces contrats (voy. Actualité IEB 26/1/24), du fait notamment de la séparation précoce et volontaire de l’enfant et de sa mère.
L’organisation de cette conférence début avril 2024 intervient à quelques jours d’une nouvelle réunion du groupe de travail de la Conférence internationale de la Haye (du 8 au 12 avril), dont le mandat vise notamment à réfléchir à la rédaction d’une convention internationale de reconnaissance transnationale de la filiation issue de GPA. À cette occasion, la Coalition internationale pour l’abolition de la maternité de substitution a rappelé, dans une lettre ouverte publiée sur X, la nécessité de mettre fin à un tel projet de libéralisation de la GPA.
En Belgique aussi, alors que la légalisation de la GPA figure dans le programme électoral de plusieurs formations politiques en vue des élections du 9 juin prochain, un « Séminaire de réflexion féministe sur la GPA » s’est tenu le 28 mars dernier à Bruxelles, à l’initiative de l’Université des Femmes, de la CIAMS et de 14 associations féministes. Ce séminaire visait à montrer en quoi la GPA viole les droits humains et à dénoncer l’impact physique et psychologique de cette pratique sur les femmes et les enfants. Dans le contexte des élections 2024, ce séminaire était aussi l’occasion d’interpeler les politiques favorables au déploiement de cette pratique en Belgique.