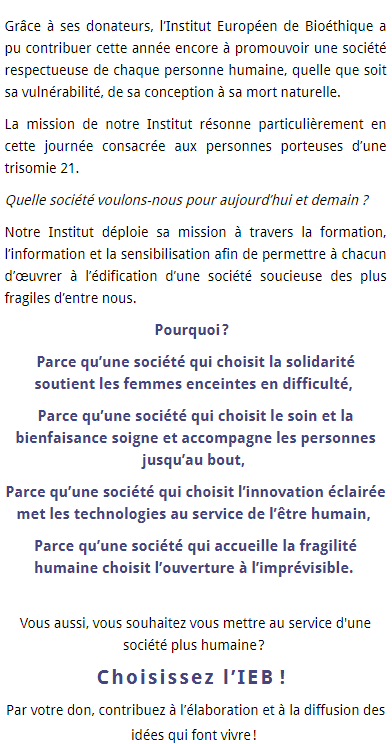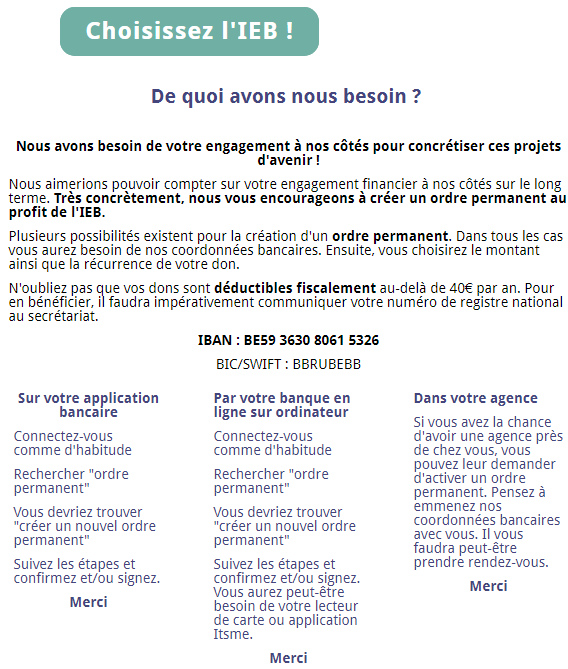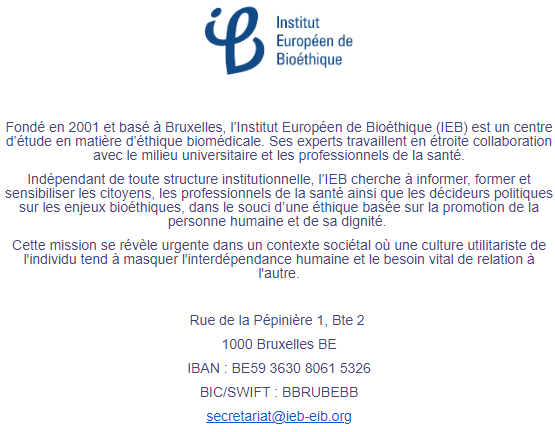Politique - Page 80
-
Soutenons l'Institut Européen de Bioéthique
-
Jimmy Lai, persécuté par la Chine, abandonné par le Vatican
De Patricia Gooding-Williams sur le Daily Compass :
INTERVIEW/PÈRE SIRICO
"Jimmy Lai, persécuté par la Chine, abandonné par le Vatican"
Alors que Hong Kong durcit sa loi sur la sécurité nationale, le célèbre dissident catholique risque d'être emprisonné à vie. Le père Robert Sirico a assisté à la dernière audience de son procès : "Il m'a vu, je l'ai béni et il a été ému". Un crucifix dessiné en prison est aujourd'hui exposé à l'Université catholique de Washington. La proximité du cardinal Zen, le silence de Rome et l'Eglise de Hong Kong.
21 mars 2024

"J'ai pris l'avion pour Hong Kong en janvier dernier pour assister au procès de Jimmy Lai. Il était détenu dans un box vitré, gardé par trois policiers. Il m'a vu et je l'ai béni avec le signe de la croix. Cela l'a ému aux larmes".
Le père Sirico, fondateur de l'Institut Acton pour l'étude de la religion et de la liberté, parle de son ami Jimmy Lai, 76 ans, le prisonnier de conscience le plus célèbre de Hong Kong. Les critiques virulentes de Lai à l'égard du régime totalitaire chinois lui ont coûté plus de 1 500 jours d'isolement dans la prison de Stanley. Emprisonné pour des condamnations liées à la gestion de son entreprise de médias et à sa participation à une veillée organisée pour commémorer le massacre de la place Tiananmen en 1989, Lai purge actuellement une peine de cinq ans et neuf mois.
Parallèlement, M. Lai est inculpé de deux chefs d'accusation pour "conspiration en vue d'une collusion avec des forces étrangères" en vertu de la loi de 2020 sur la sécurité nationale imposée par la Chine, ainsi que pour "conspiration en vue de publications séditieuses" en vertu d'une loi sur la sédition datant de l'ère coloniale. S'il est reconnu coupable, Lai pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. C'est à cette audience que le père Sirico a assisté pour soutenir son "vieil" ami.
Jimmy Lai, millionnaire et franc-tireur, est devenu l'ennemi public n° 1 de Pékin après que Hong Kong, ancienne colonie britannique, a été rétrocédée à la Chine en 1997 dans le cadre de l'accord "un pays, deux systèmes", censé garantir les droits et les libertés absents sur le continent. Lorsque la Chine a commencé à violer l'accord, M. Lai a entrepris de défendre les valeurs de Hong Kong et de demander des comptes à Pékin par l'intermédiaire de son journal, l'Apple Daily.
Ce journal aujourd'hui disparu, fondé et financé par Lai en 1995, a été nommé d'après le fruit défendu dans le jardin d'Eden de l'Ancien Testament. Son couplet rimé - "Une pomme par jour, aucun menteur ne peut tenir le haut du pavé" - a porté ses fruits. Le journal est un succès et son tirage atteint 500 000 exemplaires à son apogée.
C'est peu de temps après qu'Apple Daily se soit frayé un chemin sur le marché très fermé des médias que le père Robert Sirico et Jimmy Lai se sont rencontrés pour la première fois, il y a près de 30 ans. Le prêtre catholique américain et le magnat des médias Lai partagent un intérêt commun : lier la théologie morale à une bonne compréhension de l'économie. Le Daily Compass a interviewé le père Sirico lorsqu'il était à Rome la semaine dernière pour une conférence organisée par l'Acton Institute.
-
Savoir « offrir la vérité » avec calme et sérénité d’âme
LA VÉRITÉ, À TEMPS ET À CONTRETEMPS
20 mars 2024Il est important de savoir « offrir la vérité » avec calme et sérénité d’âme.
Dans sa fameuse lettre Que dire à un jeune de vingt ans, Hélie de Saint Marc suggère à son jeune lecteur de « ne pas s’installer dans sa vérité et de vouloir l’asséner comme une certitude »mais lui conseille plutôt de « savoir l’offrir en tremblant comme un mystère ».
Remarquez que l’ancien officier devenu écrivain n’affirme pas qu’on aurait tort d’avoir des certitudes ou que la vérité n’existerait pas. Ce qui préoccupe l’auteur des Champs de braise tient dans la présentation que l’on en fait. Un bijou se trouve toujours sublimé par l’écrin qui le contient, un présent par le paquet cadeau qui l’emmaillote. En matière de témoignage à la vérité, tout est affaire d’élégance apostolique, d’intelligence de cœur et de délicatesse pédagogique. Il restera toujours ensuite à la liberté humaine d’accepter ou non le trésor offert.
Trois attitudes d’âme sont en effet possibles quant à l’accueil d’une vérité mystérieuse, allant du « Fiat » de Marie au « Non serviam » de Satan en passant par le « Qu’est-ce que la vérité ? » de Pilate. La confiance et l’abandon de la Vierge, qui surmonte son appréhension devant la réalisation inouïe de l’Incarnation par sa médiation. L’orgueil obstiné du plus beau des anges, qui refuse l’apparent paradoxe du Verbe appelé à se faire chair. Le doute et l’indécision du gouverneur de Judée, qui préfère se laver les mains plutôt que de choisir (oubliant que renoncer à prendre parti est déjà un choix en soi aux conséquences immédiates, cela nous sera remémoré lors de la Semaine sainte à venir).
Entendons-nous bien, « savoir offrir la vérité » à son prochain – spécialement dans sa dimension transcendante ou surnaturelle – dépasse nécessairement tout un chacun. Les vérités attachées au mystère de la mort ou de la vie participent de ce vertige. Permettez-moi, à l’occasion de cet éditorial, de me plier à une rapide étude de la citation d’Hélie de Saint Marc en tentant de l’appliquer au drame de la constitutionnalisation de l’avortement qui fait la couverture de ce numéro.
« Ne pas s’installer dans sa vérité ». Oui, la réalité des choses se reçoit. Elle s’impose même souvent à nous et demande d’être acceptée, digérée. À cet égard, notre opposition à l’avortement ne saurait relever d’un sentiment ou d’une opinion, d’une « manière de voir les choses », de « notre vérité».
Dans le cadre de la vie naissante, un truisme se déploie sous les yeux de l’observateur attentif : dans le sein de sa mère, à l’âge d’un mois, l’être humain mesure quatre millimètres et demi. Mieux encore, son cœur minuscule bat déjà depuis une semaine, tandis que ses bras, ses jambes, sa tête, son cerveau sont déjà ébauchés. Comme l’écrivait le professeur Lejeune : « L’incroyable Tom Pouce, l’homme moins grand que mon pouce, existe réellement. » Nous l’avons tous été. Ceci n’est pas un point de vue de « catholique conservateur » – quelle pernicieuse expression ! – mais la photographie objective du commencement de la vie.
« Vouloir asséner la vérité comme une certitude ». Là réside certainement la grande difficulté. Démontrer l’évidence, voilà l’actuel et herculéen défi que Chesterton avait prophétisé : « On tirera l’épée pour prouver que les feuilles sont vertes en été. »
« Savoir offrir la vérité ». Chez nombre d’entre nous, depuis trop longtemps, le degré de tolérance aux ténèbres a été dépassé. Trop, c’est trop. Aussi, l’on voudrait crier la vérité sur les toits de toutes nos tripes. Si ces dernières ont leurs vertus propres (à ne jamais négliger), l’intelligence, l’humilité, la patience et la persévérance ont également les leurs. Calme invincible et sérénité d’âme constituent des alliés indispensables pour affirmer avec force les vérités qui entourent la conception humaine et le sujet de l’enfant à naître.
« Offrir la vérité en tremblant comme un mystère ». En tremblant, non que la vérité nous trouble ou nous fasse douter, mais parce que le Christ nous fait l’honneur d’en devenir les serviteurs. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité : quiconque est de la vérité écoute ma voix » (Jn 18, 37). Laïcs, prêtres ou évêques : nous ne sommes pas là d’abord pour interroger notre monde, l’inviter à se questionner ou lui faire part de notre tristesse ! Quelle platitude argumentaire dans une séquence si grave ! Nous sommes là au premier chef pour rendre témoignage du Christ qui est « la voie, la vérité et la vie » (Jn 14, 6).
Au-delà de nos pauvres mains, de notre faiblesse et de nos péchés, nous avons un trésor à offrir. Envers et contre tout. Une vérité éblouissante à transmettre. À temps et à contretemps. Et son premier éclat tient en quelques mots : « Au commencement, il y a un message, ce message est dans la vie, ce message est la vie. »*
------
*Professeur Jérôme Lejeune
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Foi, Politique, Société, Témoignages 1 commentaire -
Que font les évêques catholiques de la Comece à Bruxelles ?
De Stefano Fontana sur la Nuova Bussola Quotidiana :
EUROCONFORMISME
Les évêques catholiques réduits à l'état de fonctionnaires de l'UE
Que font les épiscopats européens à Bruxelles ? Une question spontanée à en juger par les deux documents à l'approche du vote, où la doctrine sociale est rare et les clichés triomphants.
20 mars 2024
Que font ces évêques catholiques de la Comece à Bruxelles ? On ne peut éviter cette question en examinant deux de leurs récents documents produits à l'approche des prochaines élections parlementaires de l'UE en juin. La Comece est la Commission des épiscopats européens auprès de l'Union européenne, basée à Bruxelles, présidée par l'Italien Mgr Mariano Crociata, ancien secrétaire de la Conférence épiscopale italienne (CEI) et évêque de Latina, et composée de 24 évêques représentant les conférences épiscopales nationales, dont quatre en tant que vice-présidents. Le premier document est un Communiqué publié le 13 mars sous le titre Pour un vote responsable qui promeut les valeurs chrétiennes et le projet européen. Le second est un Kit catholique pour les jeunes Européens, une boussole pour les jeunes appelés à voter aux élections européennes. En voyant ce que 24 évêques ont produit pour l'occasion, on est très embarrassé pour eux, si l'on connaît ne serait-ce que de manière rudimentaire quelques éléments minimaux de la Doctrine sociale de l'Eglise.
On sait que l'Union européenne est en crise et dans un état de confusion. La liste de ses méfaits serait très longue. Le président Macron a exprimé sa volonté d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, après l'avoir déjà inscrit dans la Constitution française. Dans toute l'Union, les agriculteurs manifestent leur impatience face aux politiques du Green New Deal voulu par Bruxelles qui, poursuivant l'idéologie climaticide d'un réchauffement climatique attribué à des causes humaines, impose des mesures absurdes et antiéconomiques. Les pays de l'Union sont plus ou moins envahis par une migration clandestine incontrôlée tandis que l'Islam atteint des pourcentages très élevés dans plusieurs villes, imposant sa civilisation. Les institutions européennes défendent et diffusent une culture homogène inspirée par la démocratie relativiste et le subjectivisme narcissique qui tue la famille et d'autres dimensions naturelles de la vie sociale avec les "nouveaux droits". Les différentes "transitions" préfigurent un système social qui, avec la numérisation et l'intelligence artificielle, contrôlera nos vies. La modification des traités risque d'accentuer le centralisme au détriment des nations. Sur la question de la guerre en Ukraine, l'Union se trouve déplacée et subordonnée à des décisions prises ailleurs. Et la liste est encore longue...
Face à ce véritable désarroi qui provoque des dérives inquiétantes, les 24 évêques de la Comece ne peuvent que réaffirmer le bien-fondé du projet européen, rappelant que des hommes politiques catholiques en ont été à l'origine, inviter les citoyens à participer aux élections et à "voter pour des personnes et des partis qui soutiennent clairement le projet européen et dont nous pouvons raisonnablement penser qu'ils vont promouvoir nos valeurs et notre idée de l'Europe, telles que le respect et la promotion de la dignité de toute personne humaine, la solidarité, l'égalité, la famille et le caractère sacré de la vie, la démocratie, la liberté, la subsidiarité, la sauvegarde de notre "maison commune"". L'invitation à voter pour ceux qui soutiennent clairement le projet européen vise à éviter de voter pour des partis critiques, ce que feront de nombreux catholiques exaspérés par cette Union. Le respect de la personne humaine est désormais un concept polyvalent et vide de sens puisque même Macron y fait appel. Solidarité, égalité, liberté, subsidiarité ne sont que des mots conventionnels et génériques si on ne les justifie pas à la lumière de la Doctrine sociale de l'Église.
Lien permanent Catégories : Actualité, Christianisme, Débats, Doctrine Sociale, Eglise, environnement, Ethique, Europe, Jeunes, Politique, Société 4 commentaires -
Union européenne : arguments contre l’ajout de l’avortement dans la Charte
Du site de l'ECLJ :
Union européenne : arguments contre l’ajout de l’avortement dans la Charte
Le 14 mars, un débat a eu lieu en session plénière du Parlement européen à Strasbourg sur la proposition d’Emmanuel Macron : ajouter un « droit à l’avortement » au sein de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE). Cette Charte, qui dispose de la même valeur juridique qu’un traité international, s’impose au droit national de chaque État membre. Une telle modification de la Charte empêcherait les États l’ayant ratifiée de restreindre l’accès à l’avortement.
La résolution envisagée par le Parlement européen sera sans effet sur la Charte. Elle participe cependant de la campagne d’Emmanuel Macron visant à convaincre les autres États membres de l’UE d’ajouter un « droit à l’avortement » dans la Charte. La veille du débat, l’ECLJ a fait parvenir aux députés européens le courrier ci-dessous avec des arguments d’ordre juridique, politique et social. Pendant le débat, qui peut être visionné en rediffusion, des députés des groupes PPE (Parti populaire européen) et ECR (Conservateurs et réformistes européens) ont repris une partie de ces arguments.
La résolution elle-même sera débattue en avril 2024, lors de la prochaine session plénière du Parlement européen.
_______
Mesdames, Messieurs les députés,
Un débat aura lieu demain 14 mars à 9h en session plénière du Parlement européen sur l’« Inscription du droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE ».
L’ECLJ estime que l’avortement est un sujet extrêmement important. Si le Parlement européen décide de s’en saisir une nouvelle fois, il devrait le faire de façon constructive, dans le but de recommander une politique sociale de prévention de l’avortement, afin de réduire les risques de recours à l’avortement. C’est une question de santé publique.
Le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) vous envoie quelques éléments sur ce sujet, dont vous pouvez vous servir largement.
Arguments juridiques
Le fait que le Parlement européen envisage de demander encore d’inscrire un « droit » à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux n’a aucun sens sur le plan juridique.
Pour modifier cette Charte, il faudrait l’unanimité des États membres de l’UE. Or, de nombreux États s’opposent déjà à toute modification. L’avis du Parlement européen est sans effet à cet égard.
La modification envisagée est incompatible avec la Charte elle-même. L’article 51 indique que la Charte s’applique lorsque les États membres mettent en œuvre le droit de l’UE et ne peut pas aller au-delà des compétences de l’UE. Or, l’avortement relève des compétences des États membres, car la politique de santé n’est pas une compétence européenne. L’article 168 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la santé publique, prévoit en son paragraphe 7, que « l’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux ».
De plus, les États de l’UE ont signé et ratifié un Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne (2012), indiquant en son article 1 que la Charte ne peut affecter les législations des États protégeant le droit à la vie des enfants avant leur naissance.
Enfin, aucun traité ou systèmes de protection des droits de l’homme européen et international n’érige l’avortement en droit. Il existe un « droit à la vie », qui est protégé dans de nombreux traités, il existe même une protection internationale des enfants avant leur naissance, dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. La Cour européenne des droits de l’homme a souligné que la Convention « ne saurait (…) s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement » De même, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans l’arrêt Brüstle/Greenpeace de 2011, a rappelé la protection reconnue aux embryons humains au titre du respect dû à la dignité humaine.
-
Le chef de l'Église catholique ukrainienne parle de la guerre, du pape et des bénédictions homosexuelles
De Peter Pinedo sur le Catholic World Report :
Le chef de l'Église catholique ukrainienne parle de la guerre, du pape et des bénédictions homosexuelles
16 mars 2024
Dans une interview exclusive accordée à EWTN News, l'archevêque majeur Sviatoslav Shevchuk, chef de l'Église gréco-catholique ukrainienne, a parlé du besoin continu d'aide humanitaire dans son pays et a discuté des efforts de paix du pape François et de la récente controverse sur les bénédictions de personnes de même sexe.
Le patriarche ukrainien était aux États-Unis pour une semaine de réunions avec des responsables publics et des dirigeants de l'Église afin d'encourager un soutien renouvelé à l'Ukraine. Il s'est entretenu avec EWTN au sanctuaire national catholique ukrainien de la Sainte Famille à Washington.
Mgr Shevchuk a souligné sa gratitude envers le peuple américain pour son soutien, mais il s'est dit préoccupé par le fait que les États-Unis pourraient se lasser d'aider l'Ukraine. Il a lancé un appel : "S'il vous plaît, n'abandonnez pas l'Ukraine".
La guerre en Ukraine
Bien qu'il ait transmis un "message de gratitude" au peuple américain, Mgr Shevchuk s'est inquiété de ce que les Ukrainiens ordinaires soient oubliés alors que le débat politique prolongé sur le soutien à l'Ukraine a retardé l'action.
Alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie va bientôt durer deux ans, 14,6 millions d'Ukrainiens ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, selon Mgr Shevchuk.
Nous ne pouvons pas dire "d'accord, je mangerai la semaine suivante", a-t-il déclaré, ajoutant que l'Église catholique ukrainienne "est l'un des principaux acteurs de cette action humanitaire d'assistance au peuple ukrainien, et je peux témoigner que l'aide ne peut pas être retardée".
Au lieu de penser à la guerre en termes politiques, Mgr Shevchuk a exhorté le peuple américain à penser à l'Ukraine en termes de "peuple simple et souffrant".
"Chaque jour, probablement 200 Ukrainiens sont tués et tout retard dans la capacité à recevoir l'aide nécessaire pour protéger ces personnes est payé de leur sang.
Revenant sur son expérience personnelle de la guerre, Mgr Shevchuk a déclaré que même si "personne n'est en sécurité en Ukraine", les rapports des services de renseignement ont indiqué qu'il était l'une des dix principales cibles de la Russie à éliminer.
"C'est donc dangereux. Mais c'est la mission de chaque évêque à cette époque de voyager avec son propre troupeau", a-t-il déclaré. "Dès le début, je me suis entièrement confié, j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu me veux vivant, cela signifie que je dois servir ton peuple. Je suis encore en vie, ce qui veut dire que j'ai une mission".
"Jésus-Christ est aujourd'hui crucifié dans le corps crucifié de l'Ukraine. Et nous le vénérons dans les blessures des gens simples", a-t-il ajouté.
Le pape François
Mgr Shevchuk a déclaré que le peuple ukrainien souhaitait vivement que le pape François se rende dans le pays et qu'il "priait" pour qu'il vienne bientôt.
Malgré cela, Mgr Shevchuk a admis que la neutralité du Vatican à la suite de la guerre "n'a pas été très bien accueillie en Ukraine au début, car comment peut-on être neutre lorsqu'il y a un agresseur qui nous tue constamment chaque jour ?
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Ethique, International, liturgie, Politique, Solidarité 0 commentaire -
Nigéria : une association catholique affirme que le gouvernement aide les djihadistes à attaquer les chrétiens
Lu sur Crux (Ngala Killian Chimtom) :
Un groupe nigérian affirme que le gouvernement aide les djihadistes à attaquer les chrétiens
16 mars 2024
YAOUNDÉ, Cameroun - Un groupe de chercheurs, de criminologues et d'activistes des droits de l'homme d'inspiration catholique au Nigeria accuse certaines autorités de planifier l'expansion des activités des djihadistes dans le sud-est fortement chrétien sous le couvert de projets d'élevage de l'État.
Ces projets ont été présentés comme un moyen de moderniser l'agriculture et d'améliorer la gestion du bétail. L'idée est de créer des zones désignées où le bétail peut être élevé et pâturé, réduisant ainsi les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs.
En 2019, le gouvernement nigérian a lancé un plan national de transformation de l'élevage sur 10 ans visant à créer 119 ranchs dans plusieurs régions du pays afin d'"apaiser le conflit entre éleveurs et agriculteurs".
La Société internationale pour les libertés civiles et l'État de droit (Intersociety), un groupe d'inspiration catholique, affirme que ce projet est une ruse pour peupler le Sud-Est de bergers musulmans qui terrorisent les communautés chrétiennes depuis des années.
Intersociety affirme avoir minutieusement suivi l'évolution de la situation dans certaines communautés agricoles du Nigeria. Son enquête a révélé une tendance déconcertante : Les dirigeants locaux sont contraints de céder des parcelles de terre pour ces initiatives d'élevage. Cependant, Intersociety soutient que ces projets apparemment inoffensifs peuvent cacher un agenda plus inquiétant.
Selon son rapport du 11 mars, les projets d'élevage sont un écran de fumée pour la réinstallation des bergers peuls.
Le groupe ethnique des Fulanis, essentiellement musulman, est au centre de tensions de longue date au Nigeria, en particulier dans les régions où il s'oppose aux agriculteurs locaux, majoritairement chrétiens, souvent pour des questions de terres et de ressources.
Ces conflits ont dégénéré en violence, entraînant la mort de milliers de chrétiens et le dépeuplement de communautés chrétiennes entières. L'une des attaques les plus flagrantes des Fulanis contre les chrétiens a eu lieu à Noël, lorsque quelque 200 chrétiens ont été massacrés.
Selon Intersociety, au moins 52 000 chrétiens ont été tués au Nigeria depuis 2009.
L'année dernière, les bergers peuls ont été responsables de la mort d'au moins 3 500 chrétiens, selon l'association.
Intersociety a promis de s'opposer aux projets des gouverneurs des États d'Enugu, d'Anambra, d'Abia, d'Imo et d'Ebonyi, au Nigeria, visant à réinstaller les bergers peuls, accusés d'être à l'origine de ces attaques inspirées par le djihad.
Selon Intersociety, l'inquiétude est particulièrement forte dans l'État d'Enugu, où les terres communautaires sont de plus en plus menacées d'être accaparées "pour l'élevage ou l'installation de bergers peuls".
"Le gouvernement de l'État, sous la direction de Peter Mbah, a été fortement et largement accusé de contraindre certaines communautés de l'État possédant de vastes étendues de terres agricoles, de broussailles et de forêts à en céder ou à en abandonner une grande partie à des fins d'agriculture mécanisée ou d'élevage de vaches", indique Intersociety dans son rapport signé par le président de son conseil d'administration, Emeka Umeagbalasi.
Il a décrit ce plan comme "un camouflage pour les implantations de Fulanis djihadistes" dans l'État.
Le rapport note que les terres du sud-est qui sont maintenant ciblées par le gouvernement pour l'élevage sont "trop petites pour être accaparées par les Fulanis". Il affirme que les terres ont été cédées pour l'installation de Fulanis et qu'elles pourraient devenir des "colonies de Fulanis djihadistes" déguisées en ranchs pour le bétail.
Dans sa déclaration, Intersociety a mis en garde les gouverneurs des États concernés et leur a demandé de renoncer à "tout déguisement ou camouflage visant à établir des colonies de bergers dans n'importe quelle partie de leurs États respectifs".
"Ces mesures doivent être supprimées dans tout le Sud-Est ou faire l'objet d'une résistance légale et populaire", a déclaré l'organisation.
Le projet d'élevage de bétail a également suscité des réactions négatives de la part des habitants qui ont souffert des attaques des Fulanis.
Le chef Johnson Okolo, un agriculteur d'Enugu qui a perdu ses récoltes à cause du bétail et ses terres agricoles à cause des bergers fulanis en maraude, s'est insurgé contre le plan d'élevage de bétail.
"Je suis une victime, j'ai perdu plus de 6 000 palmiers dans ma plantation d'Amofia Agu Affa dans le conseil d'Udi de l'État d'Enugu à cause des bergers peuls qui ont détruit la palmeraie et pris possession de l'endroit depuis plus de quatre ans maintenant", a-t-il déclaré aux médias.
"Je ne suis pas allé dans ma palmeraie depuis quatre ans parce que les bergers se sont emparés de la plantation pour s'y installer", a déclaré M. Okolo, ajoutant que donner des terres aux bergers pour qu'ils s'installent dans la région, c'est tout simplement inviter les gens à avoir des problèmes.
Le gouvernement d'Enugu a ouvertement reconnu son intention de créer des ranchs modernes dans le cadre de son programme de productivité agro-industrielle. Selon leur déclaration, ces ranchs serviront de mesure stratégique pour lutter contre les activités des kidnappeurs et autres criminels qui se déguisent en bergers.
"Il est devenu nécessaire d'expliquer le projet d'utiliser le ranching, une méthode moderne utilisée dans le monde entier, pour élever le bétail", a déclaré le gouvernement.
"Les récents messages viraux et les protestations de quelques personnes contre ce qu'elles considèrent comme l'intention du gouvernement de s'approprier (...) des terres et de les donner aux Fulanis sous le couvert de RUGA (établissements pour les Fulanis) sont la machination malheureuse de ceux qui souhaitent faire une montagne d'une taupinière pour des raisons politiques", a poursuivi le communiqué.
"L'intention du gouvernement est claire à ce sujet. Des bandits armés et des kidnappeurs au nom de bergers profitent depuis longtemps de nos forêts et de nos terres agricoles pour commettre des crimes odieux, des enlèvements, des viols et des meurtres. Le gouvernement de l'État d'Enugu a décidé de mettre un terme à ces pratiques et d'introduire l'élevage en ranch, la méthode la plus moderne d'élever du bétail", explique le communiqué.
"Une fois ce système mis en place, aucun éleveur ou marchand de bétail ne sera autorisé à parcourir des zones non désignées avec ses animaux pour les faire paître", précise le communiqué.
Le Nigeria compte plus de 230 millions d'habitants, presque également répartis entre les chrétiens, principalement dans le sud, et les musulmans, principalement dans le nord.
Alors que le pays est aux prises avec des problèmes sociopolitiques complexes, l'équilibre délicat entre le développement agricole, la sécurité et les droits de l'homme reste difficile à trouver.
Les préoccupations du groupe catholique nous rappellent brutalement que des initiatives apparemment bénignes peuvent avoir des intentions cachées et que la vigilance est essentielle pour préserver le bien-être de tous les citoyens.
-
Quand éduquer à la sexualité revient à plaquer sur les enfants et adolescents des préoccupations d'adultes
Le contexte est celui de la France mais on sait qu'il en va de même chez nous avec le processus éducatif de l'EVRAS imposé dans nos écoles.
Une tribune de Christian Flavigny relayée sur gènéthique.org :
« Education à la sexualité » : plaquer sur les enfants et les adolescents des préoccupations d’adultes
14 mars 2024Dans un texte très attendu et publié le mardi 5 mars dernier, le Conseil supérieur des programmes (CSP) préconise une « éducation à la sexualité » (cf. Education sexuelle : trois associations attaquent l’Etat en justice). Ce faisant, il confirme la confusion qui règne au ministère de l’Éducation nationale sur la place de l’école dans l’épanouissement psychoaffectif de l’enfant. Il y serait traité de la sexualité comme d’une discipline parmi d’autres, comme on rajouterait un cours de langue qui permettrait la découverte de « la langue de l’autre », sous le vertueux principe d’aider l’enfant et l’adolescent à s’affirmer dans le « respect de l’autre ». Cette démarche est une erreur, et c’est une faute.
« Trouver sa place dans la société » ?
Il s’agit d’une approche « gestionnaire » de la vie sexuelle, omettant que la sexualité est d’abord pour l’enfant un questionnement existentiel : « pourquoi y a-t-il deux sexes ? ». La réponse qu’il ébauche cherche sa réponse dans la vie familiale : il y a son papa et sa maman, dont l’union a détenu le pouvoir de faire venir au monde les enfants – il a compris qu’ils avaient jadis été petit garçon et petite fille. Son interrogation devient : « qu’est-ce donc qui les a rapprochés, faisant leur désir que je vienne, moi, entre eux, depuis eux, comme leur enfant ? »
Le CSP veut aider chacun à « trouver sa place dans la société ». Cette question est celle des jeunes adultes. Pour l’enfant, il s’agit de s’inscrire dans sa vie familiale, donc dans le lien filial qui l’unit à ses parents, depuis son vœu d’incarner les attentes qui ont porté sa venue au monde – non sans se distinguer d’elles pour affirmer sa personnalité : c’est l’enjeu psychoaffectif de l’enfance.
Le préalable à la découverte de l’autre, c’est pour l’enfant de s’établir soi-même avec confiance. C’est d’abord la relation à ces « grands Autres » que sont les parents, qui justement deviennent les parents parce qu’ils tissent le lien d’identification (« faire identique ») à leur enfant : le lien de « mêmeté » soude la vie familiale ; cela leur permet de le comprendre tout en assumant leur rôle protecteur. Cependant l’enfant rêve de devenir « grand », ce qui est pour lui devenir plus tard parent comme aujourd’hui sont ses parents. Quant à la différence des sexes, elle est tôt constatée corporellement par l’enfant (garçon ou fille) ; mais son identité sexuée se construit depuis l’appui du lien d’identification : du fils au père (transmission du masculin), de la fille à la mère (du féminin). Ce que prétend gérer le programme du CSP, la vie familiale en est le creuset.
Des préoccupations actuelles d’adultes
La sexualité ne s’enseigne pas. Elle est une découverte maturative chargée d’interrogations pour l’enfant : « et si j’avais été de l’autre sexe ? » (serais-je plus sûrement aimé d’eux ?). Ces questions animent son jeu, authentique méditation sur la vie, avec pour enjeu crucial, non pas la sexualité des adultes, mais l’amour : un mot qui s’applique autant aux relations entre adultes, les ouvrant au partage de vie sexuelle, qu’à celles entre parents et enfants, par nature désexualisées pour respecter la maturation enfantine.
Ces questions agitent l’éveil imaginaire de l’enfant : « et si … ? » Il lui faut s’approprier les réalités, celle de son corps sexué et celle des attentes de ses parents, et les concilier pour s’inscrire comme leur fils ou leur fille – conciliation parfois difficile, comme le montre le désarroi aujourd’hui dénommé « transgenre ». L’amour entre adultes est l’émotion de retrouver en l’autre cette image de « moi-même qui eus été de l’autre sexe », cette image qui avait été enfouie pour s’établir dans son sexe propre (au sens de se l’être approprié) ; l’être aimé devient son alter ego, son « autre soi-même ».
Le programme d’ « enseignement à la sexualité », recommandé par le CSP, plaque sur les enfants et les adolescents des préoccupations actuelles d’adultes. C’est embarrasser leur maturation, même en prétendant intégrer l’aspect affectif et relationnel : celui-ci relève d’une intimité que la vie collective ne peut aborder sans risquer de lui faire effraction, d’autant qu’elle en méconnaît la source psychique. Ce programme est donc une erreur. Mais c’est aussi une faute : celle de prétendre gérer ce qui ressortit de la vie familiale.
La sexualité, cela ne s’enseigne pas, cela se vit. Dans l’enfance, dans l’adolescence, cela interroge, cela se construit : qu’est-ce qui différencie, et qu’est-ce qui rapproche ? Une démarche scolaire respectueuse de l’enfant peut l’instruire sur la sexualité comme condition générale de la reproduction du vivant et peut aviser l’adolescent sur les mesures de prévention relatives au partage de vie sexuelle. Pour le reste, elle n’est pas compétente, et risque d’embarrasser la maturation psychique qui est l’enjeu délicat de leur âge.
Cette tribune de Christian Flavigny a été publiée initialement par Causeur et l’Institut Thomas More sous le titre La sexualité ne s’enseigne pas, elle se vit!.
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Jeunes, Politique, Sexualité, Société 0 commentaire -
Inscrire l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE ?
Une synthèse de presse de gènéthique.org :
Inscrire l’IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE ? Un débat au Parlement
14 mars 2024Les députés européens ont débattu ce jeudi d’une possible inscription du « droit à l’avortement » dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (cf. L’avortement dans la Charte des droits fondamentaux : une simple déclaration symbolique ?).
Quand Marie-Pierre Vedrenne, députée Renew, estime qu’il est de « notre responsabilité d’inscrire en lettres indélébiles dans la Charte des droits fondamentaux cette liberté », cette volonté ne fait pas l’unanimité. Ainsi, Isabel Benjumea, députée PPE, a par exemple accusé Emmanuel Macron de « faire preuve d’opportunisme politique pour introduire par la force la culture de la mort dans tous les Etats de l’Union ». Le président français avait en effet déjà fait part de son intention le 8 mars dernier (cf. Avortement : vers un « droit universel et effectif » ?).
Ayant « la même valeur juridique que celle des traités », modifier la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne requiert l’unanimité des 27 Etats membres. Or, plusieurs Etats n’autorisent l’avortement que dans des circonstances particulières : en cas de viol, d’inceste, lorsque la vie de la mère est en danger comme en Pologne, ou encore « dans le seul cas où la vie de la mère est en danger et où le fœtus n’est pas viable » à Malte.
Une résolution doit être soumise au vote des députés européens au mois d’avril, lors de la prochaine session plénière.
-
Moscou congratule le pape "défenseur de l'humanisme et de la paix"
Lu ICI :
Moscou salue le pape François, "défenseur de l'humanisme et de la paix"
13 mars 2024
La Russie a félicité mercredi le pape François à l'occasion du 11e anniversaire de son pontificat, saluant un « véritable défenseur de l'humanisme et de la paix », sur fond de tensions diplomatiques entre Kiev et le Vatican après que le pontife eut appelé l'Ukraine à « hisser le drapeau blanc ».
« Le pape François est un véritable et sincère défenseur de l'humanisme, de la paix et des valeurs traditionnelles », a écrit sur X l'ambassade de Russie près le Saint-Siège en assurant de ses "meilleurs voeux" le pape argentin, élu le 13 mars 2013.
L'évêque de Rome est « l'un des rares dirigeants politiques ayant un point de vue véritablement stratégique sur les problèmes mondiaux », a ajouté l'ambassade.
Ce message intervient trois jours après la diffusion d'une interview du pape François dans laquelle il appellait Kiev à « hisser un drapeau blanc et à négocier » pour mettre un terme à la guerre "avant que les choses n'empirent".
Ces propos ont provoqué une vive polémique et des tensions diplomatiques entre Rome et l'Ukraine, qui s'est indignée en accusant le pape de "légaliser le droit du plus fort", allant jusqu'à convoquer l'envoyé du Vatican.
Le Saint-Siège a cherché à corriger le tir en insistant sur le fait que la formule "drapeau blanc" signifiait ici « une cessation des hostilités » plutôt qu'une reddition. Le secrétaire d'Etat (N. 2 du Vatican), Pietro Parolin, est lui-même monté au créneau mardi pour tenter d'éteindre l'incendie.
Mercredi matin, à l'issue de son audience générale hebdomadaire, François, 87 ans, a prié pour « vaincre cette folie de la guerre, qui est toujours une défaite », sans citer nommément ni l'Ukraine, ni la Russie.
-
Les évêques de la Commission des Épiscopats de l’Union Européenne promeuvent un vote responsable encourageant les valeurs chrétiennes et le projet européen
Du site de la COMECE :
Pour un vote responsable encourageant les valeurs chrétiennes et le projet européen
Déclaration des évêques de la Commission des Épiscopats de l’Union Européenne (COMECE) en vue des élections prochaines au Parlement Européen
Nous, évêques représentant les Conférences épiscopales de l'Union européenne, appelons tous les citoyens, en particulier les catholiques, à se préparer et ensuite voter aux prochaines élections européennes de juin 2024. Le projet européen d'une Europe unie dans la diversité, forte, démocratique, libre, pacifique, prospère et juste est un projet que nous partageons et dont nous nous sentons redevables.
Nous sommes tous appelés à exprimer cet attachement en votant et en choisissant de manière responsable les députés européens qui représenteront nos valeurs et œuvreront pour le bien commun au sein du prochain Parlement européen.
Le projet d'intégration européenne est né des cendres des terribles guerres qui ont dévasté notre continent au siècle dernier, causant de grandes souffrances, apportant mort et destructions. Il a été conçu dans l'intention de garantir la paix, la liberté et la prospérité. Il a vu le jour grâce au courage et à la clairvoyance de personnes qui ont su surmonter les antagonismes historiques et créer quelque chose de nouveau qui rendrait la guerre pratiquement impossible sur notre continent à l'avenir. Au départ, ce projet était économique, mais il comportait également une dimension sociale et politique et des valeurs partagées. Bon nombre des pères fondateurs de l'Union européenne étaient des catholiques engagés qui croyaient fermement en la dignité de chaque être humain et en l'importance de la communauté. Nous pensons que ce projet, initié il y a plus de 70 ans, doit être soutenu et poursuivi.
Aujourd'hui, l'Europe et l'Union européenne sont confrontées à des temps difficiles et incertains, marqués, ces dernières années, par une série de crises et des questions délicates à résoudre dans un avenir proche, comme les guerres en Europe et dans son voisinage, les migrations et l'asile, le changement climatique, la digitalisation croissante et l'utilisation de l'intelligence artificielle, le nouveau rôle de l'Europe dans le monde, l'élargissement de l'Union européenne et la modification des Traités, etc. Pour aborder ces questions cruciales à la lumière des valeurs fondatrices de l'Union européenne et pour construire un avenir meilleur pour nous et les générations futures, non seulement en Europe mais aussi dans le monde, nous avons besoin de décideurs politiques courageux, compétents, animés par des valeurs et œuvrant avec honnêteté pour le bien commun. Il est de notre responsabilité de faire le meilleur choix possible lors des prochaines élections.
En tant que chrétiens, nous devons essayer de discerner pour qui et pour quel parti voter en ces temps cruciaux pour l'avenir de l'Union européenne. Nous devons donc tenir compte de facteurs variant parfois d'un pays à l'autre - par exemple, la possibilité de voter pour des candidats ou seulement des partis, les programmes électoraux des différents partis, les candidats eux-mêmes... Sur ces questions, les Conférences épiscopales de chaque État membre peuvent également offrir des orientations utiles. En outre, il est essentiel que nous votions pour des personnes et des partis qui soutiennent clairement le projet européen et dont nous pensons raisonnablement qu'ils vont promouvoir nos valeurs et notre idée de l'Europe, telles que le respect et la promotion de la dignité de toute personne humaine, la solidarité, l'égalité, la famille et le caractère sacré de la vie, la démocratie, la liberté, la subsidiarité, le soin de notre “maison commune“...
-
Le Congrès Mission commence ce vendredi 15 mars!

Le Congrès Mission commence ce vendredi 15 mars!
Il est temps pour nous de vous donner les derniers détails pratiques de ce weekend exceptionnel. Lisez-bien ce message, vous y trouverez une quantité d'informations:
- Les horaires et les points d'accueil
- Le plan et le programme à télécharger
- Les informations relatives aux plénières et aux messes
- Les informations relatives aux transports
- Les informations relatives à la restauration
- Les temps d'adoration et de confession
Les ouvriers de la dernière heure étant récompensés aussi largement que les autres, il est encore temps de nous aider en devenant volontaires! <img class="an1" draggable="false" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f607/32.png" alt="