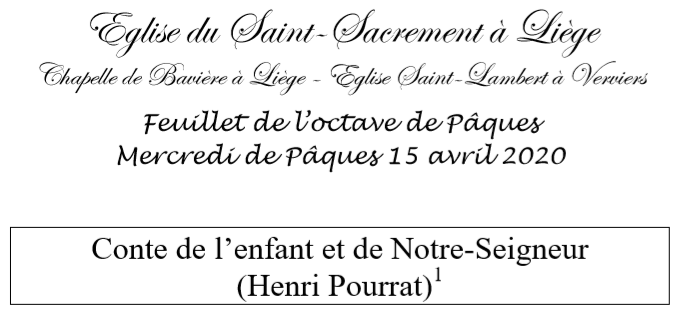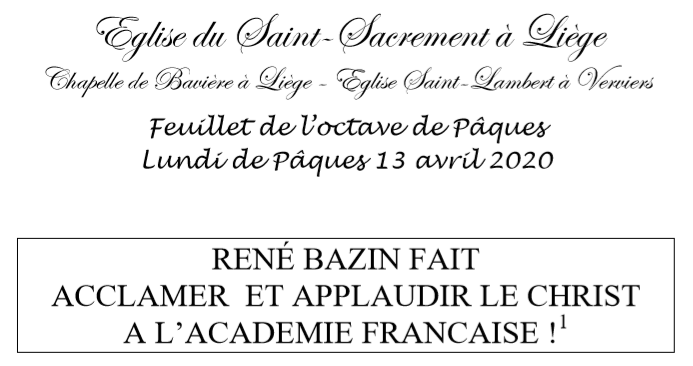Du site de La Nef :

Débat Poulat-Madiran : du modernisme à la crise dans l’Église
Nous publions ici un débat enregistré début 2011 entre le journaliste et chroniqueur Jean Madiran (1920-2013) et l’historien et sociologue Émile Poulat (1920-2014), deux témoins de plus d’un demi-siècle de la vie de l’Église. L’un et l’autre ont écrit sur les rapports entre l’Église et la modernité. Une confrontation de ces deux esprits qui ont marqué leur époque n’avait jamais été faite.
La Nef – Commençons notre débat avec la crise moderniste : qu’est-elle exactement et quelle est l’importance du modernisme dans l’histoire contemporaine de l’Eglise ?
Emile Poulat – La crise moderniste est un fait essentiel de l’histoire de l’Eglise et je m’élève sans arrêt contre le silence qui est fait autour d’elle et contre le fait qu’elle n’est pas intégrée par la culture catholique, que ce soit dans le clergé ou dans le laïcat. L’avènement de la IIIe République est dans cette affaire un événement majeur avec l’imposition, durant 25 ans environ, de 1880 à 1905, des lois laïques qui développent une culture laïque. Laïcité et modernisme sont donc deux événements inséparables qui ont pourtant été vécus de manière assez séparée et cloisonnée. Il semblait que la séparation des Eglises et de l’Etat relevait des politiques et la crise moderniste des théologiens : en réalité nous sommes en face d’une totalité inséparable.
La Nef – Quel lien y a-t-il entre ces deux événements ? Et quelle définition donneriez-vous à la crise moderniste ?
Emile Poulat – Le « modernisme », c’est le conflit de deux cultures, d’une part une culture laïque telle qu’elle s’est développée depuis le début du XVIIIe siècle, depuis les Lumières, et d’autre part la culture catholique traditionnelle. On n’a pas mesuré la violence de ce conflit, ni ses raisons profondes qui sont de deux ordres : d’une part la culture laïque, par définition, ignore le surnaturel, ignore par conséquent ce qui est proprement, spécifiquement religieux et d’autre part, devant sa nouveauté, il y a une sorte de retard dans la culture catholique, dans la mesure où elle ne se tient pas au courant des développements de la nouvelle exégèse et des nouvelles méthodes scientifiques historiques. Prenons l’exemple de la Santa Casa de Lorette, la maison où « le Verbe s’est fait chair » : d’après la tradition catholique de cette époque, cette Santa Casa a été transportée par le ministère des anges par la voie des airs pour se déplacer de Nazareth à Lorette. Quelle place tient aujourd’hui cette conviction ? Plus personne ne l’enseigne, même au Saint-Siège où l’on considère la Santa Casa comme un lieu de pieuse dévotion mais sans fondement historique. Ça a été à l’époque, un des hauts lieux de la crise, même si on l’a limité trop souvent à des problèmes d’exégèse.
Jean Madiran – Mais vous n’avez pas dit en quoi consistait le modernisme.
Emile Poulat – Dans ma pensée, la première crise moderniste dans le champs des sciences historiques, remonte à Dom Guéranger dans son livre, Essai sur le naturalisme contemporain (1856). Le restaurateur de Solesmes s’y oppose au prince Albert de Broglie, auteur d’un magnifique ouvrage en quatre volumes sur L’Eglise et l’Empire romain au IVe siècle, où il explique comment l’Empire romain s’est converti au christianisme. En bon historien, il en étudie les causes secondes et Dom Guéranger lui répond que la conversion n’est pas affaire de causes secondes mais de la grâce. Vous avez là le conflit entre deux types de cultures, l’une qui fait référence au surnaturel, qui l’intègre dans son analyse, et l’autre qui entend s’en passer en demeurant strictement au niveau de l’analyse rationnelle. Nous allons avoir la même chose avec la nouvelle exégèse – en particulier avec Alfred Loisy pour les Evangiles ou le père Lagrange et l’Ecole biblique de Jérusalem. La Bible est alors examinée scientifiquement comme un texte ordinaire, elle n’est plus lue spirituellement mais comme un texte historique : on naturalise la Bible. Le mot-clef du modernisme, c’est le naturalisme et ses problèmes dont on n’est toujours pas sorti. On y verra certes plus clair le jour où le père de Lubac rappellera que l’Ecriture a toujours eu plusieurs sens pour les auteurs du Moyen-Age, mais le conflit est irréductible entre une interprétation qui se veut strictement positive et une autre qui invoque d’abord la Révélation, sans rejeter au demeurant les méthodes historico-critiques, comme le père Lagrange l’a fait.
Jean Madiran – On n’en est pas sorti parce que cette question se posera toujours. Je suis très heureux que vous ayez parlé des causes secondes et de la cause première, mais il est très difficile aujourd’hui de faire comprendre aux gens cette simple vérité philosophique que l’existence de causes secondes ne supprime pas l’existence de la cause première et que l’existence de la cause première ne supprime pas l’existence des causes secondes. Le développement des études sur les causes secondes n’a pas qualité pour juger la réalité de la cause première.
Pour la foi de l’Eglise, le modernisme est un phénomène absolument scandaleux qui explique très bien que le pape Pie X ait pris des mesures extrêmement combatives et fait une encyclique très sévère, entourée, préparée et suivie de diverses mesures disciplinaires, parce qu’il y va de l’essentiel. S’il ne peut rester de la religion chrétienne que ce que les sciences de la matière admettent, alors il ne reste rien, puisque les sciences de la matière ne connaissent que la matière : le modernisme est ce scandale. Or la religion catholique enseigne, comme dit Dom Guéranger, que la foi – donc la conversion – est un don de Dieu.
Aujourd’hui on ne veut plus parler du modernisme. Seule en parle encore l’école contre-révolutionnaire. On subit une sorte de tabou officiel qui fait que les héritiers du modernisme ne veulent pas qu’on en parle sous ce nom. La différence entre le modernisme historique, dont vous êtes l’historien éminent, et le modernisme d’aujourd’hui, c’est que celui de la fin du XIXe, début XXe, n’atteint absolument pas les catholiques. Ce sont des contestations entre gens très savants dont la science formera peu à peu des professeurs et toute une culture, mais l’ensemble de la culture chrétienne, la vie des paroisses ou celle des séminaires ne sont guère concernés par le modernisme. Aujourd’hui la maladie s’est répandue partout ; tous les débats supposés ou réellement théologiques ou scientifiques sont à la portée de tous, tout le monde en parle. Maritain, à la sortie du Concile, pour ne citer que lui, a parlé du modernisme originel pour dire, dans une formule un peu exagérée, que ce modernisme était un léger rhume des foins en comparaison à celui de la seconde moitié du XXe siècle.
Lire la suite sur le site de La Nef