Hier, on pouvait lire sur lalibre.be :
"En 2012, le géant californien Google a engagé comme ingénieur en chef Ray Kurzweil, cerveau en matière d’intelligence artificielle. Connu comme promoteur du transhumanisme, il est le pape de la "singularité". Sa thèse : "dès 2045 l’intelligence artificielle dépassera celle de l’humain". Son rêve : faire reculer la mort, et notamment, améliorer le cerveau humain grâce aux implants et aux ordinateurs, et même le rendre immortel en "versant" (uploader) l’intelligence humaine, le contenu d’un cerveau, dans un ordinateur."
Au même moment, sur "Paris Notre-Dame", sous le titre : "Transhumanisme : vers le meilleur des mondes ?" paraissait une interview de Jean-Guilhem Xerri, biologiste médical des hôpitaux, conférencier, blogueur et auteur d’articles et d’ouvrages dont "Le soin dans tous ses états" (Éd. DDB).
P. N.-D. – Le bulletin du Secrétariat général de la Conférence des évêques de France (CEF) de septembre dernier portait sur Le transhumanisme, ou quand la science–fiction devient réalité [1]. Vous en êtes l’auteur. Comment définissez-vous ce terme ?
Jean-Guilhem Xerri – Le transhumanisme est une philosophie qui vise à transformer la nature humaine en s’appuyant sur la technologie. Le début du mouvement transhumaniste remonte aux années 1980 et regroupe des philosophes, scientifiques, mathématiciens et informaticiens, représentés par l’Association internationale de transhumanisme (WTA). L’idée de départ, c’est le constat que la nature humaine est ratée puisque nous tombons malades, vieillissons et mourons. Qu’il faut donc transformer cette humanité. Cette philosophie s’appuie sur quatre techniques qui, après avoir explosé au vingtième siècle, sont devenues suffisamment matures pour converger et devenir très puissantes : les nanotechnologies, les biotechnologies, l’intelligence artificielle et les sciences cognitives. Le transhumanisme passe par trois étapes : l’« homme réparé » d’abord, qui bénéficie de greffes, prothèses ou exosquelettes [2], l’« homme augmenté » ensuite, dont les performances physiques et mentales sont décuplées, puis l’« homme transformé » : un homme-robot qui vivra plus longtemps, voire ne mourra pas, si l’on en croit les prophéties des transhumanistes.
P. N.-D. – Qu’est-ce que le transhumanisme reflète de notre société ?
J.-G. X. – C’est le symptôme d’un certain pessimisme, d’une désespérance actuelle sur le sens de la nature humaine. Si le progrès médical qui fait partie de cette philosophie est une bonne chose, le transhumanisme est une spiritualité matérialiste qui ne reconnaît pas l’existence de l’âme au sens chrétien du terme. Leurs penseurs ambitionnent de repousser nos limites biologiques. Ils parlent d’« immortalité numérique » : l’on pourrait transférer les données d’un cerveau dans une machine (on en sera bientôt capable) et pourquoi pas, les transférer à une autre personne. Certes, depuis la Genèse, l’humanité est appelée à une transformation : devenir à la ressemblance de Dieu. Mais cette transformation doit s’effectuer par la grâce, non par la technologie. En fait, le transhumanisme révèle une crise de l’intériorité. Tout cela nous incite à nous interroger sur notre identité profonde.
P. N.-D. - Que pouvons-nous faire face à ces dérives ?
J.-G. X. – Il faut que les intellectuels chrétiens s’emparent dès aujourd’hui du sujet, qu’ils se documentent, qu’ils discernent les enjeux éthiques qui s’y cachent, qu’ils découvrent ses acteurs. Il faut savoir que les transhumanistes font partie des personnes les plus influentes de la planète. Ils sont au cœur de la Silicon Valley, chez Google, Yahoo, à la Nasa, au Pentagone. Ils ont donc des moyens financiers, de l’influence et un pouvoir considérables. Les chrétiens arrivent parfois trop tard en ce qui concerne les questions de bioéthique. Il faut cette fois-ci prendre les devants. Nous avons vingt-cinq ans environ devant nous. • Propos recueillis par Agnès de Gélis
[1] Pour vous procurer ce livret, téléchargez le bon de commande à partir de www.eglise.catholique.fr. 5 €. Tél. : 01 72 36 68 52.
[2] Structure mécanique extérieure au corps qui améliore ses capacités physiques.
Cet article est extrait de Paris Notre-Dame du 30 janvier 2014.
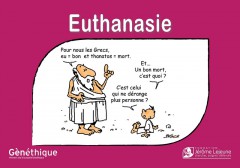
 Ce manuel est structuré autour de cinq parties :
Ce manuel est structuré autour de cinq parties :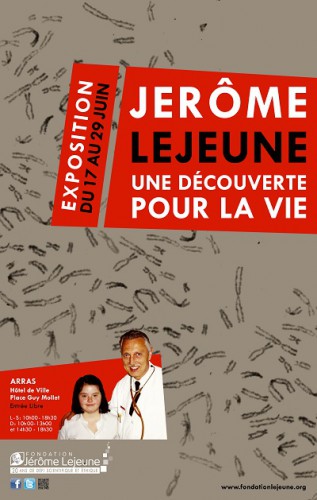 "Jérôme Lejeune, une découverte pour la vie"
"Jérôme Lejeune, une découverte pour la vie"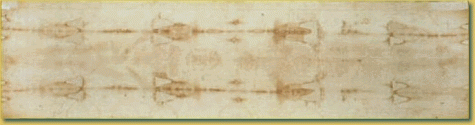 Lu
Lu  Notre ami Ludovic Werpin a rencontré Marcel Otte qui lui a accordé un entretien autour de son livre "A l'aube spirituelle de l'humanité" (2012).
Notre ami Ludovic Werpin a rencontré Marcel Otte qui lui a accordé un entretien autour de son livre "A l'aube spirituelle de l'humanité" (2012).