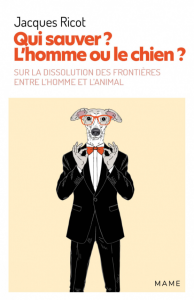De la Nuova Bussola Quotidiana :
Plongés dans la peur, la foi nous libère de l'esclavage
24-10-2021
"La culture occidentale vit dans la peur parce qu'elle a déraciné la foi. Le Covid nous a fait découvrir que "le roi est nu" et l'homme, après avoir abandonné Dieu, s'est retrouvé sans repères et regarde l'avenir avec crainte. Dans cette fragilité, l'homme sent que son cœur a besoin d'aller plus loin car le don de la vie biologique ne suffit pas à satisfaire le désir de plénitude. La foi est le secret qui nous libère du non-sens, nous permettant de découvrir le sens ultime de notre existence et de celle du monde, nous ouvrant à un avenir d'éternité.
Nous publions ci-dessous la lectio magistralis prononcée par l'évêque émérite de Carpi, Monseigneur Francesco Cavina, lors de la Journée de la Nuova Bussola Quotidiana qui s'est tenue hier à Palazzolo sull'Oglio dans la Communauté Shalom.

...Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la peur...
La peur et la confiance sont les moyens par lesquels nous nous rapportons à la réalité. La peur nous amène à voir dans la réalité, et donc aussi en Dieu, une menace, quelque chose ou quelqu'un qui peut nous nuire ou diminuer notre humanité, par exemple, un ennemi, une maladie, des événements défavorables. La confiance, en revanche, voit dans la réalité un cadeau qui est bon pour notre vie et, par conséquent, qui nous fait grandir.
La culture occidentale, dans laquelle nous sommes immergés, vit dans la peur car elle a éradiqué la foi du cœur humain. Pour y parvenir, il a suivi la voie de l'athéisme pratique, proposant une conception de l'homme et une vision de la vie dépourvue de toute référence à la transcendance. L'homme - tel est le message véhiculé de manière obsessionnelle au cours des dernières décennies - est devenu adulte parce que la médecine, la science, la technologie et l'économie peuvent tout expliquer et répondre aux besoins de l'homme. Dieu n'est donc plus d'aucune utilité et, s'il a jamais existé, sa présence n'est pas pertinente dans la vie des gens et de la société dans son ensemble. C'est ainsi que l'homme a été convaincu - malgré des démentis constants - qu'il pouvait construire son paradis sur terre.
Le COVID A RÉVÉLÉ UNE FRAGILITÉ
Cette vision de l'homme comme seul auteur de son propre destin a été mise en crise par un événement imprévu qui a bouleversé l'humanité entière et, avouons-le, l'Église elle-même : covid. Ce virus invisible nous a fait découvrir que "le roi est nu". C'est-à-dire que l'homme, après avoir abandonné Dieu, s'est retrouvé encore plus seul car la confiance dans la science - bien que les médias nous aient abreuvés ad nauseam de : "Je crois en la science" - est entrée dans une crise majeure en raison de la diversité des positions des soi-disant experts. Chaque scientifique a sa théorie sur la façon de sortir de la pandémie ; chaque médecin son remède... Qui croire ? A qui faire confiance ? Qui écouter quand chacun crie sa propre vérité et se moque de ceux qui pensent différemment ? C'est ainsi que l'humanité s'est retrouvée sans repères et qu'elle regarde son avenir avec crainte. Et si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir honnêtement, seul un aveugle ne peut reconnaître que nous vivons dans une culture largement dominée par la mort. Cette culture de mort se manifeste, par exemple, par la consommation effrénée de drogues, le mensonge, l'injustice, le mépris des autres et de la solidarité ; elle s'exprime par une sexualité réduite à la pure recherche du plaisir et qui a réduit l'homme à un objet.