Du National Catholic Register (Bree A. Dail) :
D'un journaliste catholique chinois en exil : Les croyants chinois ont besoin d'aide !
En réponse aux récents commentaires du Cardinal Parolin qui semblaient minimiser l'existence de la persécution chrétienne, Dalù déclare que la persécution est en fait un terme trop doux pour la situation actuelle désastreuse en Chine.

Les catholiques se réunissent pour prier le chapelet, y compris l'évêque Ma Daquin de Shanghai.
Interview
17 novembre 2020
Un journaliste, lanceur d'alerte et réfugié politique chinois a critiqué le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, pour ce que l'exilé chinois considère comme une attitude dédaigneuse à l'égard des persécutions actuelles en Chine. Le journaliste chinois Dalù répliquait à une interview du cardinal Parolin accordée au journal italien La Stampa, réalisée quelques jours avant que le Vatican ne renouvelle son accord avec la Chine le mois dernier.
Dalù s'est adressé au Register le 27 octobre, Journée internationale de la liberté religieuse. Dans cette interview, il a mis en avant la question posée par le journaliste de La Stampa Vatican au cardinal Parolin sur la persécution continue des chrétiens en Chine, malgré l'accord sino-Vatican signé en 2018, auquel le secrétaire d'État du Vatican a répondu : "mais les persécutions, les persécutions ... Il faut utiliser les mots correctement".
Les paroles du cardinal ont choqué Dalù, qui a reçu le statut de réfugié politique en Italie en 2019 après avoir défié le Parti Communiste Chinois, et l'ont amené à conclure : "Les commentaires du Cardinal Parolin peuvent avoir un sens. Le terme "persécution" n'est pas assez précis ou fort pour décrire la situation actuelle. En fait, les autorités du PCC ont réalisé que la persécution des religions nécessite des méthodes nouvelles et innovantes pour éviter une forte réaction du monde extérieur".
Originaire de Shanghai, Dalù a été l'un des journalistes les plus populaires des médias chinois avant de réaliser en 1995 un reportage visant à exposer la vérité sur le massacre de la place Tiananmen à ses auditeurs de radio, malgré la tentative du gouvernement chinois de contrôler le récit de l'événement. Dalù s'est converti au catholicisme en 2010, ce qui, selon lui, a renforcé l'hostilité du Parti communiste chinois à son égard. Puis, en 2012, après l'arrestation de l'évêque Ma Daquin du diocèse de Shanghai, Dalù a utilisé les médias sociaux pour demander avec insistance la libération de l'évêque, ce qui a finalement conduit à l'interrogatoire et à la persécution du journaliste.
Dalù a reçu le statut légal de réfugié politique en Italie en 2019. L'interview suivante a été publiée dans un souci de clarification et d'approfondissement.


 Les pasteurs ne sauraient empêcher les fidèles laïcs de prendre des initiatives citoyennes, sinon ce serait du cléricalisme. Lu sur le site web « Riposte catholique » cet extrait
Les pasteurs ne sauraient empêcher les fidèles laïcs de prendre des initiatives citoyennes, sinon ce serait du cléricalisme. Lu sur le site web « Riposte catholique » cet extrait 
 Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus.
Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus.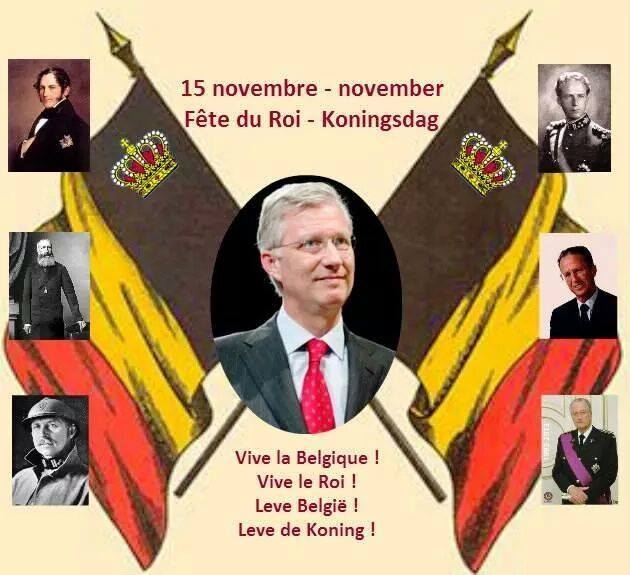
 Emission du 14 novembre sur RCF à propos des manifestations demandant la restauration de la liberté de culte et du maintien de l’instruction religieuse pendant le confinement :
Emission du 14 novembre sur RCF à propos des manifestations demandant la restauration de la liberté de culte et du maintien de l’instruction religieuse pendant le confinement : 