Lu sur le site Aleteia (extrait) :
 « (...) La Bibliothèque des auteurs chrétiens (BAC) vient de publier “L’espérance de la famille”, un petit livre sous forme de dialogue avec le Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Cardinal Gerhard-Ludwing Müller.
« (...) La Bibliothèque des auteurs chrétiens (BAC) vient de publier “L’espérance de la famille”, un petit livre sous forme de dialogue avec le Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Cardinal Gerhard-Ludwing Müller.
Dans le livre, une longue interview du cardinal par le directeur général de la BAC, P. Carlos Granados, le mois de juin dernier à Rome. Le texte, revu par le cardinal Müller lui-même, revêt un intérêt particulier en ce moment, à quelques mois des deux synodes sur la famille; le premier, de caractère extraordinaire, convoqué par le pape François, aura lieu du 5 au 19 octobre 2014, sur le thème« Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation » .
Dans la préface de l’ouvrage, le P. Granados explique lui-même que l’idée de ce dialogue « est née d’un souci pastoral de rendre plus compréhensible aux fidèles chrétiens le sens de ce qui est commenté ces jours-ci sur le prochain Synode. Les paroles du Préfet pour la Doctrine de la foi éclairent le cadre dans lequel émergent les points d’interrogation d’aujourd’hui sur la famille ».
La présentation du livre est du cardinal Fernando Sebastián Aguilar, qui affirme que le cardinal Müller nous rend ici un grand service, en nous proposant dans cet ouvrage des idées et des suggestions pour repenser en profondeur et avec sérénité des questions sur la famille, au sein de la tradition et de la communion de l’Eglise.
« Le problème principal que nous avons dans l’Eglise concernant la famille ne réside pas tant dans le petit nombre des divorcés remariés désireux de s’approcher de la communion eucharistique, souligne le cardinal Sebastián. Le grand nombre de baptisés qui se marient civilement et le grand nombre des baptisés et mariés sacramentellement qui ne vivent pas leur mariage ni leur vie matrimoniale en conformité avec la vie chrétienne et les enseignements de l’Eglise, voilà le problème."
"Selon moi, répond le cardinal Müller à une question qui lui est posée dans ce livre que publie la BAC, l’objectif principal du prochain Synode devrait être de favoriser la ‘récupération’ de l’idée sacramentelle du mariage et de la famille, en insufflant aux jeunes qui sont disposés à entamer un chemin conjugal, ou à ceux qui sont déjà dedans, le courage dont ils ont besoin. Au fond, il s’agit de leur dire qu’ils ne sont pas seuls sur ce chemin, que l’Eglise, toujours mère, les accompagne et les accompagnera."
Le Cardinal Müller
Gerhard Ludwing Müller ( Mayence, Allemagne, 31-12-1947), cardinal de Ratisbonne, est depuis juillet 2012 préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, de la Commission théologique internationale et de la Commission pontificale biblique. Durant seize ans, il a enseigné la théologie dogmatique à l’Université Ludwing-Maxilian de Munich et a été chargé de la publication en allemand des œuvres complètes (16 volumes) de Joseph Ratzinger, le Pape Benoît XVI.
sources:
On ne vit pas le mariage chrétien, voilà le problème majeur de la famille!
JPSC
 « (…) Comme blogueurs catholiques, nous sommes souvent nostalgiques dans notre souvenir du règne de Benoît XVI, à cause de la sûreté avec laquelle Benoît gouvernait l'Église. Sous Benoît XVI, il n'a jamais été envisageable qu'un article de foi ou de doctrine transmis par lui puisse être de quelque façon «peu sûrs». La conviction claire de Benoît XVI, avant, pendant et après sa démission, était que la vérité allait gagner et que le Chef de l'Eglise catholique a été et est Notre Seigneur Jésus-Christ qui garde l'Eglise et sera avec l'Eglise jusqu'à la fin des temps, La nourrissant en temps de trouble et de persécution ou en temps de paix et de liberté.
« (…) Comme blogueurs catholiques, nous sommes souvent nostalgiques dans notre souvenir du règne de Benoît XVI, à cause de la sûreté avec laquelle Benoît gouvernait l'Église. Sous Benoît XVI, il n'a jamais été envisageable qu'un article de foi ou de doctrine transmis par lui puisse être de quelque façon «peu sûrs». La conviction claire de Benoît XVI, avant, pendant et après sa démission, était que la vérité allait gagner et que le Chef de l'Eglise catholique a été et est Notre Seigneur Jésus-Christ qui garde l'Eglise et sera avec l'Eglise jusqu'à la fin des temps, La nourrissant en temps de trouble et de persécution ou en temps de paix et de liberté.  Mgr Gaucher est une haute figure de la spiritualité carmélitaine en France. Né le 5 mars 1930, il est mort à Carpentras le 3 juillet 2014. Après avoir été vicaire de la paroisse Sainte-Claire à Paris de 1962 à 1964, Mgr Guy Gaucher fut aumônier d’étudiants de La Sorbonne au Centre Richelieu jusqu’en 1967, date à laquelle il entra au Noviciat des Pères Carmes où il fit profession religieuse le 1er octobre 1972. Il a été professeur de spiritualité au Séminaire d’Orléans de 1980 à 1984 et chargé de cours à l’Institut Catholique de Paris, tout en étant maître des étudiants Carmes de 1985 à 1986.
Mgr Gaucher est une haute figure de la spiritualité carmélitaine en France. Né le 5 mars 1930, il est mort à Carpentras le 3 juillet 2014. Après avoir été vicaire de la paroisse Sainte-Claire à Paris de 1962 à 1964, Mgr Guy Gaucher fut aumônier d’étudiants de La Sorbonne au Centre Richelieu jusqu’en 1967, date à laquelle il entra au Noviciat des Pères Carmes où il fit profession religieuse le 1er octobre 1972. Il a été professeur de spiritualité au Séminaire d’Orléans de 1980 à 1984 et chargé de cours à l’Institut Catholique de Paris, tout en étant maître des étudiants Carmes de 1985 à 1986.
 Comment accepter de recevoir d’un autre son identité ? Comment penser l’identité et l’altérité comme des limites créatrices ? De Thibaud Collin, philosophe, membre du conseil éditorial de Liberté politique (Dernier ouvrage paru :
Comment accepter de recevoir d’un autre son identité ? Comment penser l’identité et l’altérité comme des limites créatrices ? De Thibaud Collin, philosophe, membre du conseil éditorial de Liberté politique (Dernier ouvrage paru : 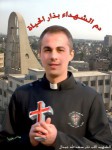 AED : votre Excellence, craignez-vous la fin de la chrétienté en Irak ?
AED : votre Excellence, craignez-vous la fin de la chrétienté en Irak ?