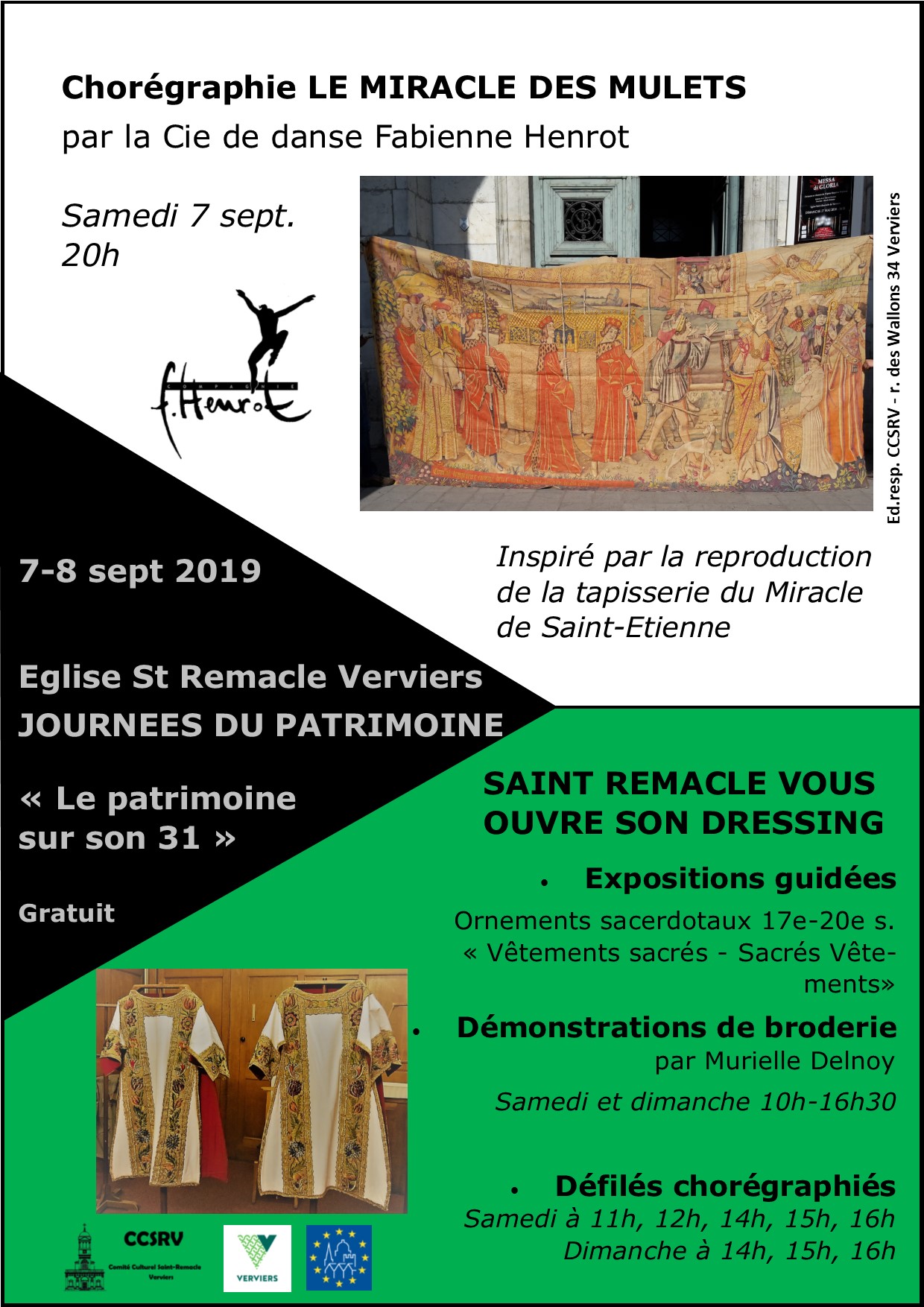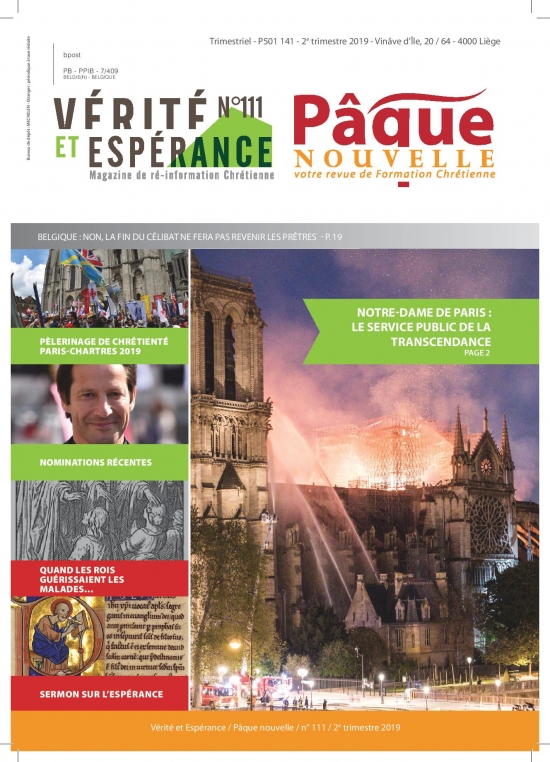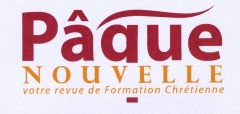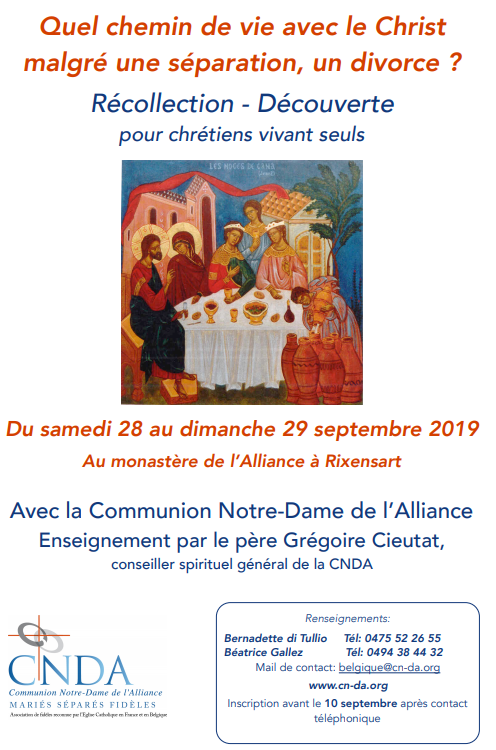De Jacques Hermans sur le site de la Libre :
En Flandre, le cours de religion divise laïcs et catholiques
La N-VA veut remplacer une heure de religion par une heure de néerlandais. L’émoi est vif.
Le temps où les "petits vicaires" de campagne militaient pour la cause flamande auprès de leurs paroissiens est révolu. La N-VA ne peut plus compter aujourd’hui sur ces bons petits soldats prêchant l’émancipation de la Flandre. Le parti nationaliste n’apprécie pas trop le "virage à gauche" de l’Église flamande devenue minoritaire aujourd’hui, ni celui de sa puissante coupole fédérant l’enseignement catholique sise rue Guimard.
La N-VA continue vaille que vaille de manier la croix et la bannière pour mettre en exergue sa propre culture, fondée sur des valeurs chrétiennes. Mais un fossé se creuse aujourd’hui parmi les nationalistes entre ceux qui défendent les valeurs chrétiennes et "les indifférents". Divisée, la N-VA commence à se rendre compte qu’à travers tous ces débats idéologiques elle se met à dos une partie - non négligeable - de son électorat.
Une pétition en cours
Ce qui oppose catholiques et laïcs jusqu’au sein même du parti, c’est le cours de religion qui pourrait passer de deux heures à une heure par semaine dans le secondaire. La N-VA propose en effet concrètement de remplacer dans les écoles une heure de religion par une heure de… néerlandais. Ce changement de cap symbolique fait des vagues en Flandre. Dans les écoles catholiques, les professeurs de religion ont lancé une pétition sur le site Thomas. (www.godsdienstonderwijs.be).
Dans le même esprit, Mgr Johan Bonny, l’évêque référendaire en charge de l’Enseignement catholique en Flandre, a mis l’accent sur l’importance du maintien des deux heures de religion ou de philosophie, qui ont toute leur importance "dans un monde où le vivre-ensemble et la recherche du sens sont essentiels aussi bien pour l’élève que pour la société".
Certains voient dans cette proposition une revanche de la N-VA sur les tjeven, "les cathos" de la rue Guimard. Il y a un an, la fédération Katholiek Onderwijs Vlaanderen avait proposé de remplacer une heure de néerlandais par une heure de "citoyenneté". La N-VA s’était étranglée. Elle n’avait pas davantage digéré le projet "Dialoogschool", initiative de la fédération.
Cette "école du dialogue" a pour but de promouvoir l’interculturalité et le vivre-ensemble dans un esprit de tolérance. En particulier, le cours de religion, affirment certains, tire sa légitimité de ce qu’il forme les élèves à mieux comprendre les défis de notre société multiculturelle. Les nationalistes ont hurlé car ils veulent au contraire que l’école mette l’accent sur l’apprentissage des fondamentaux du christianisme, ce qui correspond à leur volonté "de mieux connaître les racines de la civilisation occidentale, qui est à la base de l’identité flamande". Alimentent-ils dès lors le débat antireligieux pour recentrer le discours sur l’identité flamande ?
Le front des laïcs
La N-VA semble pour l’heure vouloir maintenir son cap. Jusqu’à nouvel ordre ? Surfant sur la même vague laïque et individualiste que celle de l’Open VLD, les nationalistes recherchent toujours cette denrée rare, "ce puissant antidote contre l’islam".
Un front commun avec les libéraux flamands est-il en train de se former ? En tout cas, l’Open VLD rêve de laïciser l’enseignement et préconise de remplacer l’une des deux heures de religion par une heure d’éducation à la citoyenneté, comme dans l’enseignement officiel francophone. Un choix défendu par l’enseignement officiel (Gemeenschapsonderwijs, GO).
Les libéraux flamands ne sont pas mécontents d’avoir trouvé un allié de circonstance en la personne de… Bart De Wever, qui, à plusieurs reprises, s’est pourtant montré soucieux de "combattre l’inculture religieuse en Flandre". Au journaliste Luc Alloo, il avait affirmé, le 17 mars dernier, (donc avant les élections), que "les valeurs chrétiennes font partie de notre culture occidentale" et qu’il n’avait "personnellement pas l’intention de renier la religion dans laquelle il avait été élevé". Pourtant, dans son livre Over identiteit (paru en avril dernier), le président de la N-VA écrit que "la religion catholique a perdu son sens dans notre société d’aujourd’hui". Il ajoute que "les vieilles traditions catholiques ne sont plus que… folklore", des propos qui lui ont valu de vives critiques dans les milieux catholiques traditionnels.
Dans ce débat symbolique, le CD&V, en pleine crise existentielle, se mure dans un silence assourdissant. Il peine à prendre position tant les problèmes à l’intérieur du parti sont nombreux à gérer. Et cela commence à se voir. "Ce qui est sûr, c’est que le CD&V n’a obtenu que 15 % des suffrages et, maintenant, en faisant profil bas sur cette question essentielle, on peut dire qu’ils sont en train de perdre leur âme et leur identité chrétienne", affirme Didier Pollefeyt, professeur de théologie à la KULeuven.