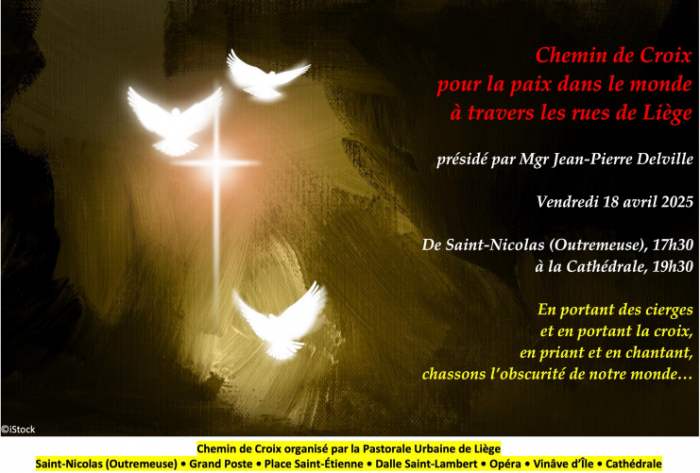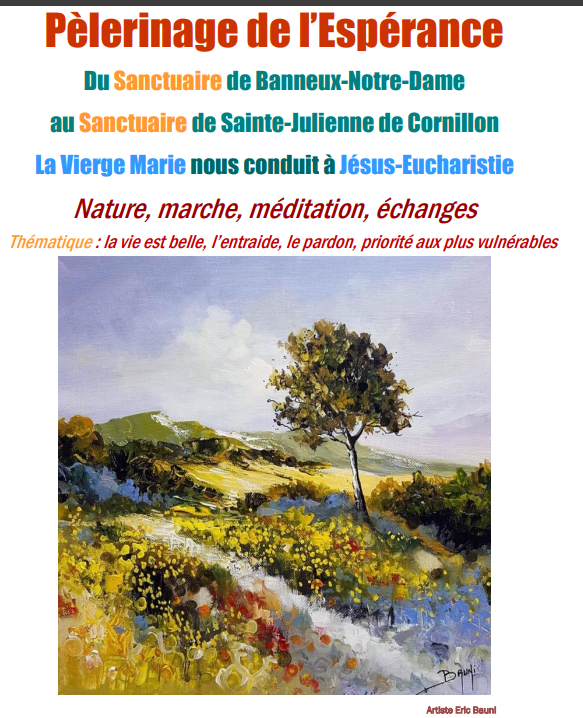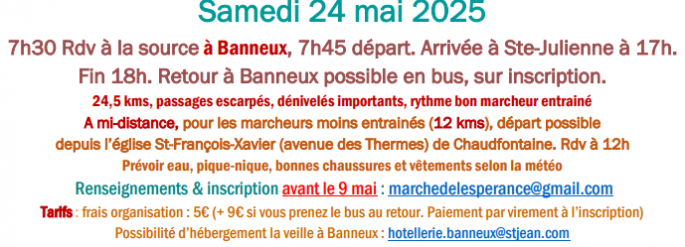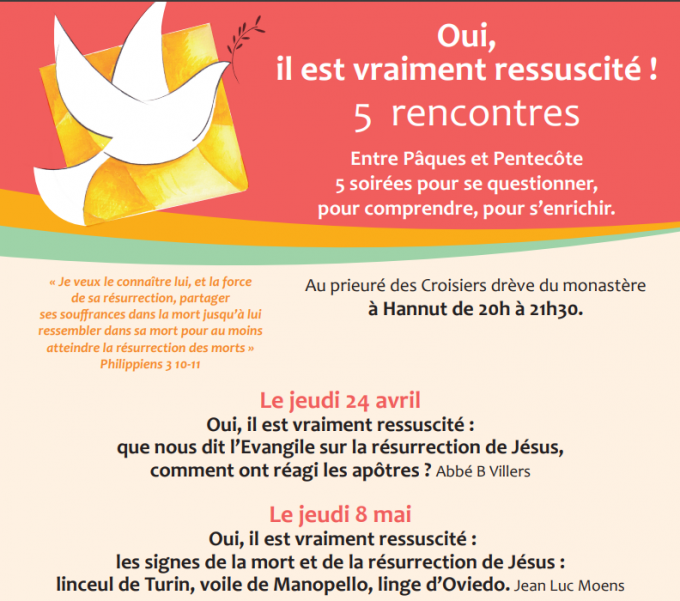Communiqué de presse

Avec une augmentation de +64% des recherches pour le mercredi des Cendres, Egliseinfo.be, la première start-up catho, recense plus de 4.000 célébrations de Pâques en Belgique francophone
Liège, le 10 avril 2025.
Egliseinfo.be, le GPS des clochers en Belgique francophone, annonce que sa plateforme internet collaborative et gratuite propose plus de 4.000 offices et messes de la semaine Sainte et de Pâques 2025. Cela concerne 350 unités pastorales, les aumôneries d'hôpitaux et toutes les abbayes de Belgique francophone regroupant plus de 2.500 clochers. Ces célébrations de Pâques rassemblent des centaines de milliers de belges.
+64% de recherches d’horaires des messes du Mercredi des Cendres

La plateforme, lancée à Pâques 2014, observe une croissance continue des recherches des horaires de messes. En particulier, egliseinfo.be a connu une croissance de +64% du nombre de recherches de la célébration du mercredi des cendres 2025.
Cette célébration marque le début des 40 jours du carême qui mènent à Pâques. Le célébrant marque le front des participants d’une croix à partir de cendres. Le sens de cette imposition est une évocation symbolique de la mort, un appel à la conversion, un symbole de renaissance, une image de la pauvreté de l'être humain et le signe de la miséricorde de Dieu.
Curé de l’Unité Pastorale Sainte-Croix et du pôle Jeunes XL à Ixelles-Flagey, l’abbé Emmanuel de Ruyver témoigne : « pour le mercredi des Cendres, nos 3 messes ont rassemblé environ 1.000 participants, soit +65% par rapport à 2024. C’est intéressant. Par ailleurs, beaucoup de jeunes fréquentent notre messe des jeunes du mercredi soir à Flagey. Ils cherchent et nous trouvent via des amis ou internet. Cette année, notre équipe accompagne 8 catéchumènes vers leur baptême à Pâques, dont 6 adolescents de 15 à 18 ans. C’est important d’avoir des lieux identifiés pour l’accueil des jeunes. Du coup, la plateforme egliseinfo.be est utile. »
(...)
« J’observe que de nombreux jeunes sont intéressés par la démarche du carême catholique. Il y a un désir croissant de sens et de retrouver ses racines. Des ados m’ont contacté par les réseaux sociaux pour me demander comment vivre le carême. Ils veulent vivre des règles, même strictes, et se former », explique le chanoine François Barbieux, vicaire épiscopal du diocèse de Namur pour les jeunes, les familles et les vocations ainsi que pour la communication, également curé de Marloie-On-Hargimont. Il poursuit : « Or, le réflexe des jeunes est de chercher les horaires sur leur smartphone, et donc tombent sur egliseinfo.be, plutôt que de venir voir le panneau accroché sur la façade de l’église. Pour le mercredi des Cendres, nous avons par exemple accueilli un jeune couple qui a fait une étape dans son voyage en train pour participer à notre célébration à Marloie. Ils avaient trouvé l’horaire sur egliseinfo.be. ».
Témoignage : « egliseinfo.be a été important dans ma conversion »
Lucas, 29 ans, originaire de Flémalle, raconte qu’Egliseinfo.be a été important dans son chemin de foi. « J’ai perdu le contact avec la foi lors de mon adolescence. A 27 ans, je suis tombé sur des vidéos YouTube du frère dominicain Paul-Adrien et j’en ai regardé beaucoup. Cela m’a touché et motivé à acheter une bible et lire les évangiles. Ce fut déterminant dans ma conversion. Ensuite, j’ai régulièrement utilisé egliseinfo.be pour découvrir des communautés chrétiennes dans mon coin. »
La grande enquête menée et publiée ce 9 avril par Aleteia et Famille Chrétienne auprès de plusieurs centaines de catéchumènes en France confirme ces tendances en Belgique auprès de ces adultes et grands adolescents qui se préparent au baptême. Les catéchumènes sont jeunes, voire très jeunes, largement influencés par les réseaux sociaux et aspirent à être épaulés dans leur foi après leur baptême. L’enquête révèle que 83% des catéchumènes confient être allés à la messe avant d’entrer en catéchuménat, comme si elle était un déclencheur et, à tout le moins, un véritable appui dans leur cheminement. On goûte la foi à la messe. 59% ont lu régulièrement ou occasionnellement la bible avant de demander le baptême. 78% considèrent que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans la découverte ou l’approfondissement de leur foi. Et dans le détail, ils sont même 46% a estimé que cela a beaucoup compté pour eux. 84% des catéchumènes qui ont répondu à l’enquête suivent un, ou plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux. Nul doute qu’ils sont très nombreux à rechercher des lieux de culte et des horaires de messes via les moteurs de recherche et tombent dès lors sur la plateforme egliseinfo.be.
600.000 recherches par an
Lancée à Pâques 2014 par des laïcs dans le but de faciliter la recherche des horaires de messes en Belgique francophone, la 1ère start-up catholique egliseinfo.be est devenue la plateforme de référence pour la localisation des clochers et des horaires de messes. La plateforme reçoit 600.000 recherches par an qui génèrent 2.2 millions de pages vues. C’est un des 3 sites catholiques belges francophones les plus fréquentés. Également fort présente sur les réseaux sociaux, egliseinfo.be a une couverture d’environ 1 million de contacts par an sur Facebook et Instagram.
« En lançant egliseinfo.be en 2014, mon intuition était de faciliter la recherche digitale des clochers et des horaires des messes, surtout par les pratiquants occasionnels ou en itinérance », dit Jacques Galloy, initiateur de la plateforme egliseinfo.be. « Suivant la tendance baissière de la pratique cultuelle, les clochers se regroupent logiquement pour former des « unités pastorales ». Les horaires et les lieux peuvent donc varier d’une semaine à l’autre, ce qui ne facilite pas la communication des horaires et des lieux de célébration. Plus globalement, cela devient naturel de rechercher les informations sur les moteurs internet ou des app d’intelligence artificielle. La mission d’egliseinfo.be est de faciliter les recherches dans le but de mener à des rencontres humaines. Cette évolution que nous observons sur egliseinfo.be est réjouissante et illustre la vigueur de l’Eglise catholique en Belgique francophone ».
« Les gens ne pratiquent plus nécessairement sur leur lieu de résidence, mais dans des lieux d’élections. Chez les jeunes, il y a en particulier un phénomène d’attraction via des amis et des animations. Les recherches par internet sont utiles et egliseinfo.be nous aide », explique l’abbé Pascal Roger, doyen du Pays d’Arlon. « Nous observons une recrudescence de participants aux célébrations. Par exemple nous avons 14 catéchumènes qui se préparent au baptême, la plupart a moins de 35 ans mais cela va jusque 60 ans. »
550 contributeurs bénévoles
Gabriel Crutzen, webmaster d’egliseinfo.be, ajoute : « Avec plus de 550 contributeurs bénévoles liés au réseau des paroisses et monastères catholiques, notre mission est d’aider les internautes à trouver le plus rapidement possible les bons horaires des messes, en partenariat avec les diocèses et CathoBel. Encore une fois, la forte implication de tous les volontaires permet de référencer plus de 4.000 messes et offices durant la semaine sainte en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous organisons souvent des webinaires pour accueillir les nouveaux bénévoles. »
La plateforme recense les heures de diffusion des messes en direct sur les grands médias : la RTBF TV et Radio (en partenariat avec CathoBel), KTO TV et les radios RCF. Elle reprend dorénavant les horaires de temps de prières tels que les chapelets, adorations, Taizé, groupes de prière. Si votre clocher n’est pas correctement référencé ou n’est pas encore à jour, n’hésitez pas à donner un coup de main à votre curé ou prieur. Devenez contributeur bénévole.
Contacts :
Gabriel Crutzen, webmaster, +32 470 03 21 74, support@egliseinfo.be
Jacques Galloy, initiateur, +32 (4) 374 23 74, info@egliseinfo.be
Gaudeto sprl - Chemin du Frise 46, 4671 Saive
A propos d’Egliseinfo.be
Egliseinfo.be est une start-up catholique belge qui géolocalise gratuitement les clochers et les horaires des célébrations. Lancée à Pâques 2014, elle regroupe 2.500, soit 95%, des clochers et paroisses de Belgique francophone. Ce projet collaboratif est porté par 550 contributeurs bénévoles en partenariat avec des diocèses belges francophones et CathoBel. www.egliseinfo.be -
https://www.facebook.com/egliseinfo.be - https://www.instagram.com/egliseinfo.be