De Jean-Marie Le Méné dans Valeurs Actuelles repris dans "Le coin des experts" de genethique.org :
"LA MATRICE DU TRANSHUMANISME EST CETTE RECONSTRUCTION DE L’HUMAIN QUE LA FÉCONDATION IN VITRO NOUS IMPOSE"
Derrière toute PMA, quelle qu'en soit sa finalité, se découvre la conception d'un humain manipulable, dissécable, congelable, triable et destiné à répondre à la solvabilité du marché, dénonce le magistrat et président de la Fondation Jérôme-Lejeune.
La couverture récente d’un magazine représentant un journaliste, son compagnon et leurs filles, issues d’une gestation pour autrui (GPA), illustre une double déconnexion. Entre la loi et les mœurs d’abord : quand une chose est faisable, éthique ou pas, avec ou sans loi, elle se fait. Les mœurs précèdent la loi. Déconnexion aussi entre les mœurs et la technique. Avant que l’opinion publique n’en prenne conscience, des découvertes scientifiques entrainent des applications technologiques susceptibles de modifier les mœurs. Ainsi, l’actualité sociétale dont témoigne cette couverture – la GPA – est-elle déjà dépassée par l’actualité scientifique.
En effet, le 11 octobre dernier, des scientifiques chinois ont publié, dans Cell Press, un article démontrant qu’ils avaient réussi à fabriquer des souriceaux à partir de deux parents de même sexe. Les souriceaux issus de deux mères ont survécu et donné une descendance. Les souriceaux issus de deux pères n’ont pas survécu au-delà de 48 heures. Les auteurs de cette publication auraient réussi à neutraliser les régions du génome « à empreinte » paternelle ou maternelle qui rendent nécessaire la fécondation hétérosexuelle. Mais l’expérimentation comporte des zones d’ombre et elle est loin de pouvoir s’appliquer à d’autres espèces, notamment à l’espèce humaine. Il est évident que la piste de recherche visant à fabriquer des embryons humains issus de parents de même sexes sera poursuivie et que les pratiques de PMA/GPA en seront impactées. L’utérus artificiel fera le reste et la GPA ne sera plus nécessaire.
Celi devrait nous conduire à mettre l’accent sur un aspect indigent de la réflexion bioéthique : la déréglementation de la recherche sur l’embryon qui alimente les transgressions que nous critiquons. Le seul sujet de bioéthique capable de susciter de l’intérêt est le bloc PMA pour toutes/GPA. Subtilement, le politique acceptera la PMA pour toutes et refusera la GPA. Et le débat prendra fin. Mais on n’évoque là que la partie émergée de l’iceberg. Or, ce que l’on oublie de commenter et qui figure dorénavant dans toutes les lois de bioéthique est plus grave. C’est la libéralisation progressive des diverses modalités de la reproduction pour répondre, non aux besoins des parents ou de la médecine, mais aux aspirations d’un marché qui crée à la fois l’offre et la demande. D’ores et déjà se profile la création d’embryons à trois parents, d’embryons chimériques homme/animal, d’embryons transgéniques modifiant la descendance, en attendant la création d’embryons par reproduction non sexuée qui fera partie des possibilités offertes dès que la technique sera au point. L’efficacité conduit à adosser ces évolutions à la mise en banque des gamètes, à l’extension du contrôle génétique avant la procréation, au cours de la fécondation in vitro et jusqu’au terme de la grossesse.
Il est temps de réaliser que la matrice du transhumanisme est cette reconstruction de l’humain que la fécondation in vitro nous impose depuis quarante ans. Dans ce bric à brac transhumaniste, la PMA pour toutes et la GPA sont des déclinaisons, des variantes, des options au gré des modes. Refuser l’une ou l’autre de ces transgressions est modérément utile si l’on n’interroge pas la source qui leur permet de se développer, à savoir le principe même de la PMA. Comment critiquer efficacement des pratiques en restant à l’intérieur même du cadre qui les perfectionne ? Cela signifie que se contenter de disqualifier la PMA destinée aux couples homosexuels, tenue pour non médicale, au profit de la PMA réservée aux couples hétérosexuels, tenue pour médicale, revient à nourrir le système qui continuera à imposer ses produits dérivés au fur et à mesure des avancées technologiques. La PMA qui est historiquement une transposition dans l’espèce humaine des techniques d’élevage et d’amélioration des races animales est de nature antispéciste. Réduite à un appariement de cellules, rien ne distingue la conception d’un enfant de celle d’un animal. La PMA n’est donc jamais médicale tant que l’embryon humain peut être fait, défait, refait, parfait pour répondre à la solvabilité du marché. La véritable disruption transhumaniste n’est ni la PMA pour toutes ni la GPA, qui sont des bricolages surannés, mais l’hubris consistant à assembler l’humain sur une chaîne de montage, le trier, le congeler, le décongeler, l’augmenter, le transférer, le céder à des tiers, le livrer à la recherche, le disséquer sur des paillasses et le détruire à péremption. La détermination à voir un « progrès » dans la PMA est la première marche du transhumanisme.
Article publié initialement dans le magasine Valeurs actuelles du 1er novembre 2018 sous le titre : PMA : la partie émergée d’un redoutable iceberg, p. 83-84.
 « Le 25 juillet 1968,
« Le 25 juillet 1968, 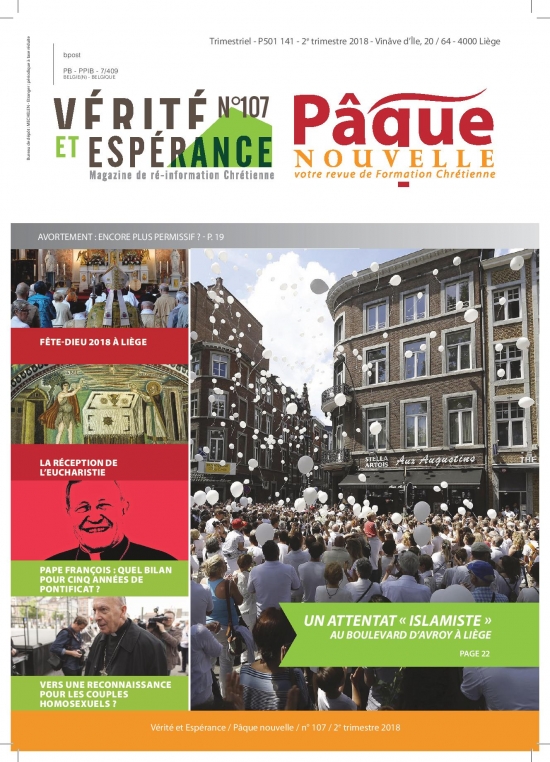


 En soi, le droit d’inscrire dans un registre public un fœtus né sans vie ne tranche pas la question de son statut et des conséquences qui devraient s’en suivre.
En soi, le droit d’inscrire dans un registre public un fœtus né sans vie ne tranche pas la question de son statut et des conséquences qui devraient s’en suivre.  Au moment d’écrire ces lignes, les discussions sont toujours en cours à la Commission Justice de la Chambre où les députés débattent de la sortie de l’IVG du code pénal. Pas moins de sept propositions sont été déposées, émanant de tous les partis. Certaines visent à ramener l’
Au moment d’écrire ces lignes, les discussions sont toujours en cours à la Commission Justice de la Chambre où les députés débattent de la sortie de l’IVG du code pénal. Pas moins de sept propositions sont été déposées, émanant de tous les partis. Certaines visent à ramener l’