Le Père Samir Khalil Samir, islamologue jésuite que le pape François vient de placer à la tête de l'institut Pontifical Oriental, réagit à un discours d'Abu Bakr al-Baghadi, le "calife" de l'Etat Islamique. Ce discours (datant de la mi-mai) demandait à chaque musulman d'actualiser sa propre hégire en émigrant vers l'E.I. ou de combattre dans son propre pays, où qu'il soit (voir ICI). Le commentaire du Père Samir Khalil reproduit ci-dessous tranche avec les discours habituels affirmant que "l'islam, ce n'est pas cela" et que Abu Bakr al-Baghadi ne serait pas un authentique musulman (source) :
UN MESSAGE TRÈS HABILE
par Samir Khalil Samir, S.J.
Ce message d’Abu Bakr al-Baghdadi est un message très habile parce qu'il correspond aux attentes d'une partie du monde islamique. Certainement, les groupes salafistes qui cherchent à ramener la société au style et à la pratique du temps de Mahomet, seront heureux et diront : Enfin, nous retrouvons le véritable islam !
Il est à noter que quand il évoque l’émigration, il se réfère à la migration de Mahomet de la Mecque à Médine, celle que nous appelons l’Hégire et qui marque le début de l'histoire du monde musulman depuis 622, le début de l'ère islamique.
Cette émigration marque le passage de l’islam pacifique à l’islam combattif. À la Mecque, Muhammad ne fit jamais la guerre ; mais, voyant que son message ne passait pas et que peu de gens l’écoutaient, et qu'il y avait en effet une vraie menace pour sa vie, il a envoyé un petit groupe de ses partisans pour émigrer en Éthiopie, un pays chrétien qui lui réserverait bon accueil. Ensuite, il a émigré à Médine. Là, il commença à prêcher, et un an plus tard il a commencé la lutte armée d’abord contre les Mecquois puis ensuite contre les tribus pour les convertir.
Muhammad a gagné tous ces guerres : la majorité des tribus d'Arabie l’ont suivi. Mais il faut préciser qu’ils l’ont suivi plus comme un chef militaire que comme un chef religieux. La preuve est la suivante : quand Muhammad mourut en 634 (?), beaucoup de tribus se sont retirées en ne soutenant plus la guerre et en ne payant plus les taxes. Alors, le nouveau calife Abu Bakr leur a déclaré la guerre pour les forcer à retourner à l'islam.
Et ils ont refusé : nous avons fait un pacte avec Muhammad, pas avec l'islam. Mais Abu Bakr les a vaincus et contraints de retourner au sein de l'islam. Et il est intéressant que ce nouveau « calife » ait choisi comme nom Abu Bakr et veuille lancer la guerre sainte dans le monde entier, pour soumettre tout le monde à l’islam.
Son appel a pour signification de réveiller quelque chose qui sommeille dans la pensée profonde de l'islam, en disant : faisons tous notre hégire, laissons là tous ceux qui veulent un islam de paix, et passons à l'islam authentique qui a d’abord conquis l'Arabie saoudite, puis le Moyen-Orient et ensuite la Méditerranée. Ce serait la dernière phase de la lutte du prophète par l'intermédiaire de son nouveau représentant.
Tout cela est très symbolique
Il est vrai qu'il y a des nouvelles selon lesquelles l'État islamique serait en train de perdre des adeptes, et que certains jeunes, après leur arrivée en Syrie et en Irak pour combattre, auraient aujourd’hui pris leurs distances et seraient emprisonnés par les miliciens de l'ISIS. Le message vise alors à réveiller encore plus de musulmans pour recruter d’autres jeunes plus déterminés.
Presque certainement, l'appel d'al-Baghdadi secouera les musulmans salafistes qui ont pour modèle l'islam primitif. Ils prennent comme modèle la première génération de l'islam, et cela déterminera beaucoup de musulmans traditionalistes à devenir salafistes et à combattre.
Devant cet appel aux armes, que faire ?
La lutte armée peut être nécessaire, mais elle ne sera pas déterminante. Des actions militaires peuvent réduire la violence, répandre moins de sang, faire régresser l'État islamique, mais le mouvement se poursuivra, parce qu’il fait partie de l'islam. La seule solution radicale est une réforme interne de la lecture de l'histoire islamique.
Quand al-Baghdadi dit que « l'islam n'a jamais été une religion de paix », il exagère : l'islam a connu aussi des périodes de paix. Dire que l'islam est seulement la guerre, c’est une erreur. L'Islam est tout à la fois paix et guerre et il est temps que les musulmans revoient leur histoire.
En outre, il est à noter que la guerre islamique n'est pas comparable aux croisades : les croisades étaient tout au plus une guerre limitée pour sauver Jérusalem et les lieux saints, mais pas une guerre totale, sainte, inspirée par l'Évangile.
En revanche, la guerre de l'islam est toujours sainte si elle est menée pour élargir les frontières de l'islam et récupérer la terre de l'islam.
 Le "
Le "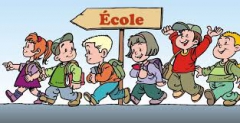 L’urgence pour l’école c’est sa liberté !
L’urgence pour l’école c’est sa liberté !