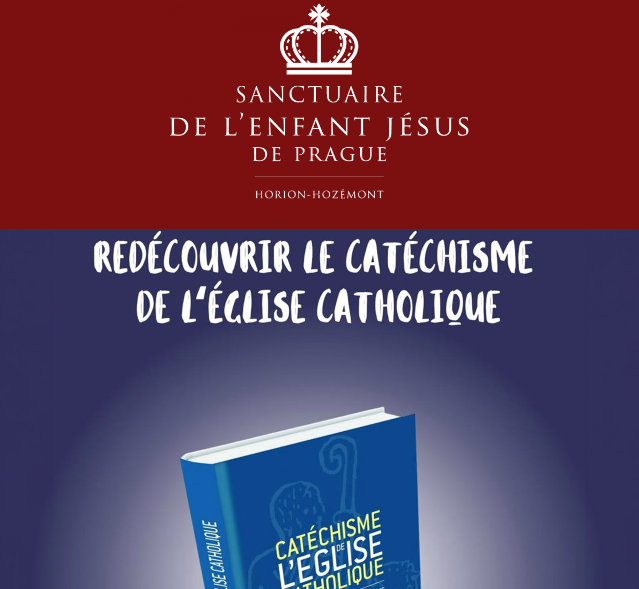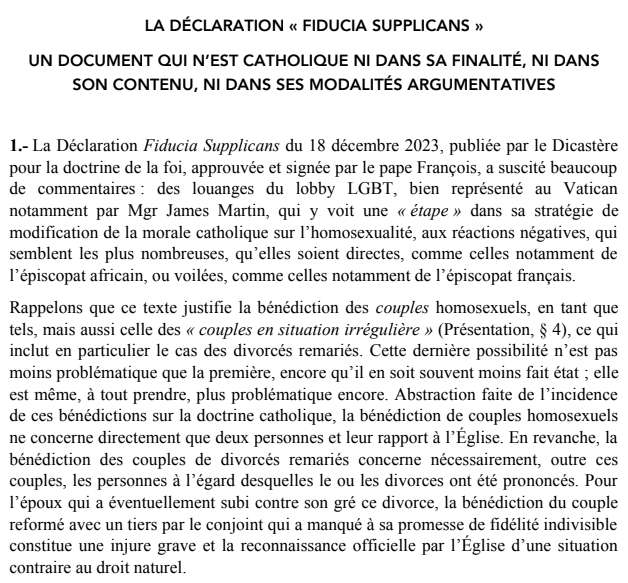De Luisella Scrosati sur la Nuova Bussola Quotidiana :
Un enfer vide ? Jésus le nie
Dans les paroles prononcées à la télévision par le Pape, il y a le drame d'une Eglise qui, au nom d'une miséricorde mal comprise, fait plus pour "excuser" que pour évangéliser. Mais la "porte est étroite", prévient le Seigneur.
18_01_2024
"J'aime penser que l'enfer est vide, j'espère que c'est la réalité", a déclaré le pape François dimanche soir dans l'émission Che Tempo Che Fa. "Ce que je vais dire n'est pas un dogme de foi mais quelque chose de personnel", a déclaré le pape.
Il n'a pas déclaré que l'enfer n'existe pas, il n'a pas dit qu'il est vide, il n'a pas prôné l'apocatastase ; pourtant, dans ces mots apparemment légitimes se trouve tout le drame que vit l'Église depuis plus d'un demi-siècle. Dans un autre entretien d'il y a deux mille ans, plus authentique et moins médiatique, alors que Notre Seigneur se rendait à Jérusalem, "un homme lui demanda : "Seigneur, y a-t-il peu de sauvés ?" (Lc 13,23). La réponse à cette question met en évidence toute la distance, non pas de temps ni d'espace, mais de sens, entre Jésus-Christ et son vicaire : "Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, essaieront d'y entrer, mais n'y parviendront pas".
Le Seigneur, qui est la miséricorde faite chair, ne cherche pas à éteindre l'inquiétude du salut dans le cœur de l'homme, mais semble même la confirmer : beaucoup n'entreront pas. C'est pourquoi, vous qui m'écoutez, vous qui m'interrogez, efforcez-vous d'entrer.
Le passage suivant de l'Évangile de Luc, considéré comme l'Évangile de la miséricorde en raison de la présence des trois paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue, est encore plus fort : "Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, vous vous tiendrez dehors et vous commencerez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, ouvre-nous. Mais il vous répondra : "Je ne vous connais pas, je ne vous connais pas : Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous commencerez à dire : Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Mais il vous dira : "Je vous dis que je ne vous connais pas : Je vous dis que je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité ! Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous en serez chassés" (Lc 13,25-28). Il ne s'agit pas d'un passage isolé. Dans l'Évangile de saint Matthieu, nous trouvons un avertissement similaire : "Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mènent à la destruction, et nombreux sont ceux qui entrent par là ; mais combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mènent à la vie, et combien peu nombreux sont ceux qui les trouvent ! (Mt 7, 13-14). Une fois de plus, le contraste est saisissant : beaucoup se perdent, peu trouvent le chemin de la vie.
C'est pourquoi saint Paul, l'Apôtre qui s'est épuisé à proclamer que le salut de Dieu est accessible non seulement aux juifs, mais aussi aux païens, dans une lettre qui se distingue par son affection et sa consolation, exhorte ainsi les chrétiens de Philippes : "Attendez votre salut avec crainte et tremblement" (Ph 2,12). Avec crainte et tremblement : pourquoi ? Parce que, fidèle à l'enseignement du Seigneur, il savait bien qu'une large catégorie de péchés ferme la porte de l'entrée dans le Royaume : "Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les égarés, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les rapaces n'hériteront du Royaume de Dieu" (1 Co 6,9-12). Pas d'illusions à ce sujet, justifiées par une miséricorde de Dieu mal comprise, pas de fausse tranquillité fondée sur le fait que les conditionnements de toutes sortes rendraient le péché presque impossible.
Saint Augustin, dans le livre XXI de son chef-d'œuvre De Civitate Dei, était déjà contraint de dénoncer les faux enseignements des "Origénistes miséricordieux", qui comprenaient les paroles de l'Évangile à leur manière, en posant l'hypothèse d'un salut universel. Ceux-ci, "défendant leur propre cause, tentent presque d'aller à l'encontre des paroles de Dieu avec une miséricorde, pour ainsi dire, supérieure à la sienne" (XXI, 24. 1). Misericordia maiore conantur. Le XXe siècle a été le siècle où ces "conants" sont devenus la pensée théologique dominante. Déjà en 1948, un Louis Bouyer d'une trentaine d'années constatait l'effondrement de la dimension eschatologique dans la vie chrétienne, et en particulier le vidage de la réalité de l'enfer et du danger concret de la damnation éternelle : "on maintient un enfer pour se mettre en règle avec des textes trop clairs ; mais, en privé, on rassure les gens sur le fait que personne ne risque d'y aller".
Aujourd'hui, pas même en privé. Il y a une différence entre l'espoir que beaucoup de gens seront sauvés et l'espoir que l'enfer est vide, cette différence abyssale entre travailler généreusement et inlassablement à notre propre conversion et à celle des autres et prêcher constamment des "excuses" pour le péché. La mission, la prédication sur la vie éternelle, la vie ascétique, la lutte sans concession contre le mal, sous toutes ses formes, l'appel continuel au repentir et à la pénitence, l'indication des exigences des commandements de Dieu sont les conséquences de la première ; l'affirmation continuelle des conditionnements psychologiques, sociaux, culturels, de la moralité des cas et des circonstances individuelles, la recherche de solutions pour que tous puissent recevoir les sacrements et les bénédictions, sans appel à la conversion, sont les manifestations de la seconde.
Un lecteur très attentif et perspicace a réveillé chez l'écrivain le souvenir d'un passage de la Légende du Grand Inquisiteur, tirée du roman Les Frères Karamazov. Le dialogue entre le Grand Inquisiteur et Jésus-Christ, revenu au monde et immédiatement arrêté après avoir accompli le miracle de la résurrection d'une petite fille, porte sur la prétention de construire un ordre meilleur que celui du Fils de Dieu. Et dans ce monde meilleur, il ne pouvait manquer cette misericordia maior dont parlait saint Augustin, une miséricorde capable d'un salut présumé plus universel que celui voulu par le Christ : "Nous leur permettrons de pécher, ils sont faibles, sans force et donc ils nous aimeront comme des enfants, nous leur dirons que tout péché sera racheté s'il est commis avec notre permission, que nous leur permettons de pécher parce que nous les aimons et que nous prendrons le châtiment sur nous et qu'ils nous aimeront comme des bienfaiteurs (...). Il est prophétisé que tu reviendras avec tes élus, avec ton peuple fort et hautain, mais nous dirons qu'ils n'ont sauvé qu'eux-mêmes, alors que nous les avons tous sauvés... et nous dirons : "Juge-nous si tu le peux et si tu l'oses". Moi aussi, j'ai voulu être parmi Tes élus, les forts, mais je suis revenu à moi et j'ai rejoint ceux qui ont corrigé Ton œuvre. J'ai quitté les orgueilleux et je suis revenu aux humbles, pour que les humbles soient heureux". Ainsi s'exprimait le Grand Inquisiteur.
Si le Rédempteur des hommes annonce que beaucoup finiront là où il y a des pleurs et des grincements de dents, pourquoi déclarer votre plaisir personnel à penser que l'enfer est vide ? Si l'Apocalypse annonce que ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu (cf. Ap 20,15), pourquoi "espérer" que cet étang sera vide ? L'espérance théologale se fonde sur la foi, et la foi se fonde sur les paroles du Seigneur, sur la Révélation de Dieu. L'espérance qui ne déçoit pas (cf. Rm 5,5) repose donc sur l'annonce évangélique du salut qui, dans le Christ, est offert à tous, sur le fait que Dieu "veut que tous les hommes soient sauvés" (1Tm 2,4) et qu'il nous a donc donné à tous la grâce dans le Christ ; mais aussi sur le fait que "beaucoup, comme je vous l'ai dit bien des fois, et je le répète maintenant les larmes aux yeux, se conduisent en ennemis de la croix du Christ : mais leur fin sera la perdition" (Ph 3,18-19).