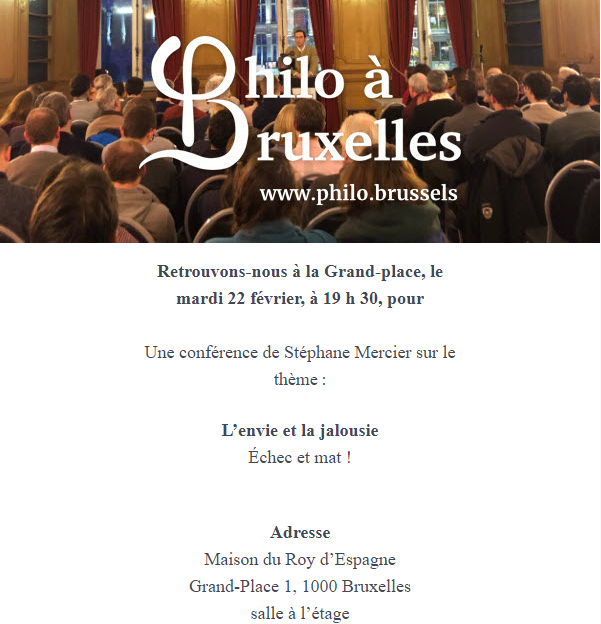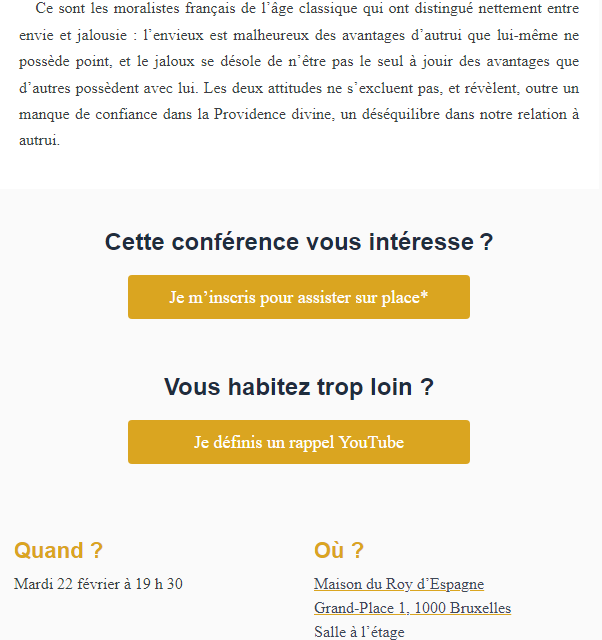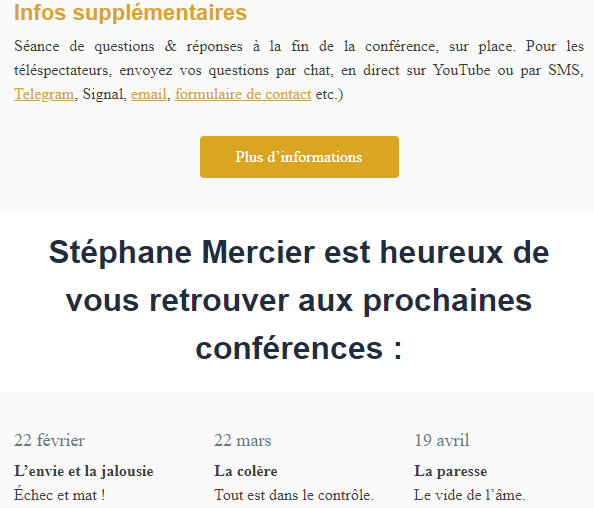Du site de l'Institut Européen de Bioéthique :
La Cour constitutionnelle rejette le recours relatif à la loi belge de 2020 sur l’euthanasie
17/02/2022

Dans un arrêt publié ce jeudi 17 février, la Cour constitutionnelle de Belgique rejette le recours en annulation de la loi du 15 mars 2020 modifiant la législation sur l'euthanasie.
Parmi les trois modifications introduites par la loi, la Cour considère que deux d'entre elles ne sont pas contraires à la Constitution. Quant à la troisième disposition, relative à l'atteinte à la liberté des institutions de soins ne pratiquant pas d'euthanasie, la Cour refuse d'examiner le recours, le jugeant irrecevable.
Pour rappel, la loi votée en 2020 prévoit premièrement qu' « aucune clause écrite ou non écrite ne peut empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie ». Cette disposition vise à interdire de fait les maisons de retraite ou hôpitaux dont le projet de soins exclut le fait de mettre fin à la vie de leurs patients ou résidents par euthanasie, et qui privilégient l'accompagnement à travers les soins palliatifs. Les citoyens requérants, de même que l'Institut européen de bioéthique, partie intervenante au recours, considéraient qu'une telle restriction porte injustement atteinte à la liberté de ces institutions de soins.
Considérant que les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir en tant que personnes individuelles, la Cour refuse d'examiner leurs arguments (point B.4.3 de l'arrêt). L'absence d'institution de soins parmi les requérants s'explique pourtant aisément par les menaces de sanction pesant déjà aujourd'hui sur ces dernières lorsque l'administration constate qu'elles excluent la pratique de l'euthanasie de leur projet.
En second lieu, le recours contestait également l'obligation faite au médecin qui refuse de pratiquer une euthanasie (en vertu de la loi ou pour motif de conscience) de renvoyer le patient « vers un centre ou une association spécialisé en matière de droit à l'euthanasie ». Les requérants considéraient que cette obligation porte injustement atteinte à la liberté de conscience du médecin concerné en le contraignant à participer à une euthanasie, dès lors que les centres ou associations en question militent en réalité pour l'extension de la loi sur l'euthanasie. La Cour rejette toutefois ces arguments, considérant que « la liberté de conscience du médecin et son choix de ne pas pratiquer l'euthanasie, ainsi que les droits du patient » sont respectés en l'occurrence (B.10).
Enfin, en troisième lieu, le recours contestait également la durée de validité désormais illimitée de la déclaration anticipée d'euthanasie (alors qu'elle devait auparavant être renouvelée tous les cinq ans), considérant qu'une telle validité pourrait mener à ce que soient pratiquées des euthanasies sur des personnes dont la position a évolué entre-temps mais qui avaient oublié de modifier leur déclaration. La Cour rejette cet argument – en dépit des remarques critiques du Conseil d'État lors de l'examen de la proposition de loi –, indiquant que « conférer à la déclaration anticipée une durée de validité limitée ne fait pas disparaître le risque que le déclarant oublie de renouveler sa déclaration » et ajoutant que « rien n'empêche les personnes concernées, le cas échéant en concertation avec leurs proches et les professionnels concernés, de réévaluer régulièrement leur position » (B.16).
En refusant d'examiner l'atteinte à la liberté des institutions de soins, la Cour laisse donc entière la question de la compatibilité de cette disposition avec les droits fondamentaux. Rappelons que les articles en question étaient quoi qu'il en soit déjà entrés en vigueur. Quant à l'obligation de renvoi renforcée et à la durée de validité de la déclaration anticipée, l'appréciation sommaire fournie par la Cour soulève certaines interrogations quant à la prise en compte intégrale du droit européen des droits fondamentaux.
Rappelons enfin que la Cour constitutionnelle aura prochainement une nouvelle occasion de se prononcer au sujet de la législation belge sur l'euthanasie, à travers la question préjudicielle posée au sujet de l'absence actuelle de sanction spécifique en cas de violation des conditions de la « loi euthanasie ». Cette question intervient dans le cadre de l'affaire Tine Nys, jeune femme de 38 ans euthanasiée en 2010 pour trouble psychique.