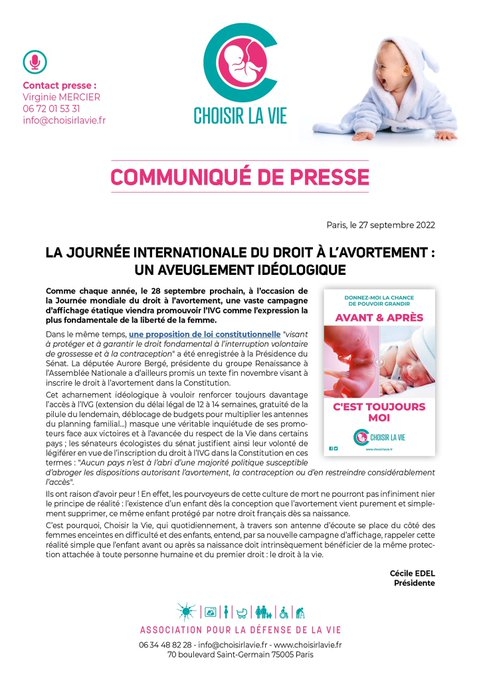Du site de l'hebdomadaire Famille Chrétienne :
« L'enfant trans est devenu le nouveau produit marketing »
La marche progressiste de nos sociétés en faveur de la reconnaissance du droit qu’auraient les enfants à « autodéterminer » leur genre est un phénomène mondialisé. Non seulement elle se produit dans tout le monde occidental, mais elle répond de surcroît à une volonté explicite des organisations internationales. En 2006, un groupe d’experts des droits humains réunis en Indonésie a signé les vingt-neuf principes de Jogjakarta qui portent sur les normes juridiques internationales non contraignantes auxquelles tous les États devraient idéalement se conformer en ce qui concerne l’orientation sexuelle et l’« identité de genre » et dont s’inspirent les institutions internationales (l’ONU, le Conseil de l’Europe) qui, à leur tour, les recommandent aux pays du monde.
Sous quelle autorité ?
Ces experts n’ont aucun mandat, aucune autorité, mais leurs principes servent de référence juridique et de boussole morale. En 2017, ce groupe y a ajouté dix principes et obligations des États, qui portent sur « l’expression de genre ». On y trouve l’obligation d’accepter le changement de prénom et de sexe à l’état civil à tout âge (principe 31), l’obligation de protéger le droit de tout enfant à l’autodétermination (principe 32), ou de « veiller à ce que toutes les écoles et autres institutions offrent des installations sanitaires sûres » (principe 33). À savoir, les recommandations mêmes de la circulaire Blanquer.…
Sait-on tout de même qui, exactement, tire les ficelles de ce phénomène mondialisé ?
Un lobbying intense serait présent au sein des institutions européennes. En 2020, le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), ONG chrétienne conservatrice dirigée par Gregor Puppinck, a étudié la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment le « pedigree » de ses quarante-sept juges. Cette étude, révélée par l’hebdomadaire Valeurs actuelles en février 2020, démontre que cette Cour est infiltrée par des juges qui sont liés à l’Open Society Foundations du milliardaire américano- hongrois George Soros. Sur les cent juges qui y ont siégé entre 2009 et 2019, l’ECLJ en a compté vingt-deux.
Qu’est-ce que cette Open Society ?
L’Open Society milite activement pour le droit des personnes trans à changer légalement de sexe. En 2014, elle a produit un rapport, « License To Be Yourself », qui se présente comme un texte ressource pour les activistes du monde entier œuvrant pour les droits des personnes trans et pour l’évolution des législations en faveur du changement de sexe à l’état civil, y compris pour les enfants.
Il est étonnant cependant que le mouvement trans ait obtenu en quelques années seulement une visibilité et des conquêtes législatives telles qu’il a fallu plusieurs décennies pour les mouvements de défense des femmes et des homosexuels pour en obtenir de comparables.…
Michael Biggs, professeur de sociologie à Oxford, a creusé la question. La raison, selon lui, tient au soutien financier massif d’une poignée de milliardaires. Parmi eux, George Soros, que je viens d’évoquer, dont l’OSF est le principal donateur des causes trans. L’OSF a ainsi accordé des subventions d’une valeur de 3,07 millions de dollars pour 2016-2017 ! ONG, partis politiques, institutions internationales sont nombreux à recevoir de l’argent de la part de milliardaires ou de compagnies pharmaceutiques.
Quelles sont leurs motivations à donner ces sommes faramineuses ?
Contrairement aux autres mouvements de défense des minorités, le lobby trans ne semble pas émaner d’une minorité opprimée, mais bien plutôt d’une petite minorité ultra-capitaliste qui pourrait trouver un intérêt financier à promouvoir l’idéologie transgenre et à banaliser la transformation des corps par la chirurgie et les produits chimiques. Se promeut une figure qu’elle présente sous le masque séduisant de la réalisation de soi et du courage.