D'Aide à l'Eglise en Détresse (Belgique) :
« Une goutte de lait » : demande urgente de l’Aide à l’Église en Détresse pour aider les enfants à Alep.
Les combats dans la partie orientale d’Alep ont, pour l’instant, cessé, et compte tenu du calme relatif, les gens reviennent lentement pour voir ce qui reste de leurs maisons. Les destructions et l’impact sur les infrastructures sont importants, et les besoins énormes : nourriture, combustible pour le chauffage, eau et électricité. La Fondation pontificale « Aide à l’Église en Détresse », qui a continuellement fourni des fonds aux chrétiens de Syrie depuis le début de la guerre, s’attèle maintenant, avec ses partenaires locaux, à l’une des principales préoccupations des familles chrétiennes à Alep : du lait pour leurs enfants.
En ces temps de disette, le lait est essentiel pour la croissance et le bien-être de ces enfants. Le projet appelé « Une goutte de lait » vise à assurer chaque mois aux enfants chrétiens d’Alep de moins de dix ans un approvisionnement en lait.
Le projet œcuménique, mis en œuvre depuis mai 2015, a été grandement apprécié et continue de l’être par toutes les Églises chrétiennes d’Alep, car c’est le seul programme qui aide tous les chrétiens indépendamment de leur rite ou de l’Église à laquelle ils appartiennent. Mais le financement de ce projet très important est en péril. Bien qu’Alep soit calme et ne soit donc plus au cœur des préoccupations des médias internationaux, les conditions de vie y sont épouvantables : 80 % de la population d’Alep a été déplacée et 70 % vit en dessous du seuil de pauvreté. Le nombre de familles ayant besoin de colis alimentaires rien que pour survivre a considérablement augmenté.
Le docteur Nabil Antaki, un gastro-entérologue syrien qui est resté auprès de la population pendant les bombardements et qui coordonne maintenant ce projet, a instamment demandé davantage d’aide pour que le programme de fourniture de lait soit maintenu. « Nous distribuons du lait chaque mois à environ 2.850 enfants : 2.600 enfants reçoivent du lait en poudre, et 250 reçoivent du lait spécial pour nourrissons. Les bébés non allaités par leur mère reçoivent un lait qui leur est spécialement destiné. Le nombre total de bénéficiaires varie chaque mois en fonction du nombre de naissances et de l’émigration des familles », explique le docteur Antaki.
Georgina, mère de trois enfants, explique à l’Aide à l’Église en Détresse combien ce projet est important pour elle et sa famille : « Myriam a dix ans, Pamela a six ans. Nous faisons partie des bénéficiaires du projet “Une goutte de lait”. Myriam et Pamela reçoivent chacune un kilo de lait en poudre par mois. La santé de Pamela était critique du fait qu’elle avait été touchée par des éclats de bombe dans le dos, et maintenant qu’elle a récupéré, elle a besoin de lait pour améliorer sa santé et se renforcer. Ce projet est très important pour moi et ma famille, et je tiens vraiment à ce qu’il continue ».
Les enfants d’Alep ont déjà été privés d’une enfance paisible et épanouissante. Il ne faudrait pas qu’ils soient privés du lait nécessaire à leur croissance et à leur santé. L’Aide à l’Église en Détresse a donc assuré le docteur Antaki de notre aide aux enfants d’Alep.
L’Aide à l’Église en Détresse donnera 18.750 € par mois pendant toute l’année 2017, soit un total de 18.750 € x 12 = 225.000 €
Par Maria Lozano


 (A.P) -- Un important message de paix arrive de Mossoul, où un groupe de jeunes musulmans entre quinze et trente ans a organisé le nettoyage et la restauration des lieux de culte: pas seulement les mosquées, mais aussi une église. L’idée? Celle de promouvoir la coexistence religieuse en demandant aux chrétiens de retourner à la maison. C’est le but de la campagne « Pour une Mossoul plus belle », comme
(A.P) -- Un important message de paix arrive de Mossoul, où un groupe de jeunes musulmans entre quinze et trente ans a organisé le nettoyage et la restauration des lieux de culte: pas seulement les mosquées, mais aussi une église. L’idée? Celle de promouvoir la coexistence religieuse en demandant aux chrétiens de retourner à la maison. C’est le but de la campagne « Pour une Mossoul plus belle », comme  Liège - Belgique, le 15 février 2017. Le Winter Forum est le plus grand rendez-vous jeunes et jeunes pros, 18-30 ans, chrétiens et en quête de sens en Belgique et dans les régions limitrophes. C’est la 3ème édition de ce Forum belge et européen qui rassemblera plus de 350 participants de 6 pays et qui est animé en 3 langues (
Liège - Belgique, le 15 février 2017. Le Winter Forum est le plus grand rendez-vous jeunes et jeunes pros, 18-30 ans, chrétiens et en quête de sens en Belgique et dans les régions limitrophes. C’est la 3ème édition de ce Forum belge et européen qui rassemblera plus de 350 participants de 6 pays et qui est animé en 3 langues (
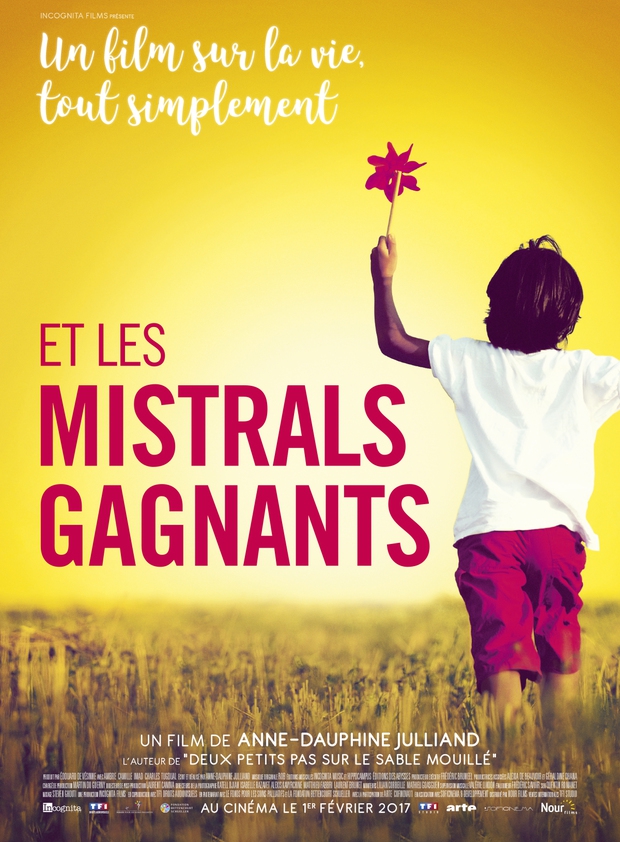 Du
Du 