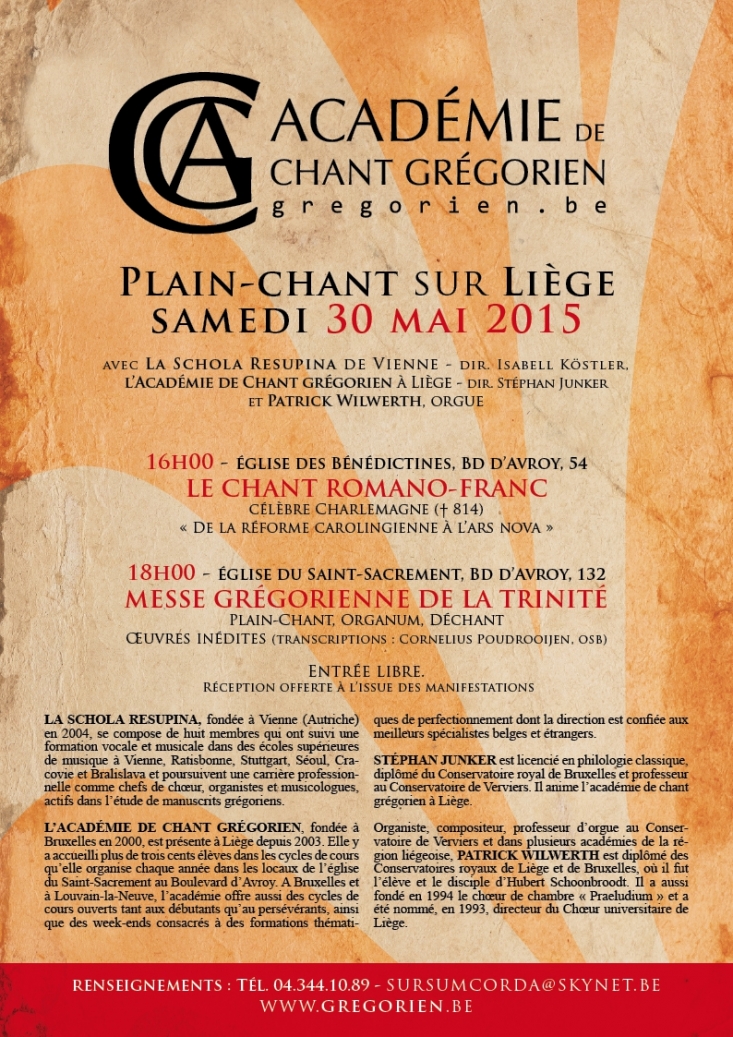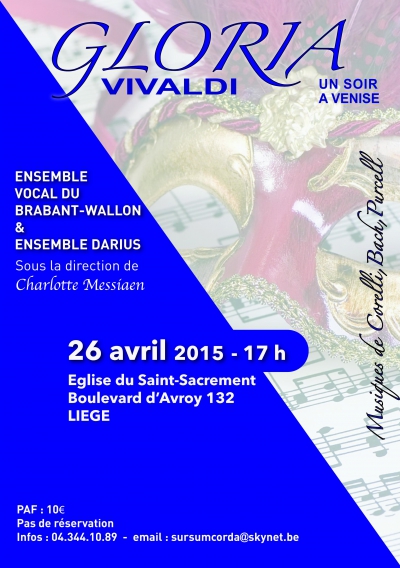Certains voudraient profiter d’un récent arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique pour éliminer les cours de religion de l’enseignement officiel francophone. D’autres y prétendent au motif que les religions engendreraient la violence. Dans une page de débat du journal Le Soir, Etienne Michel, secrétaire général due l’enseignement catholique donne son avis sur la question. Le site Didoc.be nous rappelle cette excellente interview :
— Même si ça ne concerne pas l’école libre : que pensez-vous de ceux qui suggèrent de totalement évacuer le cours de religion/morale dans l’enseignement officiel ?
Je n’ai pas l’habitude de m’exprimer sur ce qui se passe dans l’officiel, vous savez…
— Oui mais, quand même, vous êtes aussi un citoyen, un observateur…
Ah !... Alors, comme observateur, je peux vous dire ceci… Il y a la stratégie 1 : on actualise le pacte scolaire. Et la stratégie 2 : on le dépasse.
— Actualiser : dans quel sens ?
On confirme l’enseignement des religions, comme il est organisé aujourd’hui. Mais l’autorité publique fixerait des conditions. Elle pourrait exiger que ces cours soient enseignés en français ; que les enseignants de religion soient formés — aujourd’hui, ce n’est pas organisé ou imposé pour toutes les religions. L’autorité pourrait fixer des éléments à mettre dans les programmes, prévoir qu’il faut son agrément pour ces programmes et, enfin, contrôler les cours et les enseignants par une inspection appropriée.
— Et la stratégie 2, c’est quoi ?
J’observe la volonté du monde laïque et de ses organisations de repousser la religion en dehors du champ de l’école, le plus loin possible. Et comme la Constitution ne le permet pas totalement, l’option retenue est la réduction des 2 heures de religion à 1 heure par semaine, combiné à un système de dispense et l’introduction d’un cours de citoyenneté. On dépasse le pacte scolaire. C’est l’intuition du courant laïque traditionnel, qui vise à repousser le religieux dans la sphère privée.
— Et c’est une bonne idée, ça ?
Le fanatisme religieux, ce n’est pas la religion mais la pathologie de la religion. Et le problème, c’est que le fanatisme religieux ne se laisse pas enfermer dans la sphère privée. Au contraire. Avec les attentats, il fait violemment irruption dans la sphère publique.
— Que faire ?
Faut-il laisser l’enseignement de la religion s’opérer de façon informelle ? Ne prendrait-on pas le risque de laisser les prédicateurs agir dans les arrière-salles de café ? De laisser les idées simplistes prendre le pas sur un enseignement plus raisonné de la religion et sur un rapport plus raisonné au religieux ?
Sur un plan philosophique : dans un entretien qu’ils ont eu en 2004, le sociologue allemand Jürgen Habermas et le futur pape Joseph Ratzinger ont convenu de la nécessité d’un dialogue entre la raison et les religions. La religion livrée à elle-même peut produire des pathologies, comme le djihadisme. Mais la raison peut aussi manquer de sagesse — les armes de destruction massive sont un produit de la raison. Et il est bon pour l’équilibre de notre société que la possession de ces armes ne soit pas dissociée du commandement religieux « tu ne tueras point ». C’est cet équilibre qui fait que nous avons des armes atomiques et que nous nous interdisons de les utiliser.
Pour le sociologue Alain Touraine, nous devrions réarticuler ce que notre époque tend à dissocier. Il faut essayer de réarticuler raison et religion. C’est ce que nous faisons à l’école catholique où le cours de religion a intégré le questionnement philosophique, le dialogue interconvictionnel et la citoyenneté. Vous voyez : on articule religion et citoyenneté au lieu de dissocier. C’est notre option.
Et je vois bien que l’école officielle, pour des raisons que je respecte, prend un autre chemin : dissocier religion et citoyenneté. Avec des problèmes de cohérence. Par exemple, il se pourrait que ce qui sera exposé au cours de citoyenneté ne s’articule pas spontanément et de manière cohérente avec ce qui se dit au cours de religion islamique.
— Il y a trois ans, le Segec [Secrétariat général de l’enseignement catholique] s’était demandé s’il ne serait pas opportun de permettre au réseau catholique d’organiser le cours de religion islamique. Qu’en est-il ?
C’était une question. A l’époque, elle a suscité des réactions très vives dans le monde laïque qui a estimé que nous voulions augmenter nos parts d’achats. Ce n’est pas ça. Mais on a bien vu que cette question n’a pas beaucoup d’espace dans le champ politique. Mais elle reste : comment conduire une population à développer un rapport raisonné à sa propre religion ?
— Et ça, seule l’école peut le faire ?
C’est à l’école de faire ce genre de travail, oui.
Etienne Michel dirige le Secrétariat général de l’enseignement catholique. Source : Le Soir, 25-3-15, p. 24.
Ref. Pour un enseignement raisonné de la religion
JPSC
 Mgr Kaigama, Président de la Conférence épiscopale du Nigeria, appelle médecins et infirmiers africains à ne pas se laisser phagocyter par les « valeurs » laïcistes occidentales. Lu sur le site « aleteia », sous la signature d’Isabelle Cousturié :
Mgr Kaigama, Président de la Conférence épiscopale du Nigeria, appelle médecins et infirmiers africains à ne pas se laisser phagocyter par les « valeurs » laïcistes occidentales. Lu sur le site « aleteia », sous la signature d’Isabelle Cousturié :