Les amoureux du chant grégorien craignent que derrière le licenciement du professeur de musique sacrée médiévale de Notre-Dame de Paris, justifié par des motifs économiques, se cache une volonté de « moderniser » le répertoire de la Maîtrise. De Paul Sugy sur le site web « Figarovox » :

" C’est un mouvement de grève qui n’a pas fait la Une des journaux - et qui n’a pas grand-chose à voir avec l’âge pivot du départ à la retraite. Pour la simple raison que le «régime spécial» qu’il défend est un peu plus vieux que l’invention de la retraite par répartition… Mardi soir, les élèves de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris ont refusé d’assurer le traditionnel concert de Noël qui devait avoir lieu en l’église Saint-Sulpice, pour protester contre le licenciement de cinq membres de l’École de musique sacrée.
La Maîtrise de Notre-Dame de Paris, une école de musique sacrée créée en 1991 à l’initiative du diocèse, de la Mairie et du ministère de la Culture, comprend aujourd’hui 160 chanteurs et une trentaine de professeurs. Elle est la gardienne d’un patrimoine musical vieux de 850 ans. Aux XIIe et XIIIe siècle, l’École de Notre-Dame naît avec les perspectives acoustiques nouvelles offertes par l’architecture extraordinaire de la cathédrale flambant neuve. Entre l’an 1160 et 1250, Notre-Dame de Paris devient ainsi le centre d’un rayonnement musical qui atteint bientôt les confins de l’Europe. «Très vite, les procédés des compositeurs de cette «École» seront imités, copiés, chantés dans les grandes églises de France puis dans toute l’Europe. Cette diffusion exceptionnelle pour l’époque s’explique par le génie des créateurs parisiens, au premier rang desquels figurent les fameux Léonin et Pérotin, mais aussi par la renommée et la prépondérance extraordinaire de Paris au début du XIIIe siècle, ville lumière déjà surnommée Mater artium (Mère des Arts), Secunda Athena (Seconde Athènes), Paris expers Paris (Paris sans égal)» résume Antoine Guerber, directeur d’un ensemble musical de chant médiéval et fin connaisseur de cette période.
À Notre-Dame de Paris, le chant polyphonique connaît un premier apogée: une troisième, puis une quatrième voix sont ajoutées à l’organum, le chant sacré grégorien ; et les grands compositeurs de l’époque introduisent peu à peu des éléments de rythme, posant là certaines bases de l’harmonie occidentale. Le travail de Pérotin, l’un des rares compositeurs de l’époque dont on ait gardé la trace, sera poursuivi par ses élèves qui diviseront en trois la maxime, l’unité de mesure de la note musicale. C’est le règne de l’Ars antiqua, période musicale qui verra également naître le motet, une invention médiévale qu’on verra refleurir sous la période baroque puis dans certaines compositions romantiques…
De nombreux élèves dénoncent une altération de l’identité de la Maîtrise.
Mais voilà: gardien de ce patrimoine pluriséculaire, le professeur de musique médiévale Sylvain Dieudonné, dont la connaissance du chant grégorien lui a valu une renommée internationale, s’est vu signifier son licenciement par la direction de la Maîtrise. Aussitôt de nombreux élèves, anciens élèves et professeurs de Notre-Dame de Paris se sont empressés de lui témoigner leur soutien, devant une décision qu’ils qualifient d’abusive et d’injustifiée. Il faut préciser toutefois que la situation financière de la Maîtrise de Notre-Dame est alarmante: depuis l’incendie de la cathédrale, la direction a lancé un appel au mécénat, indiquant que le quart de ses recettes vient à manquer. Une partie des concerts prévus pour la saison a été annulée ; les autres furent maintenus, mais dans d’autres églises, et force est de constater que lorsqu’elle ne se produit plus sous les voûtes de la cathédrale, la Maîtrise peine à réunir un public aussi nombreux qu’auparavant.



 « Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, théologien dogmatique, a été évêque de Ratisbonne (2002-2012), en Allemagne, puis préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi de 2012 à 2017. Il a été chargé par Benoît XVI de l’édition de ses œuvres complètes. Il nous parle ici du synode sur l’Amazonie et de la situation de l’Église en Allemagne. Entretien exclusif.
« Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, théologien dogmatique, a été évêque de Ratisbonne (2002-2012), en Allemagne, puis préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi de 2012 à 2017. Il a été chargé par Benoît XVI de l’édition de ses œuvres complètes. Il nous parle ici du synode sur l’Amazonie et de la situation de l’Église en Allemagne. Entretien exclusif.


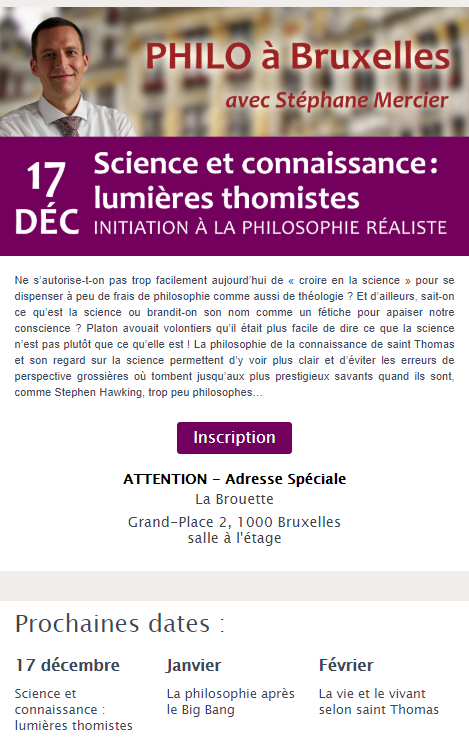



 « Remise en cause du célibat sacerdotal dans l’Église latine et « ministères féminins » sont deux thèmes du synode sur l’Amazonie qui soulèvent questions et inquiétudes. Analyses :
« Remise en cause du célibat sacerdotal dans l’Église latine et « ministères féminins » sont deux thèmes du synode sur l’Amazonie qui soulèvent questions et inquiétudes. Analyses :