 Mais qu’allait-il faire dans cette galère ? Lu sur « Diakonos » cet article de Sandro Magister, le vaticaniste de l’ « Espresso » :
Mais qu’allait-il faire dans cette galère ? Lu sur « Diakonos » cet article de Sandro Magister, le vaticaniste de l’ « Espresso » :
« Après l’annulation de la rencontre prévue au Kazakhstan avec le patriarche de Moscou Cyrille, le Pape François n’a pas non plus pu rencontrer, à Nour-Sultan, aujourd’hui de nouveau appelée Astana, le président chinois Xi Jinping, qui était pourtant en visite d’État dans la capitale kazakhe ce mercredi 14 septembre, le jour même où le Pape réaffirmait le droit « élémentaire et inaliénable » à la liberté religieuse, qui ne doit pas être seulement intérieure ou cultuelle mais surtout « le droit de chaque personne à témoigner publiquement de sa propre foi », tout l’opposé de ce qui se passe en Chine.
Cette rencontre avec Xi avait été demandée plusieurs jours à l’avance par le Vatican – comme l’a révélé l’agence Reuters – mais côté chinois, on a répondu qu’on n’avait pas le temps de l’organiser. Et déjà sur le vol aller de Rome vers le Kazakhstan, le Pape François avait déclaré ne plus avoir aucune nouvelle.
Mais ensuite, lors de la conférence de presse sur le vol de retour à Rome (photo), le Pape a reparlé abondamment de la Chine, en réponse à une question d’Elise Anna Allen de « Crux », qui lui rappelait qu’à Hong Kong, le procès contre le cardinal Zen Zekiun était sur le point de s’ouvrir et qui lui demandait s’il considérait que ce procès constituait « une violation de la liberté religieuse ».
La transcription officielle de la réponse du Pape François vaut la peine d’être lue dans son intégralité, avec ses balbutiements, ses réticences et ses bizarreries, parce qu’elle constitue un condensé parfait de son approche sur la Chine :
« Pour comprendre la Chine, il faut un siècle, et nous ne vivons pas un siècle. La mentalité chinoise est une mentalité riche et quand elle tombe malade, elle perd un peu de sa richesse, elle est capable de commettre des erreurs. Pour bien comprendre, nous avons fait le choix du dialogue, ouverts au dialogue. Il y a une commission bilatérale Vatican-Chine qui avance bien, lentement, parce que le rythme chinois est lent, eux ils ont une éternité pour aller de l’avant : c’est un peuple d’une patience infinie. Mais des expériences que j’ai eues auparavant – pensons aux missionnaires italiens qui sont allés là et qui ont été respectés comme scientifiques, pensons, aujourd’hui encore, à tant de prêtres et de croyants qui ont été appelés par l’université chinoise parce que cela met la culture en valeur -, ce n’est pas facile de comprendre la mentalité chinoise, il faut la respecter, moi je respecte toujours. Et ici, au Vatican, il y a une commission de dialogue qui fonctionne bien. C’est le cardinal Parolin qui la préside et en ce moment c’est l’homme qui connaît le mieux la Chine et le dialogue chinois. C’est quelque chose de lent, mais on fait des petits pas en avant. Qualifier la Chine d’antidémocratique, moi je ne le ferais pas, parce que c’est un pays si complexe, avec ses rythmes… Oui, c’est vrai qu’il y a des choses qui ne nous semblent pas démocratiques, ça c’est vrai. Le cardinal Zen, qui est âgé, sera jugé ces prochains jours, je crois. Lui, il dit ce qu’il entend, et on voit bien que là, il y a des limitations. Plus que de donner des qualificatifs, parce que c’est difficile, et je ne me sens pas en mesure de donner des qualifications, ce sont des impressions ; plus que de donner des qualifications, moi je cherche la voie du dialogue. Ensuite, dans le dialogue, on peut éclaircir tant de choses et pas seulement concernant l’Église, d’autres secteurs aussi. Par exemple, l’étendue de la Chine : les gouverneurs de province sont tous différents, il y a des cultures différentes au sein de la Chine. C’est un géant, comprendre la Chine, c’est quelque chose de géant. Il ne faut pas perdre patience, il en faut, il en faut beaucoup, mais nous ne devons pas mettre le dialogue en péril. Moi j’essaye d’éviter de donner des qualificatifs parce que oui, peut-être, mais allons de l’avant ».

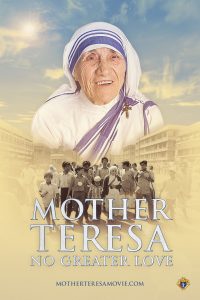
 La Curie agressive du pape François étoufferait-t-elle déjà le mouvement tradi ? Lu sur le site web « Riposte catholique » :
La Curie agressive du pape François étoufferait-t-elle déjà le mouvement tradi ? Lu sur le site web « Riposte catholique » :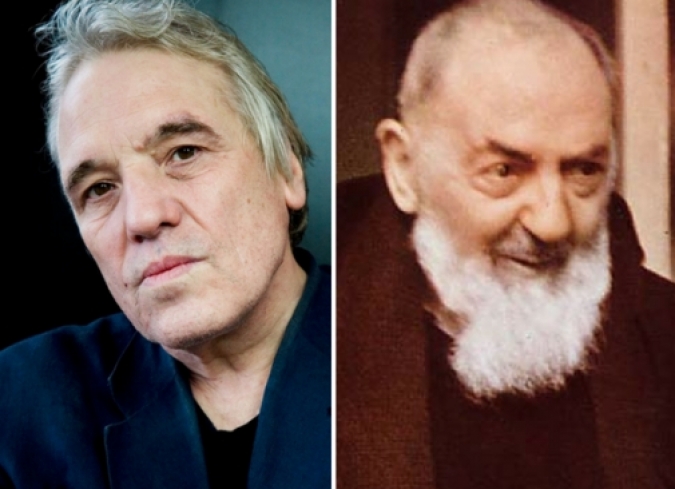
 Vers une guerre de cent ans? La « chasse aux tradis » et la volonté d’en découdre est obstinément à l’œuvre dans la curie romaine:
Vers une guerre de cent ans? La « chasse aux tradis » et la volonté d’en découdre est obstinément à l’œuvre dans la curie romaine:  « Le pape François accueille hier le nouveau cardinal anglais Arthur Roche, préfet du Dicastère pour le culte divin et les sacrements, lors d'un consistoire pour la création de 20 nouveaux cardinaux.
« Le pape François accueille hier le nouveau cardinal anglais Arthur Roche, préfet du Dicastère pour le culte divin et les sacrements, lors d'un consistoire pour la création de 20 nouveaux cardinaux.