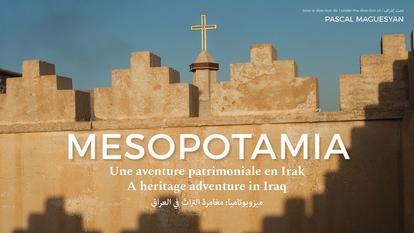De Charles-Henri d'Andigné sur le site de l'hebdomadaire Famille Chrétienne :
Rémi Brague : « L’islamisme, c’est l’islam poussé jusqu’au bout »
16/10/2019Le Coran encourage-t-il la violence ? L'islam est-il compatible avec la démocratie ? La fatwa lancée contre Samuel Paty, ce professeur de Conflans-Sainte-Honorine égorgé le 16 octobre, interroge sur les liens entre religion musulmane et violence. Sans tomber dans l'amalgame, le philosophe Rémi Brague pointe les contradictions du Coran et des sourates. Entretien.
La différence entre islam et islamisme est réelle, mais ma conviction est qu’elle est de degré et non de nature. L’islamisme, c’est l’islam poussé jusqu’au bout. L’islam dont on tire les dernières conséquences. C’est tout de même une drôle de religion qu’une religion telle que ses convertis peuvent être poussés à tuer leur prochain. Quand on se convertit au bouddhisme, on peut se faire végétarien ; quand on se convertit au christianisme, on essaie d’aimer son prochain comme soi-même, ce qui n’est pas de la tarte... Certains convertis à l’islam comprennent qu’il faut tuer son prochain d’une manière précise, en l’égorgeant.
Est-ce à dire que tous les musulmans sont des terroristes en puissance !?
Je ne dis évidemment pas que tous les musulmans sont violents, ni non plus qu’il n’y a dans l’islam que de la violence. Mais je dis qu’il y a dans les sources islamiques tout ce qu’il faut pour justifier l’usage de la violence. On va le chercher ou on ne va pas le chercher. Regardez les autorités musulmanes de fait, comme la mosquée Al-Azhar : elles ont été très gênées par l’État islamique, qui ne faisait que ce que raconte la biographie du Prophète. Marier des guerriers avec des gamines de 9 ans, c’est ce que le prophète a fait avec Aïcha. Quand l’État islamique a brûlé vif un pilote jordanien, ils l’ont justifié ainsi : c’est le Talion, il a jeté des bombes. Leurs arguments sont solides !
Il y a dans les sources islamiques tout ce qu’il faut pour justifier l’usage de la violence.
La violence islamique, dit Jean Duchesne, est le fruit de la rencontre entre l’islam et l’Occident. Qu’en pensez-vous ?
Il y a beaucoup de vrai dans cette idée. D’autant que cette rencontre s’est inversée. Au XIXe siècle, c’était l’Occident qui entrait dans les sociétés musulmanes, via la colonisation. Aujourd’hui, les musulmans font ce que la charia interdit en principe, à savoir s’installer volontairement dans un pays de mécréants. L’islam s’en trouve exacerbé. Les musulmans se retrouvent dans le « monde de la guerre », c’est-à-dire non pacifié, non soumis à l’islam. Dans le monde de la guerre, il n’est pas absurde de se conduire en guerrier.
/image%2F0962328%2F20201013%2Fob_65fcb1_incroyables-chretiens.jpg)