Du site de la revue Item :
13 janvier 2020
Mai 68, la pédophilie et la lucidité de Benoît XVI
Benoît XVI est le pape qui a décidé d’éradiquer, autant que faire se peut, la pédophilie dans l’Eglise par des décisions fermes et constantes frappant les prêtres et évêques coupables, ainsi que par des mesures préventives. François n’a fait que prolonger cette action.
Mais le pape émérite est aussi celui qui, avec le plus de lucidité, a mis au jour les racines de la permis-sivité ayant fait prospérer cette perversion sexuelle dont les enfants sont victimes. « La révolution de 1968 s’est battue pour une complète liberté sexuelle, qui n’admettait plus de normes » a dénoncé l’ancien pontife en avril dernier, « la pédophilie a alors également été diagnostiquée comme permise et appropriée. »
Dans l’Eglise, ce vice s’est propagé à cause de clercs pervertis, certes, mais encouragés par un courant de la théologie catholique qui a introduit dans l’Eglise un relativisme éthique selon lequel, résume le pape Benoît, « Il ne pouvait y avoir quoi que ce soit d’absolument bon, ni quoi que ce soit d’absolument mauvais, mais seulement des appréciations relatives. » Ces théoriciens ont mis « radicalement en question l’autorité de l’Eglise dans le domaine moral » et provoqué « un effondrement »de son enseignement dans ce domaine. La gauche a poussé des cris d’orfraie, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’Eglise, devant cette dénonciation par l’an-cien occupant du trône de Pierre, car pour la gauche mai 68 fut seulement un « grand moment de liberté » que bafouait Benoît XVI, dépeint comme un affreux réactionnaire.
Or, après l’avoir insulté, ceux-là viennent de confirmer la juste analyse du prédécesseur du pape François. A la lu-mière de la triste affaire Matzneff ceux qui l’ont soutenu confessent, pour se disculper de leur responsabilité personnelle, que c’est celle de mai 68 : ce n’est pas eux mais l’époque héritière de l’idéologie soixante-huitarde qui leur a fait cautionner la pé-dophilie. Ils seraient en quelque sorte des… victimes de ce printemps-là alors qu’ils en étaient les acteurs ou les continuateurs !
Ils confirment que c’est le « il est interdit d’interdire » et autres « jouir sans entraves » qui ont fait les beaux jours des pédo-philes et de ceux qui les défendaient au nom de la liberté sexuelle, un « acquis » de mai 68. Une liberté sans « normes » comme le dit Benoît XVI, sans limites, sans interdits. « Si on peut faire l’amour librement avec tout le monde, alors pourquoi pas avec des enfants ? » telle était la justification des intellectuels de gauche, rappelle Virginie Girod, docteur en histoire, spécialiste de l’histoire des femmes et de la sexualité. Elle ajoute cette précision : seuls « les journaux de droite, France-Soir et Minute » s’insurgent. C’est la grande époque de Libération qui fut un haut lieu (avec Le Monde et… Charlie Hebdo) des pourrisseurs. Et l’un des anciens responsables de Libération, Sorj Chalandon, explique que dans son journal « L’interdiction, n’im-porte laquelle, est ressentie comme appartenant au vieux monde, à celui des aigris, des oppresseurs, des milices patronales, des policiers matraqueurs, des corrompus. » Cette feuille anarcho-sartrienne publiait des petites annonces de « rencontres » sexuelles où des adultes sollicitaient des rendez-vous avec des mineurs de « 12 à 18 ans. »
C’est dans ce même journal, en 1977, qu’était triomphalement annoncé le Front de libération des pédophiles. De nos jours, la classe politico-médiatique, à l’unisson des groupes de pression homosexuels, proteste quand tel ou tel semble assimiler pédophilie et homosexualité, lesquelles, paraît-il, n’auraient rien à voir : « pas d’amalgame !» crient-ils. Or, le fait est que, en 1968 et les années suivantes, les militants qui défendent le droit de « faire l’amour » avec des enfants sont tous homosexuels ou, comme Matzneff, bisexuels.
L’organe principal de cette croisade en faveur des pédophiles, était celui des homosexuels, le Gai Pied.
Certes, la pédophilie n’a pas commencé en 1968, elle a toujours existé, hélas, comme le viol ou l’inceste. Dans les temps anciens, on ne parlait pas de « pédophiles » mais de « satyres »… Auparavant, les pervers ne s’en vantaient pas et souvent ils en étaient même honteux ; ils n’écrivaient pas, noir sur blanc ce qu’ils faisaient subir à leurs victimes en prétendant que c’était par amour, comme Matzneff, et que les gamins en étaient très heureux.
Surtout, ils n’avaient pas la possibilité de faire du prosélytisme pour ce que Matzneff appelle lui-même « notre secte », celle des amateurs de petits garçons et de très jeunes filles. Dès les années 1990, le psychiatre Bernard Cordier le rappelait : « Un écrivain comme Gabriel Matzneff n’hésite pas à faire du prosélytisme. Il est pédophile et s’en vante dans des récits qui ressemblent à des modes d’emploi. » Si ceux qui s’en vantent et soutiennent ces infâmes pratiques appartiennent au monde politico-littéraire et journalistique, leur influence dépasse ce cercle-là. Le docteur Cordier constate que «Ces écrits rassurent et encouragent ceux qui souffrent de leur préférence sexuelle, en leur suggérant qu’ils ne sont pas les seuls de leur espèce. D’ailleurs, les pédophiles sont très attentifs aux réactions de la société française à l’égard du cas Matzneff. Les intellectuels complaisants leur fournissent un alibi et des arguments : si des gens éclairés défendent cet écri-vain, n’est-ce pas la preuve que les adversaires des pédophiles sont des coincés, menant des combats d’arrière-garde ? » La justice s’intéresse maintenant au cas Matzneff et a ouvert une enquête pour viols sur mineurs. Il est bien temps, alors qu’il sévit depuis au moins quarante ans !



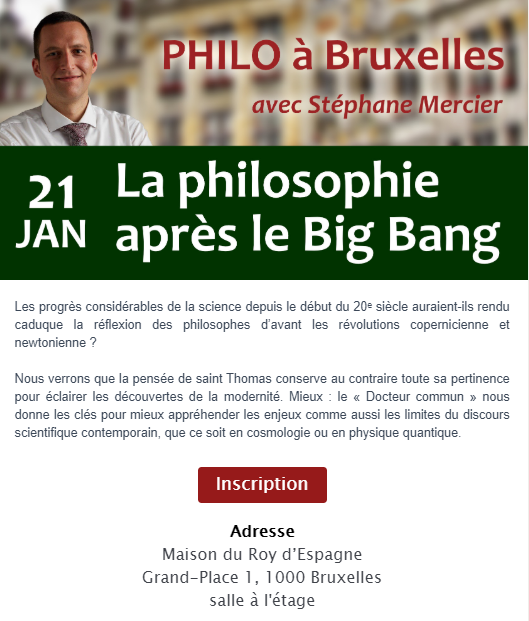



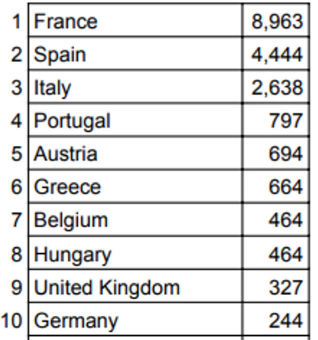



 "
"