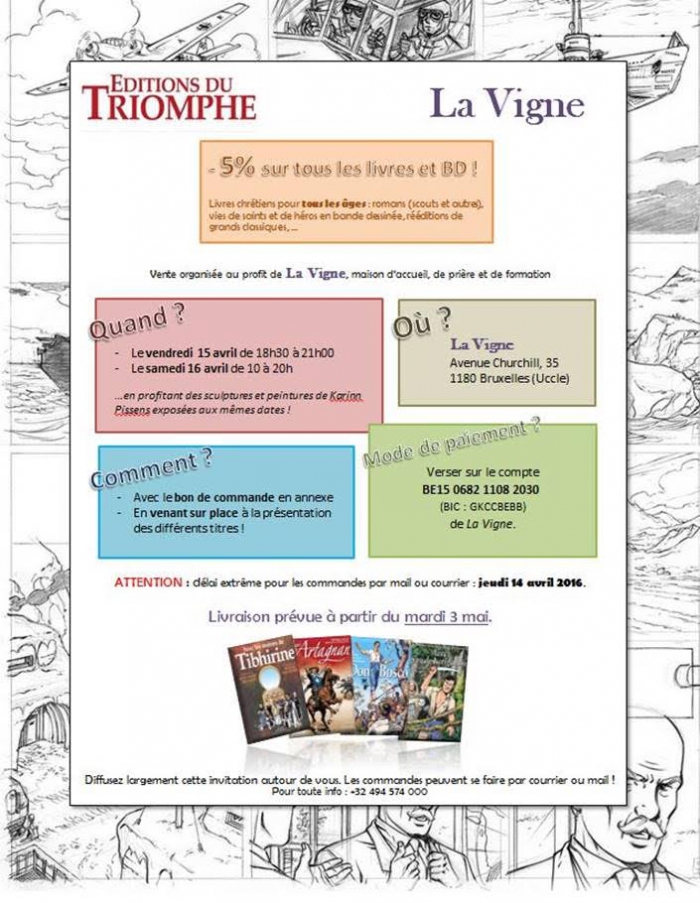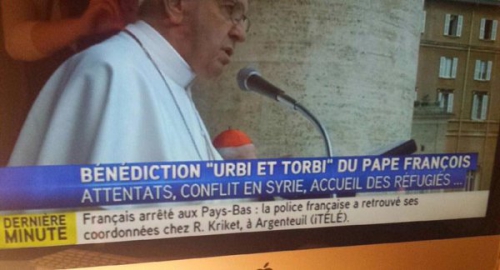De Radio Vatican :
Le Pape François invite à résister aux persécutions symboliques et à «la grande apostasie»
(RV) «La persécution est le pain quotidien de l’Église» : le Pape l’a répété lors de la messe de ce mardi 12 avril, célébrée dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe.
Comme c’est arrivé à Étienne, le premier martyr, ou aux «petits martyrs» tués par Hérode, aussi aujourd’hui, a affirmé le Pape, de nombreux chrétiens sont tués pour leur foi en Christ, et d’autres sont persécutés idéologiquement, parce qu’ils veulent manifester la valeur du fait d’être enfants de Dieu.
Il existe des persécutions sanguinaires, comme le fait d’être dévorés par des fauves pour la joie du public dans les tribunes, ou pulvérisés par une bombe à la sortie de la messe. Et il y a «des persécutions en gants blancs, des persécutions culturelles, celles qui te confinent dans un recoin de la société, qui en viennent à te faire perdre ton travail si tu n’adhères pas aux lois qui vont contre Dieu Créateur», a affirmé le Saint-Père.
Martyrs de tous les jours
Le récit du martyre d’Étienne, décrit dans l’extrait des Actes des Apôtres proposé par la liturgie, pousse le Pape à des considérations nouvelles sur une réalité qui depuis 2000 ans fait partie de l’histoire de la foi chrétienne : la persécution.
«La persécution, je dirais, est le pain quotidien de l’Église. Jésus l’a dit. Nous, quand nous faisons un peu de tourisme à Rome et allons au Colisée, nous pensons que les martyrs étaient ceux qui étaient tués avec les lions. Mais les martyrs n’ont pas été seulement ceux-là. Ce sont des hommes et femmes de tous les jours : aujourd’hui, le jour de Pâques, il y a à peine trois semaines… Ces chrétiens qui fêtaient Pâques au Pakistan ont été martyrisés justement parce qu’ils fêtaient le Christ Ressuscité. Et ainsi l’histoire de l’Église avance avec ses martyrs.»
Des persécutions «éduquées»
Le martyre d’Étienne amorça une cruelle persécution antichrétienne à Jérusalem, analogue à celles subies par ceux qui aujourd’hui ne sont pas libres de professeur leur foi en Jésus. «Mais, a observé François, il y a une autre persécution dont on ne parle pas tellement», une persécution «travestie de culture, travestie de modernité, travestie de progrès».
«C’est une persécution, je dirais un peu ironiquement, "éduquée". C’est quand l’homme est persécuté non pas pour avoir confessé le nom du Christ, mais pour avoir voulu manifesté les valeurs du Fils de Dieu. C’est une persécution contre Dieu le Créateur, dans la personne de ses enfants ! Et ainsi nous voyons tous les jours que les puissances font des lois qui obligent à aller sur cette voie, et une nation qui ne suit pas ces lois modernes, ou au moins qui ne veut pas les avoir dans sa législation, en vient à être accusée, à être persécutée "poliment". C’est la persécution qui coupe à l’homme la liberté de l’objection de conscience», a martelé le Pape François
La grande apostasie
«Cela, c’est la persécution du monde» qui «coupe la liberté», alors que «Dieu nous fait libres» de donner le témoignage «du Père qui nous a créés, et du Christ qui nous a sauvés». Et cette persécution, a-t-il souligné, «a aussi un chef» :
«Le chef de la persécution polie, éduquée, Jésus l’a nommé : "le prince de ce monde". Et quand les puissances veulent imposer des attitudes, des lois contre la dignité des enfants de Dieu, ils persécutent ceux-ci et vont contre le Dieu Créateur, a répété le Souverain pontife. C’est la grande apostasie. Ainsi la vie des chrétiens avance avec ces deux persécutions. Mais le Seigneur nous a promis de ne pas s’éloigner de nous : "Soyez attentifs, soyez attentifs ! Ne tombez pas dans l’esprit du monde. Soyez attentifs ! Mais allez de l’avant ! Moi, Je serai avec vous”».
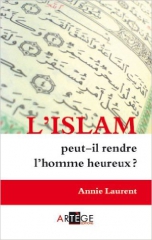 De Stéphane Seminckx
De Stéphane Seminckx