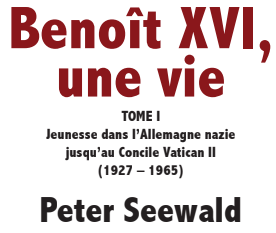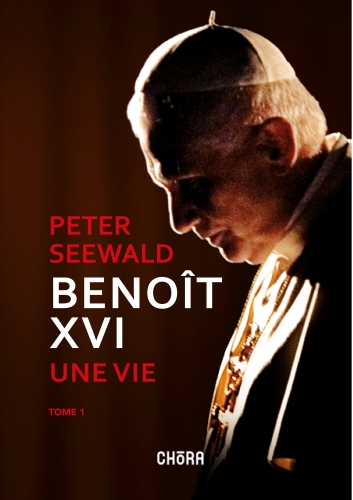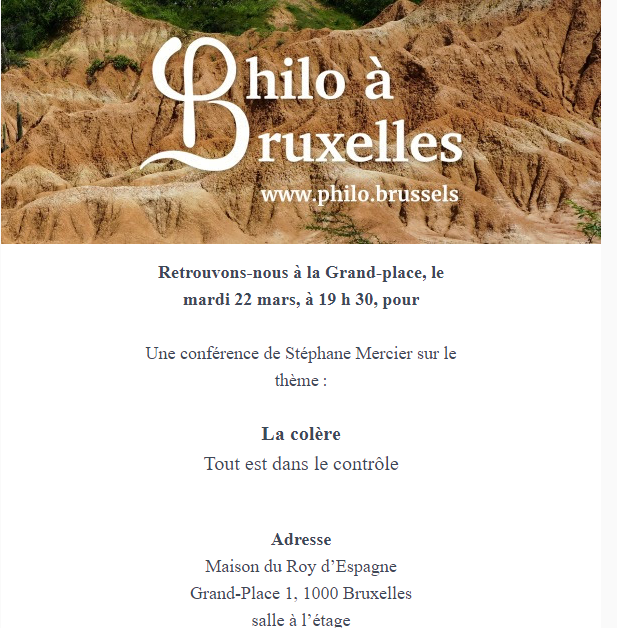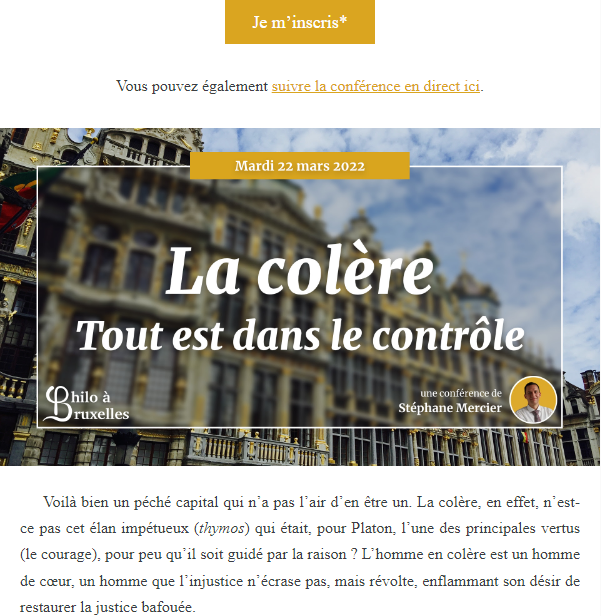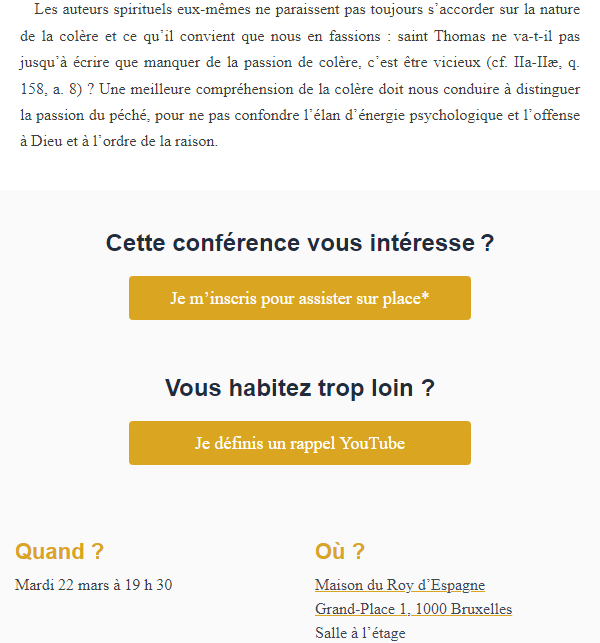10 mars 2022
FIGAROVOX/ENTRETIEN – L’académicien franco-russe, prix Goncourt 1995, s’afflige de voir l’Ukraine transformée en «chaudron guerrier». Il se défend d’être pro-Kremlin et regrette une vision «manichéenne» du conflit «qui empêche tout débat».
Andreï Makine, né en Sibérie, a publié une douzaine de romans traduits dans plus de quarante langues, parmi lesquels Le Testament français(prix Goncourt et prix Médicis 1995), La Musique d’une vie (éd. Seuil, 2001), et, plus récemment, Une femme aimée (Seuil). Il a été élu à l’Académie française en 2016.
FIGAROVOX. – En tant qu’écrivain d’origine russe, que vous inspire cette guerre ?
Andreï MAKINE. – Pour moi, elle était impensable. J’ai en tête les visages de mes amis ukrainiens à Moscou, que je voyais avant tout comme des amis, pas comme des Ukrainiens. Le visage de leurs enfants et de leurs petits-enfants, qui sont dans ce chaudron guerrier. Je plains les Ukrainiens qui meurent sous les bombes, tout comme les jeunes soldats russes engagés dans cette guerre fratricide. Le sort du peuple qui souffre m’importe davantage que celui des élites. Comme le disait Paul Valéry, «la guerre, ce sont des hommes qui ne se connaissant pas et qui se massacrent au profit d’hommes qui se connaissent et ne se massacrent pas».
Une partie de la presse vous qualifie d’écrivain pro-Poutine. L’êtes-vous ?
C’est une journaliste de l’AFP qui m’a collé cette étiquette il y a une vingtaine d’années. C’était juste après le départ de Boris Eltsine dont le bilan était catastrophique pour la Russie. Je lui avais expliqué que Eltsine, dans un état d’ébriété permanent, avec la responsabilité du bouton atomique, représentait un vrai danger. Et que j’espérais que la Russie pourrait devenir un peu plus rationnelle et pragmatique à l’avenir. Mais elle a titré : «Makine défend le pragmatisme de Poutine». Comme c’était une dépêche de l’AFP, cela a été repris partout. Et lorsque je suis entré à l’Académie, un grand hebdo, dont par charité je tairai le nom, a, à son tour, titré : «Makine, un Poutinien à l’Académie»… Cela en dit long sur le monde de mensonge dans lequel nous vivons.
Vous condamnez l’intervention russe…
Mon opposition à cette guerre, à toutes les guerres, ne doit pas devenir une sorte de mantra, un certificat de civisme pour les intellectuels en mal de publicité, qui tous cherchent l’onction de la doxa moralisatrice. À force de répéter des évidences, on ne propose absolument rien et on en reste à une vision manichéenne qui empêche tout débat et toute compréhension de cette tragédie. On peut dénoncer la décision de Vladimir Poutine, cracher sur la Russie, mais cela ne résoudra rien, n’aidera pas les Ukrainiens.
Pour pouvoir arrêter cette guerre, il faut comprendre les antécédents qui l’ont rendue possible. La guerre dans le Donbass dure depuis huit ans et a fait 13 000 morts, et autant de blessés, y compris des enfants. Je regrette le silence politique et médiatique qui l’entoure, l’indifférence à l’égard des morts dès lors qu’ils sont russophones. Dire cela, ne signifie pas justifier la politique de Vladimir Poutine. De même que s’interroger sur le rôle belliciste des États-Unis, présents à tous les étages de la gouvernance ukrainienne avant et pendant la «révolution du Maïdan», n’équivaut pas à dédouaner le maître du Kremlin. Enfin, il faut garder à l’esprit le précédent constitué par le bombardement de Belgrade et la destruction de la Serbie par l’Otan en 1999 sans avoir obtenu l’approbation du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour la Russie, cela a été vécu comme une humiliation et un exemple à retenir. La guerre du Kosovo a marqué la mémoire nationale russe et ses dirigeants.
Lorsque Vladimir Poutine affirme que la Russie est menacée, ce n’est pas un « prétexte » : à tort ou à raison, les Russes se sentent réellement assiégés. Andreï Makine
Lorsque Vladimir Poutine affirme que la Russie est menacée, ce n’est pas un «prétexte» : à tort ou à raison, les Russes se sentent réellement assiégés, et cela découle de cette histoire, ainsi que des interventions militaires en Afghanistan, en Irak et en Libye. Une conversation rapportée entre Poutine et le président du Kazakhstan résume tout. Ce dernier tente de convaincre Poutine que l’installation de bases américaines sur son territoire ne représenterait pas une menace pour la Russie, qui pourrait s’entendre avec les États-Unis. Avec un petit sourire triste, Poutine répond : «C’est exactement ce que disait Saddam Hussein !».
Encore une fois, je ne légitime en aucune manière la guerre, mais l’important n’est pas ce que je pense, ni ce que nous pensons. En Europe, nous sommes tous contre cette guerre. Mais il faut comprendre ce que pense Poutine, et surtout ce que pensent les Russes, ou du moins une grande partie d’entre eux.