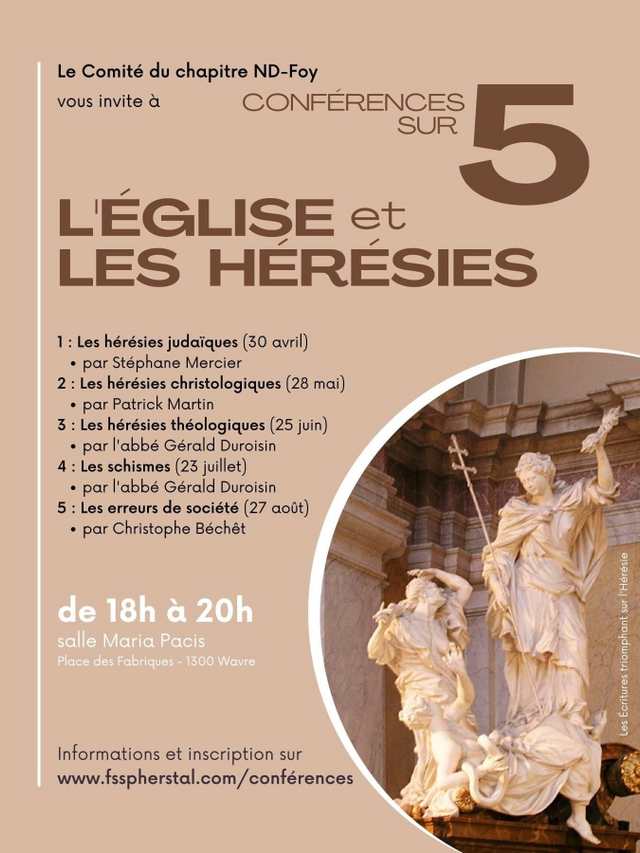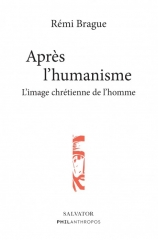 Rémi Brague est professeur émérite de philosophie médiévale, arabe et juive. Membre de l’Institut de France et auteur d’une œuvre importante. Voici, le texte de interview qu’il a accordée à Christophe Geffroy, fondateur et directeur du mensuel La Nef à propos de son dernier livre : « Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme » Salvator, 2022, 210 pages, 20 € :
Rémi Brague est professeur émérite de philosophie médiévale, arabe et juive. Membre de l’Institut de France et auteur d’une œuvre importante. Voici, le texte de interview qu’il a accordée à Christophe Geffroy, fondateur et directeur du mensuel La Nef à propos de son dernier livre : « Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme » Salvator, 2022, 210 pages, 20 € :
« La Nef – Pourquoi s’intéresser à une définition de l’homme, en quoi est-elle nécessaire ? Et est-il seulement possible de « définir » l’homme dont vous dites bien qu’il est « mystère » comme le Dieu dont il est l’image ?
Rémi Brague – Ce que je défends est qu’il faut se méfier de toute définition de l’homme qui serait, selon l’étymologie, une façon de fixer des limites (latin : finis) à l’humain. Ce qui mène à exclure tout ce qui ne satisfait pas aux critères. D’abord les fœtus ou les nourrissons encore incapables de poser les actes par lesquels on peut identifier l’humain comme la parole. Puis les comateux aux encéphalogrammes plats. On en vient aisément, et l’histoire récente nous en fournit des exemples concrets, à décider qu’il y a des « sous-hommes » qui mènent une « vie qui ne vaut pas d’être vécue » (lebensunwertes Leben), etc.
C’est d’avoir voulu être trop humain, en centrant trop le regard sur l’homme, que l’humanisme s’est épuisé : comment en est-il arrivé là, était-ce inscrit dans l’humanisme originel ?
Que l’homme soit au centre, admettons, mais sans oublier qu’au centre du village, il n’y a pas que le trône, mais aussi le pilori… Mais au centre de quoi au juste ? Je dirais donc plutôt que l’humanisme s’est rabougri en perdant de vue le contexte à l’intérieur duquel l’humain prend son sens. On peut le penser ce contexte en différents styles. Pour les Anciens, c’était le monde physique en son bel ordre – en grec : kosmos. L’homme en était le sommet, non le tyran, mais plutôt le chef-d’œuvre, le vivant qui réalise le mieux les intentions de la Nature. Il le faisait par la pratique des vertus. Pour la Bible, ce contexte est Dieu. L’homme en est l’image. Pour se montrer à la hauteur de cette vocation, il se guide sur les commandements donnés par le Dieu créateur et libérateur.
Le fait de définir l’homme par lui-même comme le fait un certain humanisme conduit non pas à l’échec, écrivez-vous, « mais à une réussite telle qu’elle aboutit à l’opposé de ce qui était recherché » : pourriez-vous nous l’expliquer ?
La définition de soi par soi est l’aspect théorique d’une attitude pratique, la recherche de l’autonomie. Or, la détermination de soi par soi est neutre : elle peut être positive, mais aussi négative. Dans mes Ancres dans le ciel (2009), j’ai fait un peu d’humour noir en rappelant que le suicide était aussi une façon de se déterminer soi-même. Voire, plus efficacement que tout essai pour s’améliorer physiquement ou moralement.
Pourquoi la tentation de créer un « homme nouveau » conduit-elle au désastre ?
Je laisse de côté le problème du prétendu « transhumanisme » : techniquement faisable ? moralement justifiable ? etc. Mais le projet de créer un « homme nouveau » est ancien. Voyez le livre de Dalmacio Negro, El mito del hombre nuevo (2009), qu’il faudrait traduire. L’ennui c’est que le créateur d’un éventuel « homme nouveau » resterait un « homme ancien », gouverné non par la recherche de la sainteté, mais plutôt par celle du pouvoir. On n’obtiendra qu’une version augmentée de cet « homme ancien ». Celui que saint Paul appelle le « vieil homme » aura reçu son masque au concombre, voilà tout. L’élévation se réduira à un lifting…