Tous les chemins mènent-ils encore rapidement à Rome, comme les voies romaines de jadis ? Lu dans le mensuel « La Nef » (février 2022) :
 « Diane Sévillia est mère de prêtre et membre de l’équipe de La Voie romaine qu’elle nous présente.
« Diane Sévillia est mère de prêtre et membre de l’équipe de La Voie romaine qu’elle nous présente.
La Nef – Qu’est-ce que La Voie romaine, comment est née cette initiative, qui en est à l’origine et quel but poursuivez-vous ?
Diane Sévillia – La Voie romaine est une association fondée par des catholiques attachés à la liturgie traditionnelle et qui, jeunes parents ou célibataires, appartiennent à la génération qui a grandi dans l’esprit du motu proprio Ecclesia Dei de Jean-Paul II en 1988 puis du motu proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI en 2007. Sans nier la légitimité et la validité de l’Ordo de 1970, qu’ils pratiquent selon leurs activités ou leurs déplacements, ils ont fait le choix préférentiel de la messe traditionnelle, comme l’Église leur en a donné le droit, parce qu’ils estiment que leur foi est mieux nourrie par cette liturgie. L’initiative de la Voie romaine revient à Benoît Sévillia, frère et ami de nombreux prêtres des instituts Ecclesia Dei. L’objectif de l’association est de faire connaître au Saint-Père, par des lettres qui seront portées à Rome, la stupeur et l’incompréhension des fidèles attachés à la liturgie ancienne face au motu proprio Traditionis custodes, et plus encore devant ses conditions d’application très strictes. Mises en œuvre littéralement, celles-ci aboutiraient à la suppression du rite tridentin et empêcheraient les prêtres voués à cette liturgie d’exercer leur ministère. Il y a là une injustice face à laquelle les laïcs sont en droit de manifester respectueusement leur peine, et un ébranlement très profond pour eux qui doit être entendu par l’Église car il les frappe au cœur de leur foi.
Qui sollicitez-vous pour écrire au pape François ? Et pensez-vous que de tels témoignages puissent modifier le motu proprio Traditionis custodes ?
Des mères de prêtres, inquiètes pour leurs fils, ont eu l’idée d’envoyer un message au pape. De là est né le projet de faire écrire les catholiques attachés de différentes manières à ce rite et de les porter à Rome, à pied, lors d’une longue marche-pèlerinage à travers la France et l’Italie. Le but poursuivi est d’attirer l’attention du clergé, des fidèles et surtout du pape, afin de lui montrer à quel point les catholiques restés fidèles au Saint-Siège et attachés au rite traditionnel ne sont pas des catholiques de seconde zone. Nous espérons obtenir une audience à Rome. Quel en sera le résultat ? Dieu en décidera. Nous espérons au moins que les dispositions touchant les prêtres célébrant le rite tridentin seront allégées. Nous allons prier et implorer la Vierge Marie et tous les saints lors de notre longue route.
Comment expliquez-vous ce ton si sévère de Rome à l’égard de catholiques qui sont pourtant des brebis parmi d’autres dans l’Église ? Voyez-vous quand même une part de vérité dans les reproches du pape aux « traditionalistes » ?
Je sais qu’il existera toujours des personnes plus ultras que d’autres, mais on ne fait pas une loi pour un cas particulier. Si je regarde autour de moi, parmi mes amis qui assistent habituellement à la messe traditionnelle, aucun ne refuse d’aller à la messe de Paul VI, aucun ne nie la légitimité de Vatican II, même si certains textes du concile peuvent donner matière à discussion, comme il en a toujours été dans l’Église, et aucun ne croit appartenir à la « vraie Église ». Les reproches exprimés dans le motu proprio Traditionis custodes me semblent donc hors de propos. Dans le diocèse où j’habite, celui de Versailles, les relations entre les communautés traditionnelles et le clergé diocésain sont totalement pacifiées. Quant aux questions qui se posent aux prêtres, je n’ai pas à en juger car je ne suis qu’une mère de famille. Tout ce que je sais est qu’ils n’ont commis aucune désobéissance par rapport aux règles qui leur ont été données par l’Église. Et qu’ils ont un dévouement sans limite pour leurs brebis.


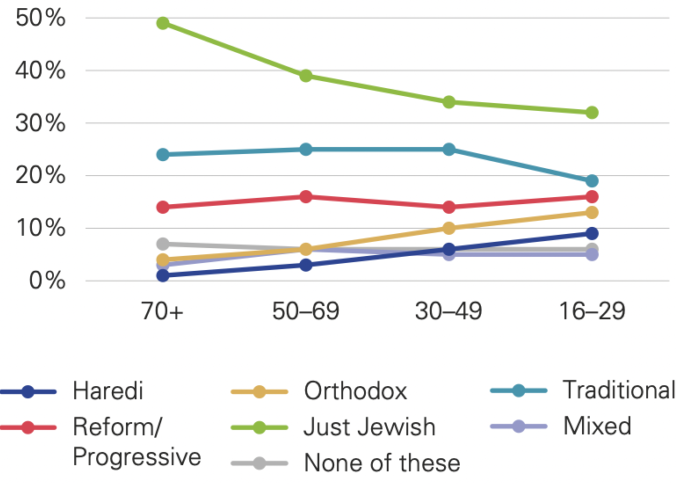
 Le Roi des Belges Philippe et la Reine Mathilde effectueront une visite officielle en République démocratique du Congo le mois prochain, a annoncé le Palais mercredi.
Le Roi des Belges Philippe et la Reine Mathilde effectueront une visite officielle en République démocratique du Congo le mois prochain, a annoncé le Palais mercredi.