Une lettre adressée au président de la république française qui pourrait tout aussi bien l'être aux excellences qui nous gouvernent : http://www.koztoujours.fr/au-nom-de-lhumanite-que-fait-la-france-monsieur-le-president
Solidarité - Page 63
-
« Au nom de l’Humanité », que fait la France, Monsieur le Président ?!
-
Chrétiens d’Orient persécutés : échos de la manifestation du 6 août à Bruxelles
Une amie nous adresse les échos et ambiances de cette manifestation d’hier à Bruxelles, en solidarité avec nos frères persécutés du Moyen-Orient . Beaucoup de familles, de jeunesse, de vigueur chrétienne qui devraient nous stimuler !
Voir ici :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y9e1LwkH7-k
https://www.facebook.com/photo.php?v=10203269528793883
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Ethique, Foi, Islam, Jeunes, Justice, Persécutions antichrétiennes, Solidarité, Témoignages 0 commentaire -
Quand de jeunes réfugiés chrétiens d’Irak découvrent en Europe un monde relativiste et indifférent
Lu sur le site de l’hebdomadaire Famille chrétienne sous le titre « Réfugiés en France, les chrétiens d’Irak se heurtent à l’indifférence ». Extraits.
Réfugiés politiques en France depuis l’attentat contre la cathédrale syriaque de Bagdad, en octobre 2010, trois jeunes Irakiens racontent sans concession la manière impersonnelle, voire glaciale, dont ils ont été accueillis en France.
Leur parole est franche envers le pays qui les a accueillis en octobre 2010, après l’attentat perpétré contre la cathédrale syriaque de Bagdad. La France, Pierre, Mariam et Benoît, jeunes réfugiés politiques irakiens, lui doivent énormément. Ils le savent. Le mouvement de solidarité qui s’est mis en place ces dernières semaines pour soutenir les chrétiens d’Orient les touche. « Je veux dire merci aux chrétiens, ici, en France, qui organisent des manifestations. Si elles ne changent rien à la situation en Irak, au moins elles ont le mérite de dire : on ne vous oublie pas. C’est très important », témoigne Pierre.
Comme Michèle Alliot-Marie l’avait fait en 2010, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, et son homologue de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont proposé le 28 juillet l’asile aux chrétiens irakiens. « Si Mgr Sako a raison de dire que les chrétiens d’Irak doivent rester sur leur terre historique, explique Benoît, les familles doivent aussi prendre une décision pour sauver leur vie ! La meilleure solution pour les chrétiens, aujourd’hui, c’est de partir », poursuit le jeune homme, ne cachant pas les faibles chances qu’il a un jour de revoir son pays.
Mariam, jeune lycéenne qui vient de passer son bac de français avec un brillant 19 à l’oral, se montre plus sceptique :« La France accepte de les accueillir. Mais comment pourront-ils venir ici ? », s’interroge-t-elle. Et surtout, comment seront-ils réellement accueillis ?
Car pour eux, comme pour de nombreuses autres familles irakiennes, arriver à Paris à l’automne 2010 ne fut pas simple. Loin de là. Ce fut, d’abord, le choc de découvrir une France qui n’est pas celle où ils avaient cru se réfugier. Non pas une société chrétienne, mais multiculturelle et athée. « J’avais imaginé la France et quand je suis arrivé à Paris, j’ai trouvé tout autre chose… », témoigne Benoît.
Ce choc, dont ils parlent volontiers, cache une autre amertume : celle de ne pas se sentir accueillis par les Français, particulièrement les chrétiens. Sur place, ils ont trouvé le traitement de l’administration française « froid et compliqué ». Aucune structure performante n’était présente pour les aider à s’insérer. Mariam se souvient : « On a trouvé de l’aide auprès des Arabes, qui croyaient que nous étions musulmans. Mais quand ils apprenaient que nous étions chrétiens, ils partaient ».
Est-ce plus difficile pour un chrétien de s’installer en France ? « Nous rencontrons beaucoup de difficultés, alors que nous sommes chassés de notre pays », répond la lycéenne. « Nous ne sommes pas venus par envie, mais parce que nous y étions obligés. Les Algériens, les Marocains, les Turcs viennent ici pour trouver un travail, et ils sont presque mieux traités par l’État », dénonce-t-elle sans concession.
Alors, quand ils entendent certains discours politiques, comme la réaction de Louis Aliot (FN) à la proposition de M. Fabius d’ouvrir l’asile aux chrétiens orientaux, les jeunes Irakiens voient rouge. « Selon lui, il n’y a plus de place en France pour les immigrés. Il nous a comparés à la misère, alors que nous n’étions pas pauvres dans notre pays. Étrangement, il y a toujours de la place pour les autres mais pas pour les chrétiens, alors qu’eux, ils ont vraiment besoin de se réfugier. J’ai toujours de la famille en Irak : ils sont morts de peur, et ne savent pas quoi faire. » (…)
Les beaux discours sont aussi souvent synonymes, ensuite, d’abandon. C’est l’avis d’Arnaud Duroyaume, qui s’occupe d’aider les Irakiens chrétiens. « Combien de fois on leur a dit : « On s’occupe de vous » ? Mitterrand a fait la même chose avec les Libanais : « Venez dans les hôpitaux ». Et après, c’était « Débrouillez-vous ». Combien de Libanais se sont retrouvés à la rue, alors qu’on leur avait fait miroiter un vrai accueil ? » Selon lui, cette froideur s’explique par une gêne envers les Arabes chrétiens.
Du coup, les Irakiens souffrent de vivre dans un contexte très éloigné du leur, déspiritualisé et parfois violent, comme les banlieues. Pour Arnaud Duroyaume, la solution consiste à sortir du ghetto communautaire, à s’ouvrir à la diversité dans l’Église. « Les Irakiens envoyés dans les banlieues, s’ils ne vont pas à la messe à côté de chez eux, au bout d’un moment, ils n’y vont plus. Je vois plein de jeunes livrés à eux-mêmes. Le père de famille, dans la culture orientale, est très important. Il y a un gros problème d’adaptation : soit le père verrouille tout, et ce n’est pas bon dans la société où l’on vit, soit il abandonne. Il y a beaucoup de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, et commencent à avoir des comportements choquants. » Et Mariam de confirmer : « On était dans un pays avec énormément de règles. Vivant en France, je découvre qu’en fait, les règles, j’aimais bien ».
Quand Arnaud Duroyaume est allé à la rencontre des rescapés de la cathédrale, il a réalisé qu’il était l’un des seuls chrétiens non orientaux à avoir eu cette démarche. L’accueil dans les paroisses n’a pas été non plus à la hauteur. « J’ai essayé de les intégrer dans diverses structures comme le scoutisme ou les Béatitudes, mais ça n’a pas marché », regrette-t-il. Ceux qui les reçoivent souvent et avec joie font partie de la frange la plus traditionnelle, comme la paroisse Saint-Eugène, le centre Saint-Paul ou encore la communauté Saint-Martin. « Au pèlerinage de Chartres, je me suis dit : enfin, je suis en France. Je me suis sentie intégrée ! On est mieux accueillis chez les traditionnalistes qu’ailleurs », confirme Mariam. « Je ne sais pas pourquoi, mais on a senti quelque chose de différent. » (…) . Pauline Quillon.
Ref. Réfugiés en France, les chrétiens d’Irak se heurtent à l’indifférence
C’est que la mentalité « traditionaliste » est, comme dirait Monsieur de la Palice, la plus proche de celle des chrétientés traditionnelles…
JPSC
-
Plus d'un millier de personnes rassemblées à Bruxelles pour soutenir les chrétiens d'Orient
A l'appel du Comité de soutien aux chrétiens d'Orient, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à Bruxelles devant les institutions européennes. On notait la présence de Mgr Hudsyn, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. En marge de ce rassemblement, deux jeunes djihadistes appelaient à massacrer les chrétiens.
Un ami, présent à la manifestation, nous a fait parvenir les photos reproduites ci-dessous.
-
BXL, 6 août : rassemblement de soutien aux Chrétiens d'Orient
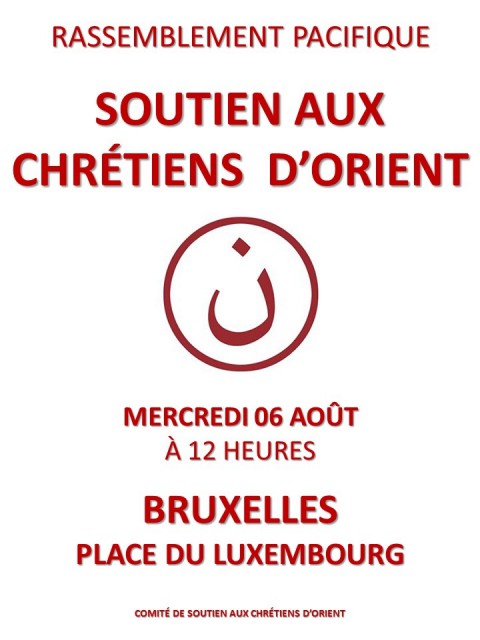
-
Sauvons les chrétiens d'Irak; signons la pétition
Déjà plus de 180.000 signatures; ajoutez la vôtre !
D'Aleteia.org :
Aujourd'hui, sous nos yeux, en 2014, les chrétiens d'Irak sont victimes d'un véritable génocide. Et pendant ce temps, la communauté internationale s'inquiète à peine de leur sort. Or, la disparition des chrétiens d'Irak constitue une menace pour la civilisation humaine tout court.
Les derniers chrétiens ont maintenant quitté Mossoul, après que l’État Islamique (ISIS) leur ait laissé le choix entre l'exil ou la mort avant de les rançonner. Pour la première fois en plus de 15 siècles, il n'y a plus de chrétien à Mossoul.
En 2003, avant l'invasion américaine, on comptait plus d'un million de chrétiens en Irak, dont plus de 600 000 à Bagdad et environ 60 000 à Mossoul. Aujourd'hui, tandis que les réfugiés s'entassent dans la plaine de Ninive, c'est au tour des chrétiens résidant dans la ville pétrolière de Kirkouk de trembler, alors que les islamistes ne sont plus qu'à une vingtaine de kilomètres.
Il aura fallu attendre le départ du dernier chrétien de Mossoul pour que la diplomatie mondiale sorte enfin de son silence. Après le fiasco militaire de l'invasion éclair d'une partie de l'Irak, l'absence de réaction de la communauté internationale est à la fois assourdissante, injuste, inacceptable.
Dimanche 20 juillet, Ban Ki Moon, secrétaire général de l'ONU, a clairement affirmé que " les attaques systématiques contre des civils en raison de leur origine ethnique ou de leur appartenance religieuse peuvent constituer un crime contre l'humanité dont les auteurs doivent rendre des comptes".
Dans une déclaration unanime adoptée lundi soir, les 15 pays membres du Conseil "condamnent le plus fermement possible la persécution systématique par l'EI et des groupes qui lui sont affiliés d'individus issus de minorités et de personnes qui refusent l'idéologie extrémiste de l'EI".
Faut-il donc attendre, au XXIe siècle, qu'un crime contre l'humanité soit accompli pour que la communauté internationale agisse enfin ? Nous demandons à l'Organisation des Nations Unies et à la Ligue Arabe d'intervenir au plus vite pour mettre fin aux exactions commises par l'EI et à l'éradication systématique des chrétiens d'Irak.
Face à de tels maux, les mots ne sont rien, il faut désormais agir sans attendre pour rendre un espoir, un avenir, un toit aux chrétiens d'Irak.
Nous sommes tous des "Nasrani".
Nous vous appelons aussi à prier pour les chrétiens d'Irak : la prière peut tout !
----------->> CLIQUEZ ICI POUR REJOINDRE LA PRIÈRE POUR LES CHRÉTIENS D'IRAKPour signer la pétition : http://citizengo.org/fr/9742-stop-aux-exactions-irak?tc=gm&tcid=5731141
======================================================
Pour plus d'information :
Lettre de Bruno Retailleau à François Hollande : Le cri des chrétiens d'Irak déchire l'espace et le temps :http://brunoretailleau.net/2014/07/21/le-cri-des-chretiens-dirak-dechire...
Jean-Christophe Fromentin : Ne laissons pas gagner la haine ! : https://www.facebook.com/jcfromantin?fref=ts
Article du Figaro : Chrétiens d'Irak : Pourquoi tant d'indifférence ? :http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2014/07/22/31004-20140722ARTFIG00003...
Aleteia : Irak : "une vraie menace pour la civilisation humaine tout court : http://www.aleteia.org/fr/international/contenu-agrege/irak-une-vraie-me...
Famille Chrétienne : Irak : le pape François dit sa préoccupation pour les chrétiens chassés de Mossoul : http://www.famillechretienne.fr/croire/pape-et-vatican/irak-le-pape-fran...
-
Irak : visite de Mgr Barbarin, Primat des Gaules
Le reportage d’Aleteia :
 « D'Erbil à Qarakosh, à seulement 30 km de Mossoul, Mgr Barbarin est allé à la rencontre des chrétiens d'Irak, et a proposé de jumeler les diocèses de Lyon et Mossoul.
« D'Erbil à Qarakosh, à seulement 30 km de Mossoul, Mgr Barbarin est allé à la rencontre des chrétiens d'Irak, et a proposé de jumeler les diocèses de Lyon et Mossoul."Ce qui sert à vous discréditer, je le porte sur moi comme un honneur".Tout au long de ses trois jours sur place, en Irak, le cardinal-archevêque de Lyon n'a pas quitté le ن de "nazaréen" qu'il portait sur son cœur. Avec Mgr Michel Dubost, évêque d'Evry et membre du Conseil pontifical pour les relations inter-religieuses, et Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l'Oeuvre d'Orient, le primat des Gaules était venu apporter son soutien aux chrétiens d'Irak réfugiés, qui ont dû fuir Mossoul après l'ultimatum de l'auto-proclamé Etat Islamique.
"L'objectif c'est de passer un moment avec des personnes expulsées de chez elles, a expliqué Mgr Barbarin au micro de Mathilde Dehimi, de France Inter. Maintenant je voudrais faire un jumelage entre le diocèse de Lyon et le diocèse de Mossoul. Cela fait 18 siècles qu'il y a des chrétiens à Mossoul ; c'est la première fois depuis 1800 ans qu'il n'y a pas de messe un dimanche à Mossoul, et ça c'est une profonde injustice."
Venu à la rencontres des chrétiens réfugiés le lundi 28 juillet à Erbil, dans la région du Kurdistan irakien, le cardinal Barbarin avait bien sûr entendu parler de l'annonce faite par le Quai d'Orsay, par laquelle la France se disait prête à accueillir des réfugiés. "Hier, à la cathédrale d'Erbil, tout le monde en parlait. L'asile proposé par la France est beau, mais il va aggraver l'exode des chrétiens plutôt que de les aider à rester. Il vaut mieux partir que de se faire tuer, évidemment. Mais le but n'est pas que tout le monde parte. C'est que l'on arrive à rester et à continuer à vivre ensemble. " "Moi, ce que je demande au gouvernement ? J'aimerais bien que les décisions ne soient pas prises pour des questions de rapport de pouvoir, d'argent et de pétrole entre les grandes puissances, mais qu'elles soient faites en fonction des gens", a confié le cardinal-archevêque de Lyon à France Inter.
"La dévotion à Notre Dame de Lourdes s'affiche partout, sur les mantilles, remarque Natalia Trouiller, qui a réalisé en temps réel sur les réseaux sociaux le compte-rendu du déplacement tout au long du séjour. Les gens montrent l'ultimatum des jihadistes à Mossoul. Dans cette école du diocèse chaldéen d'Erbil, se pressent tous les notables de Mossoul. Ils ont tout perdu."Mardi 30 juillet, protégé par une escorte militaire fortement armée, à seulement 30 km de Mossoul, le cardinal Barbarin a reçu un accueil triomphal dans la cathédrale de Qarakosh. "L'église Notre Dame de Qaraqosh déborde de gens. Youyous, applaudissements, acclamations. On se croirait avec le Christ le jour des rameau", partage sur Twitter la chargée de communication du diocèse de Lyon.L'arrivée à Qaraqosh est incroyable. Une foule innombrable nous attend, nous embrasse, nous acclame. Une vieille femme s'approche de moi, me prend dans ses bras, me bénit au nom de tous les chrétiens de France. Certains me demandent comme amie sur Facebook : prenez de nos nouvelles, ne nous oubliez pas ! Nous quittons Qaraqosh en y laissant notre cœur. Ces gens sont incroyables de beauté et de dignité."
"Tous les catholiques de France sont ici dans la cathédrale de Qarakosh", a déclaré le cardinal Barbarin sous un tonnerre d'applaudissements de réfugiés. "Je vous fais une promesse : chaque jour, je dirai le "Notre Père" en araméen, jusqu'à ce que vous soyez rentrés à Mossoul", a ainsi déclaré le cardinal Barbarin. "Il faut que les chrétiens restent sur place, ils vivent avc les musulmans depuis des siècles, il ne faut pas perdre cela."
Alors que les chrétiens d'Irak avaient "édifié, comme dans beaucoup d'autres pays de cette région, un art de vivre ensemble qui est aussi une grande richesse pour l'humanité",
les familles chrétiennes ont été dépouillées, elles sont partis de Mossoul avec rien. "Cela fait trois fois depuis le début de la guerre que je fuis Mossoul, a confié un réfugié à Natalia Trouiller. Aujourd'hui je veux juste vivre en paix quelque part."
Pour découvrir d'autres retours sur le voyage en Irak de la délégation de l'Eglise catholique :
- Les reportages de l'envoyé spécial de RCF - Radios Chrétiennes Francophones
- L'article de l'envoyé spécial du Journal La Croix
- Le cardinal Barbarin sur RMC
- Le cardinal Barbarin sur RTL
- Un album photos de la première journéeRef. Cardinal Barbarin : "Tous les catholiques de France sont ici, dans la cathédrale de Qarakosh"
JPSC
-
Une veillée de prière pour les chrétiens d'Orient a rassemblé un millier de personnes à Koekelberg
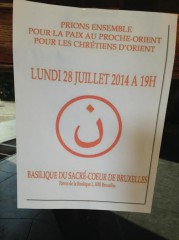 Une veillée de prière a été organisée hier soir (lundi) à la Basilique de Koekelberg. Nous n'étions pas au courant de cette initiative mais un ami, prévenu à la dernière minute, a pu y assister. Il nous en livre le compte-rendu qui suit ci-dessous.Voici l'invitation qui a été lancée (et que nous n'avions pas reçue) :Chers frères et sœur en Dieu de Paix et d’Amour, Il n’y a plus de mots pour décrire les atrocités et les souffrances au Proche-Orient en général, et particulièrement en Syrie et en Irak pour les chrétiens orientaux.Nous les chrétiens des églises orientales de Bruxelles (églises syriaques, chaldéenne, maronite, melkite, assyrienne, arménienne, Coptes…) orthodoxes et catholiques ensemble nous vous invitons à une prière commune pour la paix au Proche-Orient. Par cette prière nous voulons aussi soutenir nos frères en Christ qui vivent le calvaire de notre Seigneur, particulièrement en Irak.
Une veillée de prière a été organisée hier soir (lundi) à la Basilique de Koekelberg. Nous n'étions pas au courant de cette initiative mais un ami, prévenu à la dernière minute, a pu y assister. Il nous en livre le compte-rendu qui suit ci-dessous.Voici l'invitation qui a été lancée (et que nous n'avions pas reçue) :Chers frères et sœur en Dieu de Paix et d’Amour, Il n’y a plus de mots pour décrire les atrocités et les souffrances au Proche-Orient en général, et particulièrement en Syrie et en Irak pour les chrétiens orientaux.Nous les chrétiens des églises orientales de Bruxelles (églises syriaques, chaldéenne, maronite, melkite, assyrienne, arménienne, Coptes…) orthodoxes et catholiques ensemble nous vous invitons à une prière commune pour la paix au Proche-Orient. Par cette prière nous voulons aussi soutenir nos frères en Christ qui vivent le calvaire de notre Seigneur, particulièrement en Irak.
Faisons monter ensemble d’un même cœur notre supplications à notre Père céleste pour que son règne de paix vienne dans ces pays du Proche-Orient.
La prière pour la paix au Proche-Orient par les chrétiens d’Orient.
Lundi 28 juillet 2014 à 19 h à la Basilique du Sacré-Cœur de Bruxelles Parvis de la Basilique 1, 1083 Bruxelles
Invitez le plus du monde à venir et prier avec nous, car comme dit le Seigneur certains esprits mauvais ne peuvent sortir que par « la prière et le jeûne ».
Merci pour votre prière et votre présence à la prière pour la paix au Proche-Orient.(L'invitation reprend la désormais célèbre lettre N en arabe qui signifie nazaréen ou chrétien. Elle est devenue le symbole de solidarité pour les chrétiens d'Orient depuis que leurs maisons ont été taguées à Mossoul.) Compte rendu de la veillée :L'initiative des chrétiens d'Orient résidant en Belgique a été lancée jeudi dernier. Découverte vers 17h00 ce jour via Facebook, je suis surpris du peu d'information relayé par les outils de communication officiels de l'Eglise qui est en Belgique.A mon arrivée, surprise, la basilique est bondée et des chaises sont ajoutées sur les côtés pour accueillir les fidèles qui continuent à affluer. Il y avait plus de 1000 personnes dans cette assemblée.Un passage de l'Evangile est lu en différentes langues orientales par les représentants des communautés d'Orient vivant à Bruxelles et ses environs. Le texte est chanté par Mgr Kockerols (évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles) en français.Au lieu de l'homélie, le prêtre dirigeant la veillée préfère donner le message de Mgr Louis Raphaël Sako (Patriarche de Babylone des Chaldéens) aux chrétiens d'Irak et à ceux de Mossoul en particulier :Je vais commencer mon discours par la Parole du Christ, puisque Sa Parole est source de force et de salut pour nous, les pauvres de ce monde perdu: « N’aie pas peur, petit troupeau » (Luc 12, 32). Notre douleur présente est associée à notre condition de chrétien et avec le mystère de notre Pâque. Notre souffrance, si elle est liée à la souffrance de notre Sauveur Jésus, « homme de douleur », va se révéler être une bénédiction, et le salut, pour nous et pour les autres. Et les défis actuels sont affrontés avec plus de foi, d’espérance, de prière, et de solidarité et de sagesse. Soyez courageux face à ce que vous affrontez, n’ayez pas peur : vous avez des racines profondes en Irak, ne cédez pas à la frustration et au désespoir, confiants que « tous ceux qui prennent l’épée périront par l’épée » (Mat 26, 52) et que le mal ne dure pas ! Vous êtes la petite graine de moutarde, le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Il est avec vous aujourd’hui, demain, et après-demain, et pour toujours. Nous sommes vos pasteurs et, avec notre pleine responsabilité envers vous, nous allons rester avec vous jusqu’à la fin, nous ne vous laisserons pas, quels que soient les sacrifices. Je le répète : n’ayez pas peur; restez forts comme vous l’êtes avec votre foi et votre espérance et votre amour. Nous remercions Dieu de vous garder saufs, car, quoi qu’il arrive, votre vie n’a pas de prix. La bénédiction de Dieu soit sur vous.
Compte rendu de la veillée :L'initiative des chrétiens d'Orient résidant en Belgique a été lancée jeudi dernier. Découverte vers 17h00 ce jour via Facebook, je suis surpris du peu d'information relayé par les outils de communication officiels de l'Eglise qui est en Belgique.A mon arrivée, surprise, la basilique est bondée et des chaises sont ajoutées sur les côtés pour accueillir les fidèles qui continuent à affluer. Il y avait plus de 1000 personnes dans cette assemblée.Un passage de l'Evangile est lu en différentes langues orientales par les représentants des communautés d'Orient vivant à Bruxelles et ses environs. Le texte est chanté par Mgr Kockerols (évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles) en français.Au lieu de l'homélie, le prêtre dirigeant la veillée préfère donner le message de Mgr Louis Raphaël Sako (Patriarche de Babylone des Chaldéens) aux chrétiens d'Irak et à ceux de Mossoul en particulier :Je vais commencer mon discours par la Parole du Christ, puisque Sa Parole est source de force et de salut pour nous, les pauvres de ce monde perdu: « N’aie pas peur, petit troupeau » (Luc 12, 32). Notre douleur présente est associée à notre condition de chrétien et avec le mystère de notre Pâque. Notre souffrance, si elle est liée à la souffrance de notre Sauveur Jésus, « homme de douleur », va se révéler être une bénédiction, et le salut, pour nous et pour les autres. Et les défis actuels sont affrontés avec plus de foi, d’espérance, de prière, et de solidarité et de sagesse. Soyez courageux face à ce que vous affrontez, n’ayez pas peur : vous avez des racines profondes en Irak, ne cédez pas à la frustration et au désespoir, confiants que « tous ceux qui prennent l’épée périront par l’épée » (Mat 26, 52) et que le mal ne dure pas ! Vous êtes la petite graine de moutarde, le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Il est avec vous aujourd’hui, demain, et après-demain, et pour toujours. Nous sommes vos pasteurs et, avec notre pleine responsabilité envers vous, nous allons rester avec vous jusqu’à la fin, nous ne vous laisserons pas, quels que soient les sacrifices. Je le répète : n’ayez pas peur; restez forts comme vous l’êtes avec votre foi et votre espérance et votre amour. Nous remercions Dieu de vous garder saufs, car, quoi qu’il arrive, votre vie n’a pas de prix. La bénédiction de Dieu soit sur vous. Ensuite différentes intentions sont proposées à la prière de l'assemblée. Chaque intention est suivie d'un chant oriental porté par une chorale. En même temps, différentes personnes remontent la nef en apportant des bougies et les allument au cierge pascal pour les déposer au pied de la croix. La veillée s'est terminée par la prière du Notre Père et un appel à continuer à prier pour nos frères d'Orient.Pendant toute la veillée un diaporama était projeté sur un écran. Il reprenait de nombreuses photos d'églises en feu, de chrétiens crucifiés, de familles en fuite, de maison taguées de la lettre "N".Joëlle Milquet, Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur faisant fonction, a rejoint la veillée (voir photo).Reste une question : quand est-ce que les évêques de Belgique vont se prononcer sur cette questions grave ? Le ramadan doit-il monopoliser toute l'attention de nos pasteurs au point d'oublier nos frères d'Irak ?
Ensuite différentes intentions sont proposées à la prière de l'assemblée. Chaque intention est suivie d'un chant oriental porté par une chorale. En même temps, différentes personnes remontent la nef en apportant des bougies et les allument au cierge pascal pour les déposer au pied de la croix. La veillée s'est terminée par la prière du Notre Père et un appel à continuer à prier pour nos frères d'Orient.Pendant toute la veillée un diaporama était projeté sur un écran. Il reprenait de nombreuses photos d'églises en feu, de chrétiens crucifiés, de familles en fuite, de maison taguées de la lettre "N".Joëlle Milquet, Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur faisant fonction, a rejoint la veillée (voir photo).Reste une question : quand est-ce que les évêques de Belgique vont se prononcer sur cette questions grave ? Le ramadan doit-il monopoliser toute l'attention de nos pasteurs au point d'oublier nos frères d'Irak ?
Veillée de prières pour les chrétiens d'Irak ce soir en la basilique de KoekelbergLien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Foi, International, Persécutions antichrétiennes, Solidarité 4 commentaires -
Irak : la lettre ouverte d'un citoyen aux autorités politiques belges
La.Libre.be publie cette lettre :
"QUI NE DIT MOT... CONSENT!"
Lettre ouverte d'un citoyen belge aux autorités politiques:
Madame, Monsieur,
C'est en tant que citoyen belge et catholique en colère que je vous interpelle au sujet de mes frères chrétiens d'Orient et plus particulièrement ceux d'Irak et de Syrie.
Un génocide est en train de se perpétrer sous vos yeux dans la plus grande indifférence de la communauté internationale et donc aussi de notre pays, en effet, aucun politicien belge ne bouge, pas de déclaration, pas de condamnation, rien de rien.
Pour la Palestine pas de problème, là vous savez vous bouger, manifester, condamner Israël, demander un boycotte et faire beaucoup de blabla....La vie d'un chrétien aurait-elle moins de valeur que celle d'un palestinien ?
Trouvez-vous normal que les biens des chrétiens soient marqués de la lettre « N », comme « Nazaréen », inscription assortie de la mention «bien immobilier propriété de l’État islamique », en 39/40 un régime pratiquait déjà cela avec les biens des juifs, la nuit de cristal, cela vous rappelle quelque chose ?
Trouvez-vous normal que les chrétiens ne peuvent pas bénéficier des rations alimentaires distribuées à la population et qu'on a coupé l’approvisionnement en eau potable des villes chrétiennes de Telkeif, Tellesqif, Batnaya.
Trouvez-vous normal que les islamistes fassent régner la terreur et se permettent de lancer un ultimatum aux chrétiens 1. Se convertir à l’islam ; 2. Accepter le statut de dhimmi ; 3. En cas de refus du premier ou du deuxième choix, ils seront exécutés par l’épée. Vous parlez d'un choix !
Les familles chrétiennes quittés la ville de Mossoul, ayant pris avec elles tout ce qu’elles pouvaient emporter : des objets de valeurs comme argent, bijoux, des documents, etc, mais aux checkpoints installés par les islamistes, ces familles furent rançonnées et complètement dépouillées de leurs maigres affaires et maintenant elles n'ont plus rien sauf leurs larmes pour pleurer.
Aujourd'hui.....Il n'y a plus aucun chrétien à Mossoul et pourtant cela fait plus de 1000 ans que les chrétiens sont à Mossoul...
"L'absence de réaction internationale concrète à ce drame pose une vrai question: est-on prêt à voir émerger un régime théocratique totalitaire aux portes de l'Europe?"
Oui je suis très en colère contre vous les politiciens belges et européens, et c'est votre silence et votre indifférence qui me met très en colère, votre silence et votre indifférence sont vraiment assourdissants, je crains plus le bruit des pantoufles que celles des bottes. J'ai envie de vous crier « Existe-t-il aujourd'hui un homme intelligent dans MON pays qui puisse avoir enfin le courage et volonté de se bouger pour les chrétiens d'Orient, j'ai de sérieux doutes !
En tant que chrétien, je tiens pour responsables tous les politiciens belges et européens de ce tout ce qui arrivera à mes frères et sœurs chrétiens d'Orient, vous serez tenu responsables pour non-assistance à personnes en danger, par votre silence vous vous faite complices des persécuteurs de mes frères et sœurs, car qui ne dit mot consent.
Je me permets de vous rappeler ce que Albert Einstein disait : "Le monde ne sera pas détruit pas ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire".
J'espère au moins par mon message que je vous aurais permis de réfléchir et de réveiller votre conscience assoupie, si ce n'est pas le cas, j'aurais au moins fait mon devoir d'homme et de chrétien et pour ma part, je pourrais au moins me regarder le matin dans le miroir en me disant que j'ai fait mon possible pour relayer le cri de mes frères et sœurs d'Orient, espérons que vous pourrez faire de même.
Michel Lixon - Citoyen belge et catholique
A lire également :
-
Chrétiens d’Irak : la mélodie du silence
Les islamistes ont chassé les chaldéens de Mossoul. L'avenir des chrétiens d'Irak est plus incertain que jamais, s'inquiète Marc Fromager sur « Figarovox ». Marc Fromager est directeur de l'Aide à l'Eglise en Détresse, et rédacteur en chef de L'Eglise dans le Monde. Il est également l'auteur de Chrétiens en danger, vingt raisons d'espérer (EDB)
 « FigaroVox: Depuis la prise de Mossoul par les islamistes d'EEIL, comment a évolué la situation des chrétiens d'Irak?
« FigaroVox: Depuis la prise de Mossoul par les islamistes d'EEIL, comment a évolué la situation des chrétiens d'Irak?MARC FROMAGER: La communauté chrétienne d'Irak est purement et simplement menacée d'extinction. Depuis l'invasion américaine de 2003, la situation n'a cessé de se dégrader pour les chrétiens dans ce pays. Avec la prise deMossoul par les islamistes, le 10 juin, on a franchi une étape supplémentaire. La menace est devenue frontale pour les chaldéens, d'autant que de nombreux villages chrétiens se trouvent à proximité de Mossoul. Le 17 juin, l'EIIL a ordonné aux derniers chrétiens de la ville de devenir musulmans, ou bien d'accepter le statut de dhimmi, qui oblige au paiement d'un impôt de «protection» ou bien de quitter la ville avant le 19 juillet à midi. Leurs maisons ont été marquées de la lettre N -nazara en arabe qui désigne les chrétiens-, et confisquées. Les chrétiens de Mossoul contraints à l'exode ont dû abandonner tous leurs biens, confisqués par les islamistes. A Bagdad, il y a encore des chrétiens, mais la situation est devenue chaotique. Reste la partie kurde du pays où les chrétiens bénéficient, pour le moment, d'une sécurité relative.
Mossoul était-elle une des plus anciennes villes chrétiennes du monde? Depuis quand les chrétiens sont-ils présents en Irak?
Le christianisme s'est largement répandu au Moyen-Orient, où il est né. Il y a eu des chrétiens dans l'actuelle Irak très certainement dès les semaines qui ont suivi la Pentecôte, c'est-à-dire aux tout débuts du christianisme. L'apôtre Saint Thomas est passé là. Il y avait d'ailleurs une relique de lui à Mossoul, qui est l'ancienne Ninive de la Bible. Avec Antioche et Damas, Mossoul abritait probablement une des plus importantes communautés chrétiennes de l'époque. Un des titres de gloire de Mossoul pour les chrétiens, est d'avoir eu comme évêque Saint Isaac le Syrien -même s'il est né dans le territoire actuel du Qatar-, encore appelé Saint Isaac de Ninive.
La communauté chrétienne d'Irak est purement et simplement menacée d'extinction. Face à la poussée de l'islamisme radical, peut-on craindre à long terme une disparition définitive des chrétiens d'Orient?
Lorsque l'on évoque cette possibilité, on est en général taxé de dépressif ou de vautour. Les sceptiques sous-entendent que l'on brandit cette éventualité afin de susciter la générosité des donateurs ou encore pour jeter de l'huile sur le feu en illustrant l'apparente inutilité du dialogue interreligieux. Or, si l'on regarde les chiffres, la proportion des chrétiens au Moyen-Orient n'a cessé de baisser depuis l'arrivée de l'islam. Et cette diminution n'a fait que s'accélérer tout au long du XXème siècle, et en particulier ces vingt-cinq dernières années. Malgré les déclarations optimistes ou encourageantes des autorités ecclésiastiques locales - et on comprend qu'elles ne veuillent pas accroître la tentation déjà lancinante de l'exil-, l'éventualité d'une disparition totale des chrétiens au Moyen-Orient ne cesse de se renforcer. Certes, il reste encore des millions de chrétiens en Egypte et on les imagine difficilement disparaître dans un avenir proche. Mais il est vrai qu'en Irak et peut-être demain en Syrie, le scénario devient chaque jour plus probable. Parallèlement et de manière paradoxale, il y a de plus en plus de chrétiens étrangers -en général indiens ou philippins- au Moyen-Orient. On compte ainsi un million et demi de catholiques en Arabie Saoudite, alors que les chrétiens avaient disparu de ce pays pendant quatorze siècles. Mais ce sont des travailleurs venus d'Asie et non des chrétiens d'Orient. Ils ne resteront pas dans la région.
Alors que le monde entier a les yeux rivés vers la Palestine, le sort des chrétiens d'Orient semble susciter moins de mobilisation dans l'opinion occidentale. Comment expliquer cette indifférence?Lorsqu'il s'agit de persécutions antichrétiennes, c'est la mélodie du silence ! Est-ce parce que le christianisme n'est plus censé faire partie de la sphère publique ? Faut-il y voir un lien avec le rejet de nos racines et de notre identité ?
C'est un grand mystère! Il ne s'agit pas que des chrétiens d'Orient. D'une manière générale, le sort des chrétiens dans le monde n'intéresse personne. Lorsqu'il s'agit de persécutions antichrétiennes, c'est la mélodie du silence! Est-ce parce que le christianisme n'est plus censé faire partie de la sphère publique? Faut-il y voir un lien avec le rejet de nos racines et de notre identité? Les chrétiens ne font-ils pas le poids face à des intérêts supérieurs, en général énergétiques ou financiers? Le plus surprenant, c'est que même l'Eglise, hormis le Pape François qui en parle de plus en plus, semble anesthésiée sur cette question. Est-ce par considération mystique, l'Eglise étant appelée à suivre le Christ jusque dans sa passion? Est-ce par humilité (ne parlons pas de nous) ou une charité déplacée (ne parlons pas de persécution, cela signifierait qu'il y a des persécuteurs)? Ou considère-t-on simplement qu'il n'y a plus rien à faire pour les chrétiens dans le monde?
Face à leur situation tragique, que peut faire l'Occident pour aider les chrétiens d'Orient?
Il faut d'abord en parler. Même si on n'est pas chrétien, on ne devrait pas pouvoir rester insensible à ces menaces d'extermination. La seconde urgence est que les pouvoirs publics français et européens expriment de manière ferme et constante notre indignation extrême face à ce drame. Le message est simple: ces persécutions ne sont pas pas acceptables! Pour éviter de prêter le flanc à l'accusation de partir en croisade, on pourrait placer cette exhortation sur le plan de la liberté religieuse en la revendiquant pour tous. A Mossoul, les maisons des chiites aussi ont été marquées par les islamistes. C'est également intolérable. »
JPSC
-
Sur Twitter : un caractère arabe pour afficher son soutien aux chrétiens persécutés en Irak
Du Figaro.fr :
«ن»: par ce simple caractère arabe, qui signifie «N» pour «nazaréen», des milliers de membres de Twitter affichent leur soutien aux chrétiens persécutés en Irak. Après la prise de Mossoul, deuxième ville du pays, cette lettre a été peinte sur les maisons des chrétiens.
D'abord marqueur péjoratif du «dhimmi» chrétien, le «ن» (prononcez «noun») est devenu un symbole de ralliement. Il est utilisé comme mot-clé, en guise d'avatar ou glissé dans un pseudonyme. «Soutien aux chrétiens d'Irak: nous sommes aussi des Nazaréens», tweete ainsi le blogueur catholique @koztoujours, devenu «Koz ن» pour l'occasion. «Contre l'intolérance et la bêtise, s'indigne l'avocate Valérie Duez-Ruff, j'ai mis #ن sur mon profil en soutien aux chrétiens molestés.» Une mobilisation virtuelle qui a touché jusqu'à la classe politique, puisque, à titre d'exemple, le sénateur UMP Bruno Retailleau et le député PS Yann Galut s'y sont joints en arborant sur Twitter ce caractère.
-
Irak : Mgr Casmoussa nous fait part de son angoisse
 Lettre ouverte de Mgr B. Georges Casmoussa, Archevêque Auxiliaire Patriarcal Syro-Catholique
Lettre ouverte de Mgr B. Georges Casmoussa, Archevêque Auxiliaire Patriarcal Syro-CatholiqueChers amis,
C’est de Rome que je vous écris… Les événements se précipitant en Iraq, et à Mossoul même. Dans un climat de tristesse, de consternation et d’indignation je vous fais part de mon angoisse:
1. Jeudi 16.7. , l’État Islamique (ISIS) a décrété, avec hauts parleurs, renchéris par quelques mosquées, que les Chrétiens de Mossoul, pour survivre, devaient choisir entre trois possibilités: soit de se convertir a l’Islam, soit de payer la jiziah (impôt imposé aux non musulmans), soit de quitter la ville sans rien prendre. Leurs biens appartenaient a l’État Islamique.
2. Suite a ce décret les chrétiens qui restaient dans la ville (entre 100 et 200 familles, car déjà ravagés par d’autres exodes successives) quittaient la ville précipitamment avec simplement ce qu’ils pouvaient importer. Ils furent, toutefois, molestés par les ISIS aux barrages en sortant de la ville. Certains furent pillés, frappés, dépouillés de leurs argent, bijoux, cellulaires. Des passeports furent déchirés.
3. D’autres faits sur le terrain ont eu lieu depuis samedi 18.7. à Mossoul: Évêché syriaque catholique: rumeurs sur sa mise a feu. Ce qui est sûr, d’après Mgr Mouche: les ISIS ont fait irruption, fait descendre les portraits des patriarches et les ont brûlés devant l’Évêché. Quatre églises (Syr, cath., syr. orth., armeniens orth.) donnent sur la cour de l’évêché, dont notre ancienne cathédrale remontant au XIIe s.
Église Mar Thomas: irruption dans l’église, prise du Musée, musée lequel contient des manuscrits précieux, des pièces racontant l’histoire de la ville de Mossoul.
Monastère Mar Behnam à 15 km au S.O. de Qaraqosh pris par les ISIS, les moines chassés, leurs cellulaires confisqués. Ce monastère abrite une église et le mausolée du Martyre, chef-d’œuvre de la sculpture chrétienne en Mésopotamie.
Monastère Mar Gorguis à la périphérie nord de Mossoul: saccagé par les ISIS. Descente de croix. Comme ils l’avaient déjà dans d’autres églises de Mossoul. Déjà les ISIS avaient pris les évêchés syriaque-orthodoxe et chaldéen.
On craint beaucoup pour le patrimoine artistique de Mossoul, où l’ISIS a déjà démoli des mausolées de la ville et des monuments érigés en l’honneur de personnalités culturelles ou artistiques civiles, ainsi qu’une statue de la Vierge qui dominait l’ancien évêché chaldéen, déjà miné et bombardé en 2006.
Le climat est très lourd dans la ville. Certains témoignages reflètent la désapprobation des musulmans de la ville, mais aucune réaction des chefs religieux Sunnites de l’Iraq. Silence médiatique. Malgré quelques échos faibles. Un Futur incertain pour les chrétiens. Déjà le 10 Juin dernier, a la prise de la ville par ISIS, un premier exode massif de chrétiens avait eu lieu vers les villes chrétiennes de la Plaine de Ninive. Les 26,27, 28 du même mois, à la suite des affrontements entre les forces kurdes qui gardaient Qaraqosh et les jihadistes Sunnites qui faisaient l’assaut de la ville, 45000 chrétiens, c.a.d. la presque totalité de la ville, avaient fui leur ville vers le Kurdistan.
4. Ici a Rome, ou se trouve le patriarche syr. cath. Joseph III YOUNAN: Samedi 19.7., accompagné de son Auxiliaire Mgr Casmoussa et de l’archevêque de Bagdad, Mgr Abba, Sa Béatitude (S.B.) a eu une audience précipitée a la Secrétairerie d’État. S.B. a proposé au chef du Dicastère des relations avec les États, Mgr Dominique Imberto, de convoquer le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège pour l’inciter à une action commune et urgente en faveur de la minorité chrétienne d’Iraq soumise a la persécution déclarée des islamistes fanatiques de l’ISIS. Cette même proposition, S.B. l’a réitérée au Saint-père personnellement qui l’a appelé au téléphone l’après-midi du Dimanche. S.B., pendant 10 minutes, a expliqué à Sa Sainteté, la situation critique des chrétiens en Iraq. Le S.Père, à l’Angélus de ce même dimanche, avaient parlé clairement et avec angoisse de la souffrance et de la persécution des chrétiens en Iraq.
5. A Bagdad, S.B. le Patriarche Louis Sako a lancé un appel vibrant en faveur du respect des droit des chrétiens irakiens et de leur survie. Il a invité les évêques catholiques et orthodoxes de l’Iraq à une session extraordinaire de l’AEI a Ainkawa lundi ou mardi.
6. Avec la chasse aux Chrétiens, il y a eu la chasse aux chiites à Mossoul et ses environs. Dans plusieurs villages mixtes des alentours de Mossoul, les ISIS ont mené une vraie épuration religieuse, ou ils ont molesté les communautés chiites et les ont chassées vers le Kurdistan. Des centaines de familles démunies de tout, furent accueillies dans des camps de fortune, sous un soleil torride. Les autorités kurdes les ont accueillis puis acheminées vers le sud, vers les villes chiites.
7. Au nom des Droits de l’Homme; au nom de l’homme, de la femme et de l’enfant chrétiens en Iraq soumis a la discrimination, chassés de leurs maisons et de leurs villes; acculés à un choix injuste, inique et inhumain, soit de se convertir a l’Islam, soit a payer la Jizia, soit à quitter leurs villes sans rien emporter… c’est un appel vibrant et pressant que nous lançons a la Communauté Internationale, aux Etats arabo-musulmans, au Secrétaire de l’ONU , au Congrès Islamique Mondial, à Al-Azhar, aux gouvernements et parlements de la CE… pour prendre leurs responsabilités vis-à-vis des minorités religieuses et ethniques en Iraq, notamment les Chrétiens d’Iraq qui sont menaces d’extermination ou voués au départ. C’est une persécution directe et ouverte de la part des Jihadistes Islamiques (ISIS) en Iraq. Ceux-ci menacent non seulement les chrétiens, en tant que groupe social, mais menacent la civilisation, le patrimoine culturel, artistique et historique de l’Iraq. Leur idéologie biffe 1400 ans de l’histoire de l’humanité en détruisant tout apport culturel, artistique et historique de notre pays, pour remettre nos peuples à l’obscurantisme du début du 7eme s. C’est une vraie menace pour la civilisation humaine tout court.
+ B. Georges Casmoussa - Archev. Auxiliaire Patriarcal Syr. Cath.
Rome 21.7.2014



