 Lors de l'audience générale du mercredi 3 octobre 2007, Benoît XVI consacrait sa catéchèse à saint Cyrille d'Alexandrie (source) :
Lors de l'audience générale du mercredi 3 octobre 2007, Benoît XVI consacrait sa catéchèse à saint Cyrille d'Alexandrie (source) :
Chers frères et sœurs!
Poursuivant notre itinéraire sur les traces des Pères de l'Eglise, nous rencontrons une grande figure: saint Cyrille d'Alexandrie. Lié à la controverse christologique qui conduisit au Concile d'Ephèse de 431 et dernier représentant important de la tradition alexandrine, dans l'Orient grec, Cyrille fut plus tard défini le "gardien de l'exactitude" - qu'il faut comprendre comme gardien de la vraie foi - et même "sceau des Pères". Ces antiques expressions expriment un fait qui est caractéristique de Cyrille, c'est-à-dire la référence constante de l'Evêque d'Alexandrie aux auteurs ecclésiastiques précédents (parmi ceux-ci, Athanase en particulier), dans le but de montrer la continuité de sa théologie avec la tradition. Il s'insère volontairement, explicitement dans la tradition de l'Eglise, dans laquelle il reconnaît la garantie de la continuité avec les Apôtres et avec le Christ lui-même. Vénéré comme saint aussi bien en Orient qu'en Occident, saint Cyrille fut proclamé docteur de l'Eglise en 1882 par le Pape Léon XIII, qui, dans le même temps, attribua ce titre également à un autre représentant important de la patristique grecque, saint Cyrille de Jérusalem. Ainsi, se révélaient l'attention et l'amour pour les traditions chrétiennes orientales de ce Pape, qui voulut ensuite proclamer saint Jean Damascène Docteur de l'Eglise, montrant ainsi que tant la tradition orientale qu'occidentale exprime la doctrine de l'unique Eglise du Christ.
On sait très peu de choses sur la vie de Cyrille avant son élection sur l'important siège d'Alexandrie. Neveu de Théophile, qui en tant qu'Evêque, dirigea d'une main ferme et avec prestige le diocèse alexandrin à partir de 385, Cyrille naquit probablement dans la même métropole égyptienne entre 370 et 380. Il fut très tôt dirigé vers la vie ecclésiastique et reçut une bonne éducation, tant culturelle que théologique. En 403, il se trouvait à Constantinople à la suite de son puissant oncle et il participa dans cette même ville au Synode appelé du "Chêne", qui déposa l'Evêque de la ville, Jean (appelé plus tard Chrysostome), marquant ainsi le triomphe du siège alexandrin sur celui, traditionnellement rival, de Constantinople, où résidait l'empereur. A la mort de son oncle Théophile, Cyrille encore jeune fut élu Evêque de l'influente Eglise d'Alexandrie en 412, qu'il gouverna avec une grande énergie pendant trente-deux ans, visant toujours à en affirmer le primat dans tout l'Orient, également fort des liens traditionnels avec Rome.
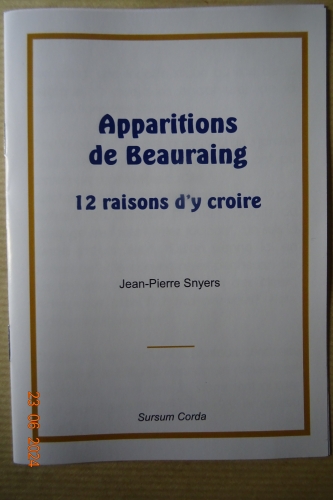

 Homélie du Père Joseph-Marie Verlinde (homelies.fr - archives)
Homélie du Père Joseph-Marie Verlinde (homelies.fr - archives)


