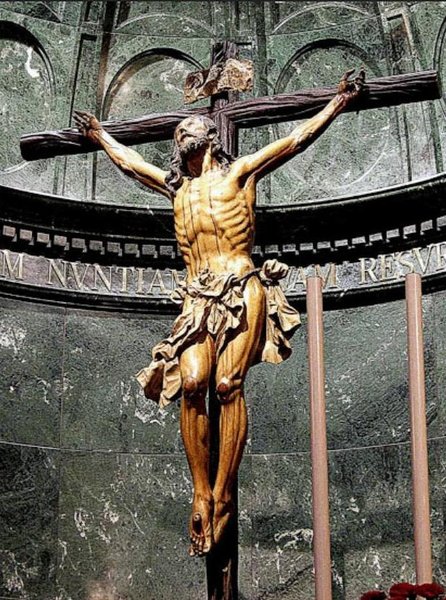De Joe Bukuras sur le National Catholic Register :
Le cardinal Zen parle de son nouveau livre pour le Carême et de ses préoccupations pour l'Église
Le cardinal Zen lui-même a suggéré le mois dernier que le cardinal Víctor Manuel Fernández démissionne en raison de la confusion qui règne autour du dernier document du DDF.
2 février 2024
Dans une interview diffusée le 1er février dans l'émission The World Over with Raymond Arroyo, le cardinal Joseph Zen a présenté son nouveau livre, Cardinal Zen's Lenten Reflections (Réflexions de carême du cardinal Zen) et a abordé des questions controversées récentes au sein de l'Église catholique.
Le cardinal Zen a remercié son ami Aurelio Porfiri, qui a fait traduire certaines des lettres pastorales et homélies précédentes du cardinal en vue de leur publication, pour avoir rendu ce projet possible.
Interrogé sur les sections des Réflexions de Carême du cardinal Zen qui traitent de la persécution, l'évêque émérite de Hong Kong, âgé de 92 ans, a rappelé que "l'Église est toujours persécutée".
Jésus a dit : "Ils ne vous aiment pas parce qu'ils ne m'aiment pas", et nous serons donc persécutés", a-t-il souligné.
"Nous ne devrions pas désirer la persécution. Mais quand la persécution arrive, il faut être heureux, parce que la force qui vient aux martyrs n'est pas leur propre force. C'est le Dieu qui permet la persécution qui donne la force", a-t-il déclaré.
Au cours de l'entretien, M. Arroyo a interrogé le cardinal Zen sur les commentaires du pape François au journal italien La Stampa, le 29 janvier, dans lesquels il faisait référence au rejet de la Fiducia Supplicans par les évêques africains comme un "cas spécial" parce que "pour eux, l'homosexualité est quelque chose de "laid" d'un point de vue culturel ; ils ne la tolèrent pas".
"En fait, il n'y a pas que l'Afrique", a déclaré le cardinal Zen. "Il y a beaucoup d'autres endroits, même certains évêques en France, à ma grande surprise.
Le cardinal Zen lui-même a suggéré le mois dernier que l'auteur de Fiducia Supplicans, le cardinal Víctor Manuel Fernández, démissionne en raison de la confusion qu'il a causée.
"Ils répètent très souvent qu'il s'agit d'une orientation pastorale. Et ils disent que nous voulons éviter la confusion, bien qu'ils aient dit beaucoup de choses, qui n'ont fait qu'accroître la confusion", a noté le cardinal Zen.
M. Arroyo a demandé au cardinal Zen comment il pensait que son ancien mentor, le défunt pape Benoît XVI, aurait réagi au document.
"Je pense que dans tout le magistère du pape Benoît, il n'y a qu'un seul point - la vérité", a déclaré le cardinal Zen.
"Il est donc très important de partir de la vérité. Il n'y a pas d'éducation pastorale correcte si elle n'est pas basée sur la vérité de la foi", a-t-il ajouté.
"La foi, depuis tant de siècles, est très claire sur le fait que la sodomie est une chose grave. C'est pourquoi, chaque fois que nous constatons un malentendu, nous devons faire en sorte que les gens comprennent", a-t-il ajouté.
Interrogé sur la première session du Synode sur la synodalité à Rome, le cardinal Zen a déclaré qu'à son avis, les organisateurs du synode voulaient une "démocratie absolue".
Avant le début du synode l'année dernière, le cardinal Zen a fait part de ses inquiétudes à ses frères évêques et cardinaux dans une lettre qui a été divulguée aux médias.
"Le secrétariat du synode est très efficace dans l'art de la manipulation", a écrit le cardinal Zen dans cette lettre, ajoutant que "souvent, il prétend ne pas avoir d'ordre du jour. C'est une véritable offense à notre intelligence. Tout le monde peut voir les conclusions qu'ils visent".
S'adressant à M. Arroyo, le cardinal Zen a déclaré : "Le mot synodalité est un mot nouveau dans l'Eglise, il faut donc une explication claire de ce que nous comprenons de la synodalité, pas seulement à partir de la source étymologique du mot, parce que l'Eglise utilise le mot synode depuis de nombreux siècles et que synodalité vient de synode.
Le cardinal Zen a déclaré que "les gens considéraient simplement que cela signifiait plus de participation, plus de communion. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'ils comprennent quelque chose de différent. Ils ont donc une autre compréhension, et je pense qu'en termes simples, cette nouvelle synodalité signifie la démocratie, tout comme ils en parlent en Allemagne, ou même au tout début, après Vatican [II], aux Pays-Bas", a-t-il déclaré.
"Ils veulent donc une démocratie absolue. Si cela est approuvé, tout peut être changé, y compris la doctrine de la foi et la morale", a indiqué le cardinal Zen.
Restrictions de la messe en latin
Le cardinal Zen a également évoqué les restrictions imposées à la célébration de la messe latine traditionnelle, telles qu'elles ont été décrites dans le motu proprio Traditionis Custodes du pape François en 2021.
Il s'est dit "surpris par cette forte campagne" visant à limiter la messe en latin. "En tout cas, pour autant que je sache, les personnes qui chérissent cette messe sont de bonnes personnes.
Le cardinal Zen a déclaré que les gens devraient être conscients des nombreux rites liturgiques différents proposés par l'Église.
"Nous avons de nombreux diocèses catholiques de rites orientaux", a déclaré le cardinal Zen. "Ils sont très différents de la messe post-Vatican II. Alors pourquoi s'inquiéteraient-ils d'un nouveau rite, qui n'est pas nouveau, qui a été la messe pendant des années dans l'Église ? a déclaré le cardinal Zen.