De Patrick Kéchichian, écrivain et journaliste, dans le journal « La Croix » (extraits) :
« La question de l’accès au sacrement de l’Eucharistie pour les divorcés remariés revient régulièrement et bruyamment sur le devant de la scène. La blessure et la frustration subjectivement ressenties par certains fidèles – dont ce n’est évidemment pas la sincérité qui doit être mise en doute – se transforment alors en plainte, et la plainte en revendication. Puis le ton monte. On n’écoute plus, tant il devient urgent de parler soi-même. On oublie de penser sa foi, on se contente de l’éprouver comme un sentiment – un sentiment qui, dès lors, commande la pensée. (…)
Tout jugement qui veut s’approcher de la vérité doit s’élever de la sphère de l’opinion à celle de la pensée. Or, il faut aller sans attendre au noyau de la question, appeler un chat un chat et un sacrement un sacrement. Que désigne ce mot ? Un rapport étroit, indissoluble justement, entre, d’une part, un geste, une parole liturgiques et, d’autre part, l’économie du salut, contenue et exprimée dans la Révélation biblique. À la lumière de ce rapport, nos vies se déroulent, dans la solitude et le partage, dans les difficultés, les tourments et les joies, les promesses et les ruptures. Les sacrements, ici ceux du Mariage et de l’Eucharistie, n’ont pas vocation à se mettre sous la dépendance de ces difficultés, ou à se définir par rapport à elles.
En d’autres termes, devant l’autel et devant Dieu, un sacrement reçu l’est absolument. Hors de cette absolue réception, le sens du sacrement tombe, ou au moins s’étiole. À ce sens complexe et dûment réfléchi, on a donc tort d’opposer un droit personnel revendiqué par une conscience propre qui n’est pas juge en la matière, conformément au principe bien connu qui stipule que « personne n’est juge en sa propre cause ». Comme le souligne Mgr Müller, invoquer ici ce droit au nom de la miséricorde divine est une manière de réduire et d’instrumentaliser cet attribut de Dieu, inséparable de sa justice et de sa sainteté. L’expérience vécue n’a pas à entrer en concurrence avec la nature objective de l’acte sacramentaire. Elle n’a pas à lui dicter sa loi.
 Abbaye Saint Paul de Wisques
Abbaye Saint Paul de Wisques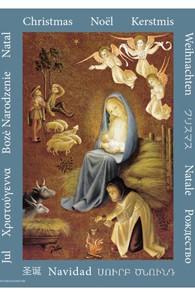
 → Avec Stéphan JUNKER, professeur au conservatoire de Verviers et Gérald MESSIAEN, membre du chœur grégorien de Leuven, un cycle d’initiation, axé cette année sur les plains chants tardifs : douze leçons, un concert et une messe de clôture (cours de fin novembre 2013 à fin mai 2014, dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement, Boulevard d’Avroy, 132 : inscriptions le 30 novembre 2013 au plus tard)
→ Avec Stéphan JUNKER, professeur au conservatoire de Verviers et Gérald MESSIAEN, membre du chœur grégorien de Leuven, un cycle d’initiation, axé cette année sur les plains chants tardifs : douze leçons, un concert et une messe de clôture (cours de fin novembre 2013 à fin mai 2014, dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement, Boulevard d’Avroy, 132 : inscriptions le 30 novembre 2013 au plus tard)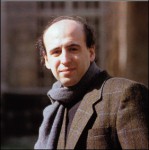 → Avec Marcel PÉRÈS, directeur de l’Ensemble vocal « Organum » et du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes), trois séminaires thématiques (le chant vieux romain, du 20 au 22 décembre 2013 ; la notation neumatique carrée, du 10 au 12 janvier 2014 ; le plain chant médiéval entre Meuse et Rhin, du 7 au 9 mars 2014 (à l’abbaye bénédictine de la Paix Notre-Dame, Boulevard d’Avroy, 54 : inscription le 10 décembre 2013 au plus tard).
→ Avec Marcel PÉRÈS, directeur de l’Ensemble vocal « Organum » et du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes), trois séminaires thématiques (le chant vieux romain, du 20 au 22 décembre 2013 ; la notation neumatique carrée, du 10 au 12 janvier 2014 ; le plain chant médiéval entre Meuse et Rhin, du 7 au 9 mars 2014 (à l’abbaye bénédictine de la Paix Notre-Dame, Boulevard d’Avroy, 54 : inscription le 10 décembre 2013 au plus tard).