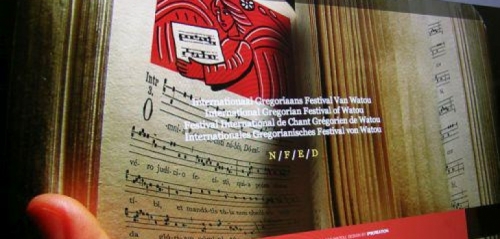L'équipe de Cathobel a rencontré le cardinal Jozef De Kesel
De Cathobel.be :
Rencontre avec le cardinal De Kesel
 Le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et président de la Conférence des évêques de Belgique, a rencontré l’équipe de CathoBel. A cette occasion il a accordé un entretien à la rédaction.
Le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et président de la Conférence des évêques de Belgique, a rencontré l’équipe de CathoBel. A cette occasion il a accordé un entretien à la rédaction.
Monsieur le Cardinal, quels sont aujourd’hui les principaux défis pour l’Eglise catholique, plus particulièrement en Occident?
En Occident, on a vécu, pendant des siècles, dans un monde chrétien, où il n’y avait pas de différence entre la société et l’Eglise. Aujourd’hui, on vit dans une société où la foi en Dieu ne fait plus partie de la culture en tant que telle. Il y a des moments où le christianisme et l’Eglise s’intègrent bien dans la culture, dans la société, mais à d’autres moments il y a une plus grande distance. Comment montrer que la foi chrétienne, l’Evangile, sont des valeurs ajoutées et importantes pour l’homme sécularisé? Tel est selon moi, aujourd’hui, le grand défi de l’Eglise en Occident.
Il ne s’agit donc pas, pour les chrétiens, de réinstaurer une civilisation chrétienne?
Cela dépend de ce qu’on entend par « civilisation ». Il est clair que notre civilisation est imprégnée par le christianisme, comme d’ailleurs par la culture antique. Par contre, notre société n’est plus chrétienne en tant que telle, et cela, il faut l’accepter.
Je rencontre parfois des évêques du Proche-Orient, qui vivent dans des pays musulmans, où l’Eglise est minoritaire, et où les chrétiens sont des citoyens de seconde zone. Ces évêques me disent que ce dont nous avons besoin, ce n’est surtout pas d’un régime religieux, mais d’un régime laïque, c’est-à-dire d’un régime neutre, où chacun est respecté dans sa propre conviction. Je pense que c’est valable pour le Proche-Orient, mais également pour nous.
J’espère évidemment que notre société pluraliste, sécularisée, ne devienne pas séculariste, où la religion serait minorisée, mise de côté, « privatisée ». Mais vouloir en revenir, chez nous, à un christianisme culturel, n’est pas, selon moi, l’avenir de l’Eglise. C’est dans cette situation de pluralisme, que nous devons accepter de tout cœur, que nous avons une mission à remplir en tant que chrétiens.
A côté du matérialisme consumériste, une quête de spiritualité se manifeste en Occident. Cependant, peu de personnes se tournent vers la foi chrétienne pour chercher une réponse à leur quête. Comment expliquer cela?
Personnellement, cela ne m’étonne pas. Une société sécularisée et consumériste crée une soif spirituelle. Il y a aujourd’hui toutes sortes de spiritualités. Mais ce qui pose problème, pour l’homme sécularisé, c’est la question de Dieu, car elle touche à l’autonomie de l’homme, qui est précisément à la base de la sécularisation. La sécularisation, c’est l’homme qui a trouvé la liberté et qui a des difficultés à accepter des limites à cette liberté. Or, je pense qu’une liberté sans limites est un mythe, et est aussi à la base du manque de sens dans la vie. Parce que ce sont précisément les limites qui donnent un sens à ma liberté.
Pour quelqu’un qui trouve la foi, il s’agit d’accepter l’Autre, le Tout-Autre, dans sa vie. Ce qui donne sens à ma vie, ce n’est pas ma liberté en tant que telle, mais ce que je peux signifier pour l’autre, et quand je me fais réponse à l’appel de l’autre. Or, accepter l’autre, ce n’est pas facile. On le voit aujourd’hui dans la question de l’étranger, de l’immigré, ou de l’interreligieux. Est-ce que je suis capable d’accepter l’autre dans son altérité? Et en tant que croyant, il s’agit d’accepter Quelqu’un qui signifie une limite à ma liberté. Non pas au service d’un esclavage, mais pour donner sens à ma liberté.
Il y a quelques temps, nous avons célébré les cinq premières années de pontificat du pape François. Quels sont, selon vous, les axes majeurs de ce pontificat?
Pour moi, les deux axes majeurs de ce pontificat sont la collégialité et l’humanité, la miséricorde. La question de la collégialité de l’Eglise a été posée au concile Vatican II, mais déjà également au concile Vatican I. Ce concile a été interrompu par la guerre entre la France et l’Allemagne. On y a traité, de façon très claire, de la question de la primauté dans l’Eglise, mais en étant conscient qu’il fallait également traiter la collégialité, ce que Vatican I n’a pas eu le temps de faire. Le pape Jean XXIII a convoqué le concile Vatican II entre autres pour cette question-là, qui touche au gouvernement interne de l’Eglise. Ce n’est donc pas le pape François qui a introduit cette question, ses prédécesseurs l’ont également abordée. Mais, chez le pape François, il y a une volonté de ne pas en rester au questionnement théologique, et d’aborder la collégialité dans les faits.
En ce qui concerne le deuxième axe, le pape parle parfois du danger d’une certaine rigidité, aussi bien doctrinale et liturgique que morale. On dit parfois qu’il n’est pas assez clair, mais il n’est nullement dans son intention de dire que les lois n’ont pas de sens. Mais on sent un souffle d’humanité qui, à mon avis, est perçu comme un souffle d’Evangile, par des gestes et de petites paroles. Parfois, on dit du pape qu’il n’est pas assez théologique. Il est théologien, il est bien formé; il ne faut pas en douter. Mais cette parole humaine est très importante pour dire et pour montrer que l’Evangile, que notre foi chrétienne, est source d’humanité.
Depuis le début de son pontificat, le pape François tente d’introduire certaines réformes dans le fonctionnement de l’Eglise. L’Eglise doit-elle être constamment réformée?
Oui et non. L’Eglise reste toujours la même, la foi chrétienne ne change pas, mais elle se vit toujours dans des contextes différents. Etre Eglise en Chine aujourd’hui, ce n’est pas la même chose qu’à Paris. Et au XVIIIe siècle, on n’était pas dans la même situation qu’aujourd’hui. L’Eglise doit toujours répondre à l’appel de Dieu dans ces circonstances concrètes, et en ce sens-là, elle n’est jamais figée. C’est cela que le pape François dit aussi: on ne peut pas faire de la tradition quelque chose qui est figé, et que l’on a qu’à transmettre comme tel. Non, cela demande beaucoup de créativité, beaucoup de foi, beaucoup de discernement – encore un concept du pape François –, pour savoir ce que le Seigneur attend de son Eglise ici et maintenant. Et donc, en ce sens-là, l’Eglise doit toujours se réformer, « Ecclesia semper reformanda. »
Propos recueillis par Christophe HERINCKX
l'intégralité de l'entretien est ICI



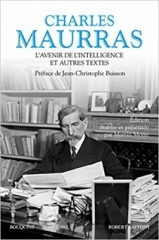 « Né le 20 avril 1868, mort en novembre 1952, le maître de l’Action française avait été inscrit au registre des commémorations nationales. Il était évident que la République française, combattue par Maurras toute sa vie, n’allait pas encenser l’auteur de L’Enquête sur la monarchie ou de Mes idées politiques. Il était peu probable également que le ministre Blanquer ait voulu inscrire au programme des écoles les poèmes maurrassiens ou sa remise en cause du romantisme et de ses conséquences. Encore moins imaginable que sa théorie des « quatre États confédérés » et son « antisémitisme d’État » deviennent, par l’onction d’une célébration, la ligne de conduite de la présidence macronienne.
« Né le 20 avril 1868, mort en novembre 1952, le maître de l’Action française avait été inscrit au registre des commémorations nationales. Il était évident que la République française, combattue par Maurras toute sa vie, n’allait pas encenser l’auteur de L’Enquête sur la monarchie ou de Mes idées politiques. Il était peu probable également que le ministre Blanquer ait voulu inscrire au programme des écoles les poèmes maurrassiens ou sa remise en cause du romantisme et de ses conséquences. Encore moins imaginable que sa théorie des « quatre États confédérés » et son « antisémitisme d’État » deviennent, par l’onction d’une célébration, la ligne de conduite de la présidence macronienne.