De Benoît XVI, lors de l'Audience générale du 6 septembre 2006 (source)
Philippe
Dans les listes des Douze, Philippe est toujours placé à la cinquième place (comme dans Mt 10, 3 ; Mc 3, 18 ; Lc 6, 14 ; Ac 1, 13), et donc substantiellement parmi les premiers. Bien que Philippe soit d’origine juive, son nom est grec, comme celui d’André, et cela constitue un petit signe d’ouverture culturelle qui ne doit pas être sous-évalué. Les informations à son propos nous sont fournies par l’Évangile de Jean. Il provenait du même lieu d’origine que Pierre et André, c’est-à-dire de Bethsaïde (cf. Jn 1, 44), une petite ville appartenant à la tétrarchie de l’un des fils d’Hérode le Grand, lui aussi appelé Philippe (cf. Lc 3, 1).
Le Quatrième Évangile rapporte que, après avoir été appelé par Jésus, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : « Celui dont parlent la loi de Moïse et les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth » (Jn 1, 45). Philippe ne se rend pas à la réponse plutôt sceptique de Nathanaël (« De Nazareth ! Peut-il sortir de là quelque chose de bon ? »), et riposte avec décision : « Viens, et tu verras ! » (Jn 1, 46). Dans cette réponse, sèche mais claire, Philippe manifeste les caractéristiques du véritable témoin : il ne se contente pas de proposer l’annonce, comme une théorie, mais interpelle directement l’interlocuteur en lui suggérant de faire lui-même l’expérience personnelle de ce qui est annoncé. Les deux mêmes verbes sont utilisés par Jésus lui-même quand deux disciples de Jean-Baptiste l’approchent pour lui demander où il habite (cf. Jn 1, 39). Jésus répondit : « Venez et voyez » (cf. Jn 1, 38, 39).
Nous pouvons penser que Philippe s’adresse également à nous avec ces deux verbes qui supposent un engagement personnel. Il nous dit à nous aussi ce qu’il dit à Nathanaël : « Viens et tu verras ». L’Apôtre nous engage à connaître Jésus de près. En effet, l’amitié, la véritable connaissance de l’autre, a besoin de la proximité, elle vit même en partie de celle-ci. Du reste, il ne faut pas oublier que, selon ce que saint Marc écrit, Jésus choisit les Douze dans le but primordial qu’ »ils soient avec lui » (Mc 3, 14), c’est-à-dire qu’ils partagent sa vie et apprennent directement de lui non seulement le style de son comportement, mais surtout qui Il était véritablement. Ce n’est qu’ainsi, en effet, en participant à sa vie, qu’il pouvait le connaître et ensuite l’annoncer. Plus tard, dans la Lettre de Paul aux Éphésiens, on lira que l’important est d’ »apprendre le Christ » (4, 20), et donc pas seulement et pas tant d’écouter ses enseignements, ses paroles, que, davantage encore, Le connaître en personne ; c’est-à-dire connaître son humanité et sa divinité, son mystère, sa beauté. En effet, il n’est pas seulement un Maître, mais un Ami, et même un Frère. Comment pourrions-nous le connaître à fond en restant éloignés ? L’intimité, la familiarité, l’habitude nous font découvrir la véritable identité de Jésus Christ. Voilà : c’est précisément cela que nous rappelle l’apôtre Philippe. Et ainsi, il nous invite à « venir », à « voir », c’est-à-dire à entrer dans une relation d’écoute, de réponse et de communion de vie avec Jésus, jour après jour.
Ensuite, à l’occasion de la multiplication des pains, il reçut de Jésus une demande précise, pour le moins surprenante : savoir où il était possible d’acheter du pain pour nourrir tous les gens qui le suivaient (cf. Jn 6, 5). Philippe répondit alors avec un grand réalisme : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain » (Jn 6, 7). On voit ici le caractère concret et le réalisme de l’Apôtre, qui sait juger les aspects réels d’une situation. Nous savons comment les choses se sont ensuite passées. Nous savons que Jésus prit les pains et, après avoir prié, les distribua. Ainsi se réalisa la multiplication des pains. Mais il est intéressant que Jésus se soit adressé précisément à Philippe, pour avoir une première indication sur la façon de résoudre le problème : signe évident qu’il faisait partie du groupe restreint qui l’entourait. A un autre moment, très important pour l’histoire future, avant la Passion, plusieurs grecs qui se trouvaient à Jérusalem pour la Pâque « abordèrent Philippe… Ils lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe va le dire à André ; et tous deux vont le dire à Jésus » (Jn 12, 20-22). Nous avons une fois de plus le signe de son prestige particulier au sein du collège apostolique. Dans ce cas, il sert surtout d’intermédiaire entre la demande de plusieurs Grecs - il parlait probablement grec et put servir d’interprète - et Jésus ; même s’il s’unit à André, l’autre Apôtre qui porte un nom grec, c’est, quoi qu’il en soit, à lui que ces étrangers s’adressent. Cela nous enseigne à être nous aussi toujours prêts à accueillir les demandes et les invocations, d’où qu’elles proviennent, ainsi qu’à les orienter vers le Seigneur, l’unique qui puisse les satisfaire pleinement. Il est en effet important de savoir que nous ne sommes pas les destinataires ultimes des prières de ceux qui nous approchent, mais que c’est le Seigneur : c’est à lui que nous devons adresser quiconque se trouve dans le besoin. Voilà : chacun de nous doit être une route ouverte vers lui !
Il y a ensuite une autre occasion, toute particulière, où Philippe entre en scène. Au cours de la Dernière Cène, Jésus ayant affirmé que Le connaître signifiait également connaître le Père (cf. Jn 14, 7), Philippe, presque naïvement, lui demanda : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit » (Jn 14, 8). Jésus lui répondit avec un ton de reproche bienveillant : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : « Montre-nous le Père ? ». Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?… Croyez ce que je vous dis : je suis dans le Père, et le Père est en moi » (Jn 14, 9-11). Ces paroles se trouvent parmi les plus importantes de l’Évangile de Jean. Elles contiennent une véritable révélation. Au terme du prologue de son Évangile, Jean affirme : « Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c’est lui qui a conduit à le connaître » (Jn 1, 18). Eh bien, cette déclaration, faite par l’évangéliste, est reprise et confirmée par Jésus lui-même. Mais avec une nouvelle nuance. En effet, alors que le prologue de Jean parle d’une intervention explicative de Jésus, à travers les paroles de son enseignement, dans la réponse à Philippe, Jésus fait référence à sa propre personne comme telle, laissant entendre qu’il est possible de le comprendre non seulement à travers ce qu’il dit, mais encore plus à travers ce qu’Il est simplement. Pour nous exprimer selon le paradoxe de l’Incarnation, nous pouvons bien dire que Dieu s’est donné un visage humain, celui de Jésus, et en conséquence à partir de maintenant, si nous voulons vraiment connaître le visage de Dieu, nous n’avons qu’à contempler le visage de Jésus ! Dans son visage, nous voyons réellement qui est Dieu et comment est Dieu !
L’évangéliste ne nous dit pas si Philippe comprit pleinement la phrase de Jésus. Il est certain qu’il consacra entièrement sa vie à lui. Selon certains récits postérieurs (Actes de Philippe et d’autres), notre Apôtre aurait évangélisé tout d’abord la Grèce, puis la Phrygie où il aurait trouvé la mort, à Hiérapolis, selon un supplice décrit différemment comme une crucifixion ou une lapidation. Nous voulons conclure notre réflexion en rappelant le but auquel doit tendre notre vie : rencontrer Jésus comme Philippe le rencontra, en cherchant à voir en lui Dieu lui-même, le Père céleste. Si cet engagement venait à manquer, nous serions toujours renvoyés uniquement à nous-mêmes comme dans un miroir, et nous serions toujours plus seuls ! Philippe, en revanche, nous enseigne à nous laisser conquérir par Jésus, à être avec lui, et à inviter également les autres à partager cette indispensable compagnie. Et, en voyant, en trouvant Dieu, trouver la vie véritable.

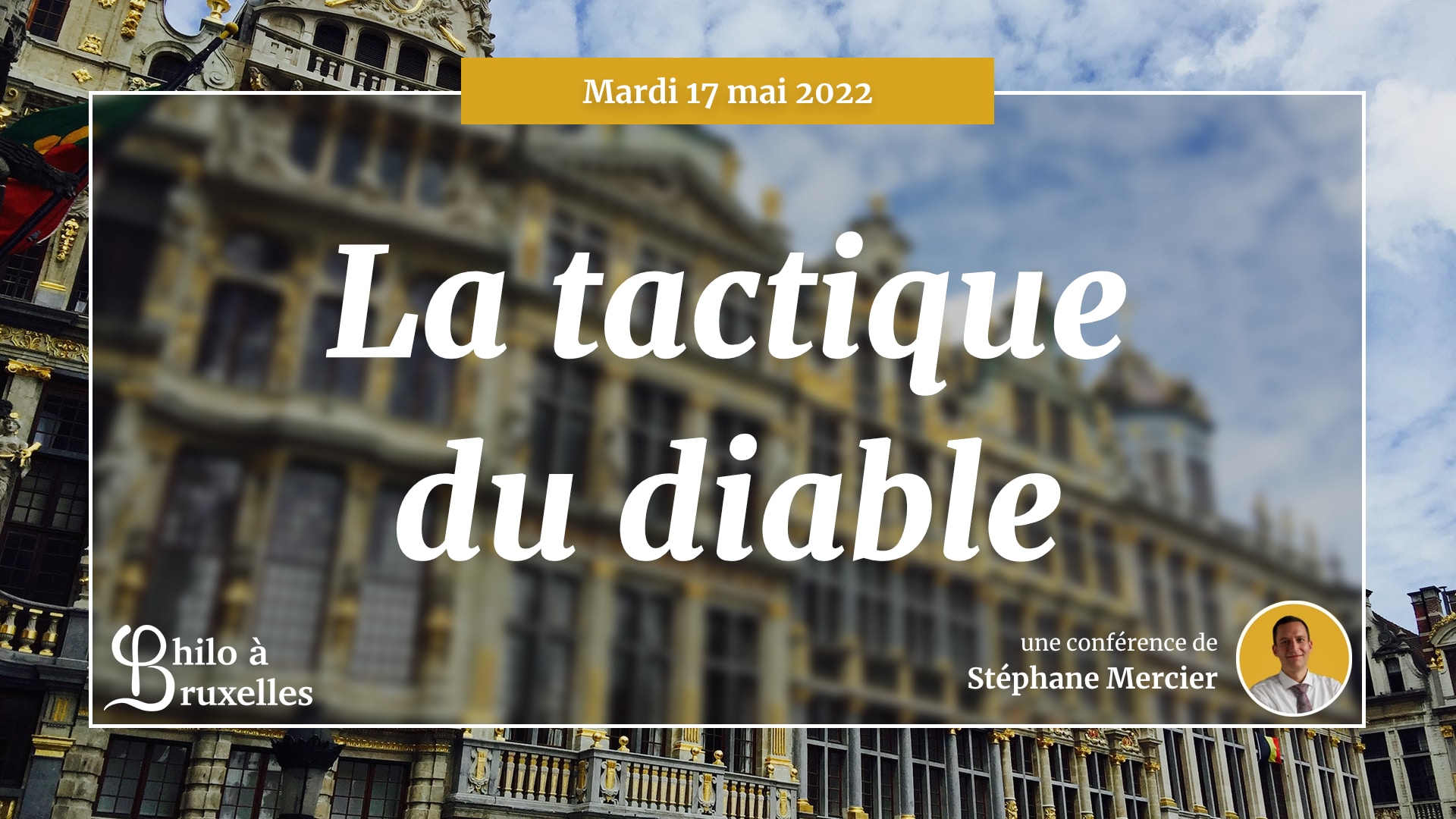
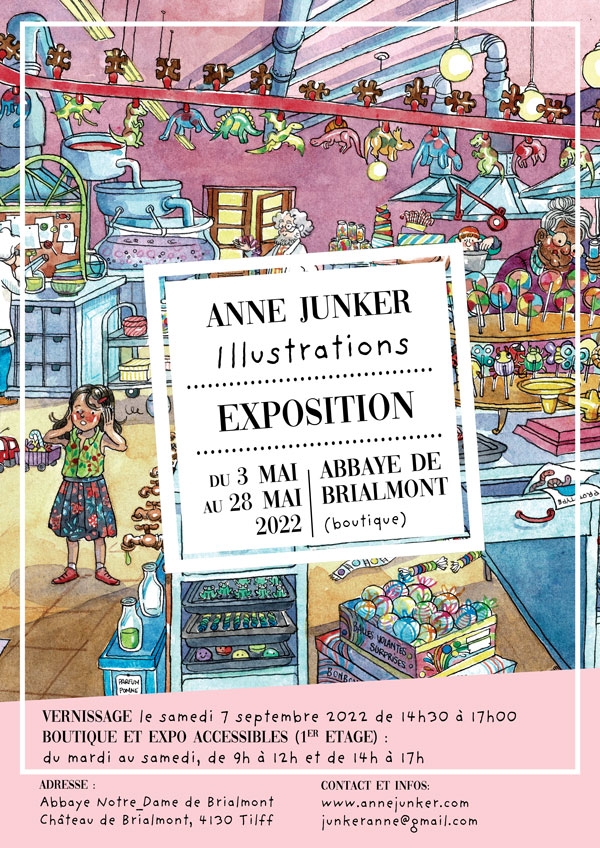

 « Le cardinal Péter Erdő, 70 ans le 25 juin, est archevêque d’Esztergom-Budapest et primat de Hongrie. Polyglotte, canoniste de formation, administrateur vigoureux, il est considéré comme une figure éminente, quoique discrète et presque timide, de la tendance « néo-conservatrice » au sein du Sacré Collège. C’est un bon représentant des dirigeants des Églises de l’Est de l’Europe opprimées sous la dictature soviétique.
« Le cardinal Péter Erdő, 70 ans le 25 juin, est archevêque d’Esztergom-Budapest et primat de Hongrie. Polyglotte, canoniste de formation, administrateur vigoureux, il est considéré comme une figure éminente, quoique discrète et presque timide, de la tendance « néo-conservatrice » au sein du Sacré Collège. C’est un bon représentant des dirigeants des Églises de l’Est de l’Europe opprimées sous la dictature soviétique.