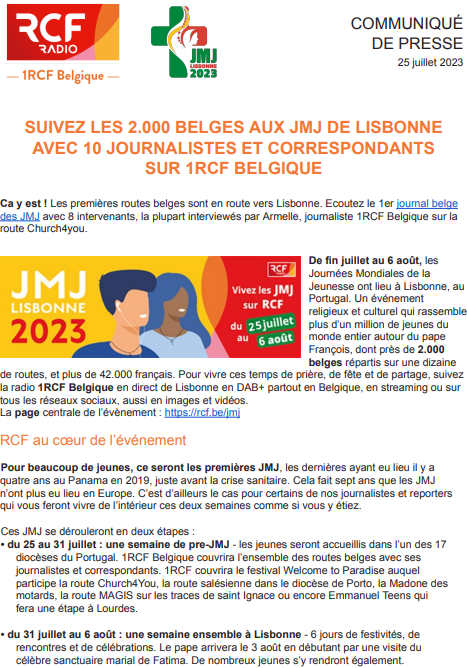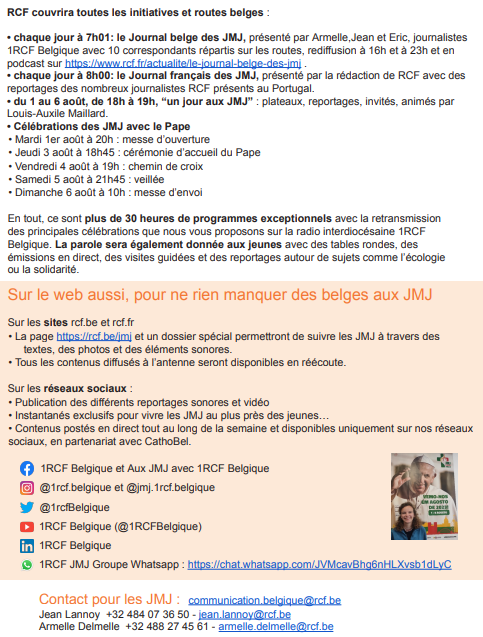Une synthèse de presse de gènéthique.org :
Ce sont les chromosomes qui font de nous une femme ou un homme, « de la tête aux pieds »
« Pour la majorité », « le simple fait d’évoquer un cerveau sexué serait de l’ordre de l’hérésie ». Dans un entretien pour le journal Le Figaro, Claudine Junien, professeur émérite de génétique médicale, membre correspondante de l’Académie nationale de médecine, et co-auteur avec Nicole Priollaud de l’ouvrage C’est votre sexe qui fait la différence, déplore la « confusion » entre « genre » et « sexe ». Une « confusion » telle que « pour certains, changer de sexe serait comparable à changer de genre ».
Pas d’hormones sans chromosomes
Pourtant, ce sont bien les chromosomes, présents dès la conception « dans chacune de nos milliers de milliards de cellules » qui « font de nous une “femme” avec la paire de chromosomes sexuelle XX ou, un “homme”, avec la paire XY, de la tête aux pieds ». Les gènes des chromosomes sexuels permettent d’exprimer de manière différente « un tiers de l’ensemble de nos gènes », selon que l’on est un homme ou une femme.
Les hormones qui apparaissent entre la 6e et la 8e semaine de grossesse « ne seront jamais seules mais toujours accompagnées de ces chromosomes et de leurs gènes, qui sont eux, dans toutes nos cellules et tout au long de la vie ». En outre, elles varieront en quantité : de la grossesse à la ménopause, en passant par la puberté.
Des différences anatomiques
Le résultat se traduit par « des différences anatomiques notables entre femmes et hommes ». Ainsi, « la masse maigre est, en moyenne, de 36% supérieure chez les hommes ». Leur masse musculaire est « 73% plus importante dans les bras », « ce qui accroît considérablement la force des hommes par rapport à celle des femmes ». Des différences qui ne disparaissent pas sous l’effet des hormones.
Dès lors « est-il juste de laisser concourir ces individus devenus femelles par leur genre mais restées mâles par leur sexe -présent dans toutes leurs cellules- contre des femmes ? », interroge le professeur. « Pour embrasser une carrière de pilote d’avion, personne ne trouve à redire au fait qu’il faille réussir à des tests de vision et d’audition ».
Des conséquences sur la santé
L’autisme « touche 4 à 5 fois plus les garçons que les filles, qui sont diagnostiquées plus tardivement », souligne Claudine Junien. Par ailleurs, l’anorexie atteint, elle, 9 filles pour un garçon.
« Depuis le milieu des années 2000 la recherche a pu mettre en évidence que la transmission du stimulus douloureux passe par des types cellulaires différents, des cellules T du système immunitaire chez les femmes et des cellules de la microglie du système nerveux chez les hommes », indique le professeur. « Ce qui expliquerait pourquoi les femmes sont plus “douillettes” que les hommes ». Et « au niveau moléculaire, l’étude des niveaux d’expression des gènes dans différents tissus de femmes et d’hommes déprimés ont montré que pour la dépression les réseaux de gènes impliqués dans 6 régions différentes du cerveau diffèrent beaucoup plus qu’ils ne se ressemblent, entre les femmes et les hommes ».
Face à la multiplication de ces exemples, Claudine Junien appelle à « chercher de nouveaux médicaments de façon différente », pour traiter chaque personne de la meilleure façon possible.
Source : Le Figaro, propos recueillis par Eugénie Bastié (25/07/2023)