 Etats-Unis: une lecture de l’Exhortation du pape François dans la ligne du Cardinal Müller, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Lu sur le blog « Salon beige » :
Etats-Unis: une lecture de l’Exhortation du pape François dans la ligne du Cardinal Müller, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Lu sur le blog « Salon beige » :
« La Conférence épiscopale des États-Unis a élu Mgr Charles Chaput, archevêque de Philadelphie, président de la conférence pour la mise en œuvre de l'Exhortation apostolique Amoris Laetitia pour les Etats-Unis.
Le choix de la Conférence Épiscopale américaine est un signe clair de l'épiscopat américain, compte tenu du fait que Mgr Chaput a toujours soutenu la nécessité d'être fidèles au Christ dans tous les domaines, y compris l'impossibilité pour les divorcés remariés de recevoir la communion, à moins qu'ils choisissent de vivre dans la chasteté, comme des frères.
L'archevêque de Philadelphie, dans un article publié l'année dernière dans la revue First Thing, écrivait :
«L'Église a toujours insisté sur la nécessité de se repentir des péchés graves comme condition pour recevoir l'Eucharistie".
Mgr Chaput a dit que l'Église n'a pas à «punir» ou «exclure» les couples divorcés et remariés, mais "ne peut pas ignorer la Parole de Dieu sur la permanence du mariage, ou d'atténuer les conséquences des choix qui les gens matures prennent librement. Vous ne pouvez pas confirmer l'homme dans les comportements qui les séparent de Dieu et en même temps être fidèle à sa propre mission."
L'archevêque a déclaré que l'ouverture de la communion aux divorcés remariés ne serait pas un acte de vraie miséricorde, mais conduit à un «effondrement» qui existe déjà "en Europe, dans ces églises où la pratique pastorale sur le divorce, remariages et la réception des sacrements a quitté l'enseignement catholique authentique ».
Mgr Chaput préside un groupe de travail composé de cinq évêques, dont le but est «d'aider le Saint-Père dans la réception et la mise en œuvre future de l'Exhortation post-synodale apostolique Laetitia Amoris".
Les autres évêques qui forment ce comité sont Mgr Vigneron, archevêque de Detroit, Mgr Hebda, évêque de Saint-Paul et Minneapolis, Mgr Burbidge, évêque de Raleigh et Mgr Malone, évêque de Buffalo. »
Ref. Mgr Charles Chaput élu par ses pairs pour mettre en oeuvre Amoris Laetitia
JPSC
 Le pape François envisage une commission pour plancher sur le rôle des « diaconesses » dans l’Eglise primitive: l’agence Zenit rappelle qu’une enquête historique a déjà été menée en 2003, à la demande de saint Jean-Paul II, par la Commission théologique internationale, mettant en évidence la différence entre “diacre” et “diaconesse”, dans un document intitulé : « Le diaconat. Evolution et perspectives » Pour enrichir le débat rouvert par le pape régnant, l’Agence publie une réflexion d’un théologien de la Faculté théologique de Lugano (Suisse) : le professeur Manfred Hauke . En voici le texte, daté du 17 mai 2016 :
Le pape François envisage une commission pour plancher sur le rôle des « diaconesses » dans l’Eglise primitive: l’agence Zenit rappelle qu’une enquête historique a déjà été menée en 2003, à la demande de saint Jean-Paul II, par la Commission théologique internationale, mettant en évidence la différence entre “diacre” et “diaconesse”, dans un document intitulé : « Le diaconat. Evolution et perspectives » Pour enrichir le débat rouvert par le pape régnant, l’Agence publie une réflexion d’un théologien de la Faculté théologique de Lugano (Suisse) : le professeur Manfred Hauke . En voici le texte, daté du 17 mai 2016 :
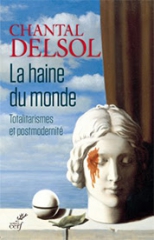 Le vrai débat contemporain : émancipation ou enracinement ?
Le vrai débat contemporain : émancipation ou enracinement ?