Que penser de la pensée de Pierre Hillard ? l’avis d’un catholique conciliaire (27 mn). (Cet avis n’engage que l’auteur de cette vidéo). Par Arnaud Dumouch, agrégé en Sciences religieuses, juillet 2014 1° Comprendre sa pensée eschatologique et millénariste : « Ce monde vit une lutte eschatologique entre le Christ (porté par l’Eglise catholique pré-Vatican II) et l’Antéchrist (porté par l’Israël talmudique) en vue d’établir une domination spirituelle et politique sur la terre. Il existe un complot des Juifs talmudiques pour éliminer des obstacles : 1° le nouvel Israël qui est l’Eglise (par le moyen de Vatican II et des papes qui l’ont appliqué) ; 2° le bras de sa royauté qui fut la France catholique et royale (par le moyen de la Révolution Française). La FSSPX et Monseigneur Lefebvre, dernier reste des catholiques, est actuellement divisée par « le serpent », Benoît XVI et sa ruse de « l’herméneutique de Vatican II dans la continuité des autres conciles ». » 2° Quatre critiques concernant la pensée de Pierre Hillard : 1° Son erreur millénariste sur la royauté du Christ et de l’Eglise (voir CEC 676) ; 2° Son oubli théologique de la mission sainte et eschatologique d’Israël à la fin du monde (voir Rm 11, 29) ; 3° Sa théorie du complot (voir Eph 6, 12) ; 4° Son erreur sur la destruction de la foi et du sacerdoce ministériel par le Concile Vatican II. Pierre Hillard doit indiquer de nouveau le Ciel (voir Ap 12, 4)."
Débats - Page 591
-
Quand un catholique conciliaire examine la pensée de Pierre Hillard
-
Des précisions à propos de la statue de la Vierge de Jalhay
Notre ami Jean-Pierre Snyers nous fait part de ses dernières observations au sujet de la statue de la Vierge de Sart-lez-Spa (Jalhay) :
Statue de Jalhay ; précisions
On le sait, l'université de L!ège a déterminé que l'illumination de la statue de la Vierge de Jalhay est le résultat d'une peinture composée de sulfure de zinc. Cela dit, des questions demeurent. En voici quelques unes...
1) La statue et la peinture qui la recouvre date d'il y a plus de 50 ans. Pourquoi cette mystérieuse peinture n'a-t-elle commencé à fonctionner que le 17 janvier 2014. ?Toute expérience scientifique devant être reproductible, pourrait-on enduire une statue en faisant en sorte que celle-ci ne s'éclaire qu'en 2064 ?
2) Pourquoi les statues réalisées à la même époque composées de cette même peinture ne s'illuminent-elles pas et pourquoi de multiples objets (nains de jardin, vases, assiettes...) qui sont recouverts de ce même produit ne s'illuminent-ils pas non plus ?
3) Par quel prodige ne s'éclaire-t-elle que lorsqu'il y a une présence humaine ? (l'expérience a été faite à de nombreuses reprises).
4) Comment expliquer que cette statue ne commence parfois à s'éclairer qu'après 10 longues minutes (j 'en ai moi-même été témoin à plusieurs reprises et un journaliste du quotidien « Het Laaste Nieuws » aussi) et que l'illumination de celle-ci est en même temps visible par certains et pas par d'autres ? J'en ai également été témoin. Comme chacun le sait, dans le cas d'une statue phosphorescente, dès l'obscurité, le phénomène lumineux est immédiat et visible par tout le monde.
5) Pourquoi les endroits abîmés (c'est à dire ceux où il n'y a plus de peinture) s'éclairent-ils aussi ? Ayant une statue phosphorescente, j'ai fait l'expérience. Contrairement à la statue de Jalhay, les quelques endroits où j'ai enlevé de la peinture ne s'illuminent pas.
6) Comment expliquer les multiples guérisons (parfois spectaculaires) produites par les prières adressées auprès de cette statue ?
En conclusion : je ne comprends toujours pas en quoi l'explication de l'ULG peut être considérée comme étant rationnellement satisfaisante et demeure très sceptique quant à la capacité des experts de nous fournir des réponses convaincantes aux 6 questions posées. A mon sens, il serait judicieux que l'évêché de Liège fasse sa propre enquête (notamment en interrogeant de multiples témoins de ce phénomène pour le moins très mystérieux).
Jean-Pierre Snyers (Adresse blog : jpsnyers.blogspot.com) Bindef 2 4141 Louveigné
-
Quand un universitaire néerlandais revient sur son soutien à l'euthanasie légale
De Jeanne Smits, sur son blog :
“Avec le recul”, l'universitaire néerlandais Theo Boer revient sur son soutien à l'euthanasie légale
On a beaucoup glosé sur le revirement d’un universitaire néerlandais, Theo Boer favorable en 2002 à la légalisation de l’euthanasie, cité par le tabloïde anglais The Daily Mail comme ayant supplié les Britanniques de ne pas imiter les Pays-Bas à propos du suicide assisté : « Ne faites pas notre erreur », c’est sa phrase montée à la une du quotidien conservateur. En France, le Courrier International s’est emparé du sujet dans un bref article informatif où il parle de « Theo De Boer ». De nombreux sites d’information ont cité l’article du Daily Mail rapportant les propos de Theo Boer qui y sont présentés comme une sorte d’interview.
Récusant le procédé, le Pr Boer a contacté Alex Schadenberg d’Euthanasia Prevention Coalition en lui fournissant l’article complet qu’il avait écrit pour les médias anglais. Je vous en propose ici ma traduction. Etant donné la demande de Theo Boer, merci de ne pas tirer des citations de ce texte qui forme un tout.
On peut y renvoyer en utilisant ce lien : http://leblogdejeannesmits.blogspot.fr/2014/07/avec-le-recul-luniversitaire.html. – J.S.
Lire la traduction sur le blog de Jeanne Smits
-
Sacerdotalis caelibatus
Dans la publication, par le quotidien « la Repubblica », du récent entretien accordé par le pape François à Eugenio Scalfari on peut lire notamment ce dialogue (réf. ici: Ma traduction. Pour savoir vraiment ce qui a été dit. Ou ce que Scalfari dit qu'il a été dit (14/7/2014) )
-« Sainteté, vous travaillez assidument pour intégrer la catholicité avec les orthodoxes, les anglicans ...
Il m'interrompt et poursuit:
-«Avec les Vaudois ( l'église évangélique vaudoise), que je trouve des religieux de premier ordre, avec les pentecôtistes et naturellement, avec nos frères juifs»
- Eh bien, beaucoup de ces prêtres ou pasteurs sont régulièrement mariés. Comment va évoluer au fil du temps ce problème dans l'Eglise de Rome?
- « Peut-être ne savez-vous pas que le célibat a été établi au Xe siècle, c'est-à-dire 900 ans après la mort de notre Seigneur. L'Eglise catholique orientale a à ce jour la faculté que ses prêtres se marient . Le problème existe certainement mais n'est pas d'une grande ampleur. Il faut du temps, mais il y a des solutions et je les trouverai
Le Père Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, a nuancé les termes supposés de la réponse faite par le pape François, en précisant qu’on ne pouvait attribuer avec certitude à celui-ci l’affirmation « les solutions, je les trouverai ». Et il a sans doute bien fait car cette question de la continence liée à la discipline sacerdotale est presqu’aussi vieille que l’Eglise et ne se résume pas à la réforme de Grégoire VII (XIe siècle) prescrivant de n’ordonner que des hommes célibataires. Le Père aurait pu préciser aussi qu’orientaux ou non la faculté de se marier n’est jamais laissée aux prêtres après leur ordination.
Petit rappel avec le P. Thierry Dejond, s.j. (cité ici : Pour en finir avec l’ordination des hommes mariés et des femmes, en réponse à un article de son confrère Charles Delhez, lui aussi de la Compagnie de Jésus):
« Si les Eglises orientales ‘revenues au catholicisme’ ont accepté d’ordonner des hommes mariés (vu leur passé orthodoxe datant de 690) [ndlr : concile « in trullo »], c’est par miséricorde de l’Eglise catholique, qui ne voulait pas briser une tradition de cinq siècles.
Le « célibat des prêtres » dans l’Eglise latine n’est autre qu’une manière d’être fidèle à la « Tradition remontant aux Apôtres », et acceptée tant chez les Grecs que chez les Latins jusqu’en 690, et exigeant des évêques, prêtres et diacres mariés, de renoncer, le jour de leur ordination, à l’usage du mariage. Cette tradition apostolique s’est maintenue en Occident, tandis que l’Orient grec cédait aux décisions de l’Empereur de Byzance.
Pourtant, même en Orient, subsistent des traces évidentes de l’ancienne discipline commune: les évêques n’ont pas le droit de vivre en mariage, jamais; les prêtres et les diacres, après le décès de leur épouse, n’ont pas le droit de se remarier, puisque ils ont été ordonnés. Ce qui prouve bien qu’il s’agissait d’une tolérance, Idem, pour les diacres mariés en Occident, depuis le Concile Vatican II: ils ne peuvent pas se remarier.
Cette discipline remonte aux Apôtres, dont un seul, Simon-Pierre, était certainement marié avant l’appel du Christ, mais qui répond à Jésus: « Nous qui avons tout quitté pour te suivre… ». Jésus répond: « Amen, je vous le dis: personne n’aura quitté maison, femme, frères, parents ou enfants, à cause du Royaume de Dieu, qu’il ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » (Luc 18, 28-30). Bien d’autres textes de L’Ecriture Sainte, et de la Tradition des Pères de l’Eglise, confirment cette exigence de Jésus. Exigence rappelée au 1er concile oecuménique de Nicée en 325, canon 3; et déjà avant, dans des Conciles régionaux: Elvire (Espagne) en 304 et Ancyre (=Ankara, Turquie) en 314. Il est clair que ces canons disciplinaires de l’Eglise ne faisaient que « rappeler » la Tradition remontant aux Apôtres et attestée par de nombreux Pères de l’Eglise auparavant ».
Le Père Dejond est Professeur de théologie dogmatique et formateur au Séminaire de Namur depuis 1994. JPSC
-
Mgr Dagens nous adjure de croire que l'Evangile c'est... ce qui ne marche pas
Dans un article publié par le journal « La Croix » le 8 juillet dernier, Mgr Dagens (photo), évêque d’Angoulême (et, par ailleurs, membre de l’académie française) s’inquiète de la pureté des vocations qui, contrairement au sien, « marchent » dans d’autres diocèses ou communautés religieuses (voir ici, sur le blog de l’évêque Mgr Dagens dans La Croix du 8 juillet )
Sur son « metablog », l’abbé Guillaume de Tanoüarn, membre de l’Institut du Bon Pasteur, commente la portée du propos épiscopal. Extraits :
« (…) Elle est extrêmement inquiétante dans sa perspective évangélisto-doloriste obligatoire. C'est pour le souligner que je me permets de le citer assez longuement : notre académicien explique qu'il est plus parfait pour un diocèse de ne pas avoir de séminaristes plutôt que d'en avoir :
‘Soyons plus clairs, au risque d’être quelque peu simplistes ! Il y a là deux conceptions de l’Église, et peut-être deux formes de représentation de Dieu. Ou bien l’Église est un système de pouvoirs dont il faut assurer l’efficacité, et l’on mettra l’Esprit Saint, sans le dire, au service de ces projets de rentabilité spirituelle et pastorale, en se satisfaisant des résultats obtenus et des chiffres encourageants, en comparant les riches et les pauvres, et alors malheur aux pauvres, aux diocèses sans séminaristes ! Et Dieu, dans cet ensemble très construit, devient un principe d’ordre supérieur, le promoteur suprême d'un système qui marche et qui s’impose par ses réussites visibles’.
Je continue la citation avec la deuxième conception de l'Eglise, celle à laquelle manifestement se rattache Mgr Dagens :
‘Ou bien l’Église est le Corps du Christ, toujours blessé, mais vivant, et vivant de la charité du Christ qu’elle reçoit comme un don et qu’elle manifeste en paroles et en gestes ! Et, dans ce Corps du Christ, nous, les évêques, nous apprenons à être non pas des chefs triomphants, mais des veilleurs et aussi des lutteurs, oui, des lutteurs pour que rien n’empêche la charité du Christ d’être l’âme de l’Église, dans toutes ses activités et ses missions. Et le Dieu dont nous sommes les témoins désarmés et passionnés est Celui qui ne cesse pas de se donner et d’envoyer son Fils Jésus dans le monde « non pas pour le juger, mais pour le sauver » (Jean 3,16)’.
Voici enfin le Credo mystique de l'évêque sans séminariste et fier de l'être d'ailleurs, d'autant que - disons-le tout de même - il vient - divine surprise - de "rencontrer trois jeunes hommes" qui se posent la question de la vocation :
‘Au risque d’aggraver notre cas, faut-il redire alors que nous nous référons à Jésus Christ non pas comme à une valeur à défendre, comme on défend des produits financiers, mais comme à une personne que nous n’en finissons jamais de connaître et d’aimer ? Alors « la joie de l’Évangile » n’est pas un vain mot. C’est une belle expérience et je souhaite que des hommes qui veulent aujourd’hui suivre le Christ en fondant leur vie sur Lui connaissent dès maintenant cette joie, que personne ne peut nous enlever’.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Foi, Jeunes, Société, Spiritualité 2 commentaires -
BXL : l'église Sainte-Catherine confiée à la Fraternité des Saints-Apôtres
Que le projet d'installer des prêtres disciples du Père Zanotti à l'église du Béguinage ait été écarté ne suffit par à Monsieur Laporte qui annonce avec dépit leur installation à Sainte-Catherine dans La Libre de ce jour (cfr ci-dessous); il faudrait qu'ils soient proscrits partout et sans doute serait-il préférable que cette église devienne un marché aux poissons ou aux légumes ou encore un temple de l'art contemporain. Mais voilà, notre archevêque en a décidé autrement sans se formaliser des cris d'orfraie qu'allaient pousser les Laporte et consorts. Quant à nous, nous nous réjouissons de voir rendue au culte cette église qui ne pouvait être confiée à de meilleures mains.
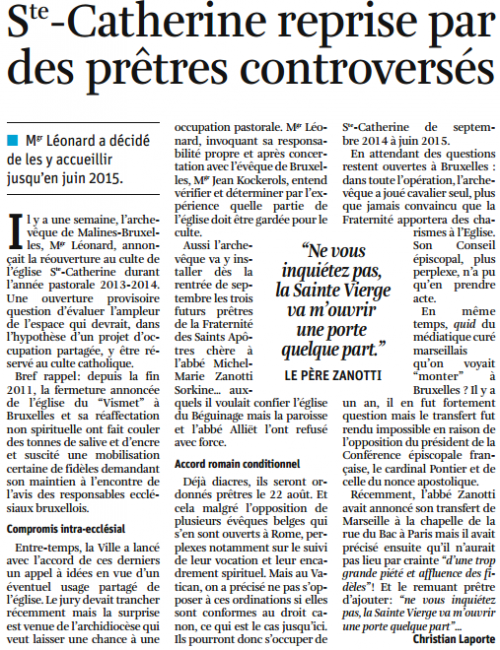
(Note de belgicatho : Mgr Pontier, archevêque de Marseille, n'est pas cardinal.)
-
Anglicans : l'ordination de femmes évêques ou quand l'égalitarisme s'érige en dogme
Une analyse de Pierre Jovanic parue sur FigaroVox :
Le synode général de l'Eglise anglicane s'est prononcé en faveur de l'ordination des femmes évêques. Pour Pierre Jovanovic, cette réforme illustre le rejet de toute tradition au nom d'un nouveau dogme, politique et non religieux : l'égalitarisme.
«Les femmes font de parfaits dentistes et médecins, pourquoi ne feraient-elles pas d'excellents prêtres?» Cette déclaration n'émane pas de Najat Vallaud Belkacem, ou de Caroline Fourest, mais de feu Margaret Thatcher, Premier ministre conservatrice du Royaume-Uni. Peu avant son départ du pouvoir en 1990, elle pesa de tout son poids pour l'ordination des femmes prêtres au sein de l'Eglise anglicane, ce qui fut chose faite quelques années plus tard. Depuis le 14 juillet 2014, conséquence de cette décision, l'accès à l'épiscopat pour les femmes a également été ouvert. Le Synode général, le Parlement de l'Eglise anglicane, composé d'une Chambre des évêques, une Chambre des prêtres et une Chambre des laïcs, réuni à York, a voté en faveur de la mesure à une très large majorité.
En novembre 2012, pourtant, lors de la dernière réunion du Synode, alors que les évêques et les prêtres y étaient acquis, les laïcs représentant les paroisses, avaient rejeté l'idée de femmes évêques. Une formidable pression politique s'était alors abattue sur l'Eglise, David Cameron déclarant que le Parlement de Westminster allait imposer ce changement de force, si le Synode ne changeait pas d'avis. En effet, l'Eglise anglicane du Royaume-Uni, dite «Eglise d'Angleterre», est une institution d'État. Vingt-six évêques siègent à la Chambre des Lords, et son primat, l'archevêque de Canterbury, est nommé par le Premier ministre, sur proposition d'une commission d'experts religieux et gouvernementaux. Alors que les autorités britanniques souhaitent promouvoir «l'égalité», le clergé anglican ne pouvait échapper à cette mise au pas. Un nouvel exemple de mainmise politique de l'Etat sur l'Eglise, qui ne rajeunit personne.
Le désir effréné d'égalitarisme, émanant de structures politiques auxquelles l'Eglise est soumise, en vient à changer la doctrine chrétienne, pour lui préférer un commandement nouveau : « ne nous soumets pas à la tradition».
Au XVIème siècle, en effet, l'Église anglicane s'est séparée de Rome tout en conservant la liturgie catholique et la hiérarchie sacerdotale, avec prêtres et évêques. Cette ambiguïté originelle la place aux carrefours des influences théologiques protestantes et catholiques. Pourtant, c'est sur la base d'arguments idéologiques, et non religieux ou spirituels, que s'est imposée la revendication du sacerdoce féminin, à partir des années 1980. L'Église a été perçue comme un corps de fonctionnaires comme un autre, qui devait offrir les mêmes chances de carrière pour tous. Le désir effréné d'égalitarisme, émanant de structures politiques auxquelles l'Eglise est soumise, en vient à changer la doctrine chrétienne, pour lui préférer un commandement nouveau: «ne nous soumets pas à la tradition».
Dans la tradition bimillénaire chrétienne catholique et orthodoxe, en effet, le prêtre est «un autre Christ»: Dieu s'est fait homme masculin. Une croyance partagée par Martin Luther, lors de la Réforme, et reprise par l'Église anglicane. La majorité des protestants croient que les ministres du culte suivent l'exemple des Apôtres hommes. Plus profondément, le christianisme enseigne l'égale dignité des sexes, et d'une même force leur différence complémentaire.
La revendication d'égalité à tout prix entraine un rejet de la tradition, et finalement, de tout dogme et de toute croyance. Les valeurs du monde deviennent les valeurs de l'Eglise
Cette vision anthropologique, qui assigne des limites aux personnes et affirme que tous les rôles dans une institution ne se valent pas, est intolérable pour l'égalitarisme dominant.
La revendication d'égalité à tout prix entraîne un rejet de la tradition, et finalement, de tout dogme et de toute croyance. Les valeurs du monde deviennent les valeurs de l'Eglise ; l'Eglise et le monde ne peuvent plus être distingués. Loin d'être une solution miracle contre le recul de la pratique religieuse, cette situation n'a jusqu'à présent pas porté chance à l'Eglise d'Angleterre: deux franges de ses fidèles, l'une de plus en plus importante, se rattachant aux courants protestants évangéliques, et l'autre historiquement proche de Rome, les «anglo-catholiques», multiplient les schismes internes.
Oscar Wilde, converti à la fin de sa vie au catholicisme, disait que «l'Eglise catholique est l'Eglise des saints et des pécheurs, tandis que l'Eglise d'Angleterre est l'Eglise des gens biens». Il critiquait la pesanteur de l'anglicanisme victorien, bourgeois et conformiste, résidant dans une conception de la décence en société. Selon cette perspective, il est décent aujourd'hui que les femmes soient prêtres et évêques. Une logique issue d'un égalitarisme niant la différence des sexes, non de la tradition religieuse.
-
Bientôt des femmes évêques dans l'Eglise anglicane d'Angleterre ?
Lu sur le site du Monde :
L'Eglise anglicane d'Angleterre autorise l'ordination de femmes évêques
Après plus de quinze ans de controverse et au terme de cinq heures de débats, l'Eglise anglicane d'Angleterre a donné son feu vert, lundi 14 juillet, en faveur de l'ordination de femmes évêques. Cette décision – votée par 152 voix pour, 12 contre, et 5 abstentions – avait été prise dès novembre 2013 et devait encore être avalisée par chaque diocèse et adoptée lors d'une assemblée nationale – appelée « synode général » – organisée à York.
La décision, qui rompt avec plusieurs siècles d'interdiction, était défendue par la plupart des responsables de l'Eglise anglicane, mais aussi le premier ministre britannique, David Cameron. Une première femme évêque pourrait être ordonnée en début d'année prochaine.
« Aujourd'hui est l'achèvement de ce qui a commencé il y a plus de vingt ans avec l'ordination des femmes comme prêtres. Je suis ravi du résultat d'aujourd'hui », a déclaré l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel des 80 millions d'Anglicans dans le monde. Il avait auparavant estimé qu'un nouveau vote « non » ne serait pas compris par l'opinion publique.
« LA TRADITION BIBLIQUE »
Bien que l'Eglise d'Angleterre compte encore 26 des 77 millions d'anglicans à travers 160 pays, elle a perdu près de la moitié de ses fidèles ces quarante dernières années. Les femmes, qui peuvent y être ordonnées prêtres depuis 1992, y représentent aujourd'hui un tiers du clergé. Leur accession à l'épiscopat est déjà autorisée dans nombre d'autres branches de l'Eglise anglicane, notamment en Australie, aux Etats-Unis, au pays de Galles, au Canada, ou encore en Afrique du Sud.
Mais pour certains fidèles anglais, ancrés dans la tradition « anglo-catholique » ou marqués, comme dans les pays du Sud, par une poussée des évangéliques, réputés plus conservateurs, cette réforme va à l'encontre de « la tradition biblique ». Pour apaiser ces opposants, la réforme prévoit que les paroisses traditionalistes ne souhaitant pas être sous l'autorité d'une femme évêque puissent demander à être dirigées par un homme.
En 2009, l'Eglise catholique a essayé de faire un geste en direction de ces conservateurs, leur proposant d'accueillir en son sein des fidèles, mais aussi des évêques et des prêtres… avec femmes et enfants. Cette main tendue aurait été saisie par quelques centaines de personnes. Le Vatican considère depuis des années que l'ordination de femmes est un « accroc à la tradition apostolique » et constitue « un obstacle à la réconciliation » entre les deux Eglises.
La réforme doit être endossée par le Parlement britannique avant de recevoir l'assentiment de la reine Elizabeth II, qui demeure, par tradition, à la tête de l'Eglise anglicane. L'anglicanisme est née d'une scission avec l'Eglise catholique au XVIe siècle, après le refus du pape d'accorder au roi Henri VIII l'annulation de son mariage.
« C'est un grand jour pour l'Eglise et pour l'égalité des droits », s'est réjoui le premier ministre, David Cameron, fervent partisan de cette avancée. La réforme devra ensuite revenir devant un synode général en novembre pour être définitivement entérinée, une étape qui s'annonce comme une formalité.
-
Encore une interview du pape François au quotidien laïc italien « La Repubblica » (mise à jour)
Lu sur le site « 20 minutes.fr » :
« Le pape François a promis des «solutions» à la question du célibat des prêtres, en soulignant que «cela prendra du temps», dans une interview publiée dimanche par le quotidien italien La Repubblica, aussitôt démentie par le Vatican.
« A la question de savoir si les prêtres catholiques pourraient être autorisés un jour à se marier, le pape a rappelé que le célibat des prêtres a été institué 900 ans après la mort de Jésus-Christ et que les prêtres peuvent se marier dans certaines Eglises orientales sous tutelle du Vatican.
«Il y a vraiment un problème, mais il n'est pas majeur. Cela prendra du temps, mais il y a des solutions et je vais les trouver», a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.
Démenti des services du Vatican
Dans l'interview, le pape a également condamné les violences sexuelles contre les enfants, qualifiées de «lèpre» dans l'Eglise, qui concerne 2% du clergé - des prêtres et «même des évêques et des cardinaux», citant les chiffres donnés par ses services.
Mais le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi a affirmé ce dimanche dans un communiqué que les citations reprises par le journal italien ne correspondaient pas à ce que le pape avait lui-même déclaré. Il n'a toutefois pas révélé quelles avaient été les véritables déclarations du pape dans cette interview: un tête-à-tête entre François et le journaliste de La Repubblica.
«Il ne s'agit pas d'une interview au sens normal du terme», a-t-il toutefois déclaré, accusant le quotidien «de manipuler des lecteurs ingénus». L'interview est la troisième d'une série accordée par le pape au fondateur du quotidien de gauche La Repubblica, Eugenio Scalfari, 90 ans, journaliste et intellectuel athée.
Après la publication de ces précédents entretiens, le Vatican avait déjà procédé à des mises au point. »
Ref. Mais le Vatican a publié un démenti…
Sous réserve de lire la traduction exacte du texte publié par ce journal de gauche: consternant d’erreurs et d’approximations. On a peine à croire que le pape François ait pu se prêter, une nouvelle fois, au jeu équivoque mené par ce journal. JPSC.
Voir également cette note de J. Smits
14/7 : "Benoît-et-moi" vient de publier la traduction de cette "interview"
-
Les jeunes hétérosexuels se montrent très ouverts face au mariage homosexuel et à l’homoparentalité
COMMUNIQUE DE PRESSE de l'UNIVERSITE de LIEGE :
Les jeunes hétérosexuels se montrent très ouverts face au mariage homosexuel et à l’homoparentalité
Une recherche internationale, dirigée par Salvatore D’Amore, psychologue, psychothérapeute et enseignant-chercheur à l’Université de Liège, livre ses premières conclusions quant au regard que portent les jeunes hétérosexuels envers les unions et les parentalités homosexuelles, et ce en Belgique, en Italie et en France. Il apparaît, via les réponses de plus de 10.000 étudiants sondés, que les jeunes générations – et particulièrement les filles – présentent des attitudes très favorables à l’égard des couples et des parents homosexuels.
LIEGE, 14 juillet 2014. Une recherche internationale, dirigée par le Pr Salvatore D’Amore (Faculté de Psychologie, Université de Liège) et le Pr Robert-Jay Green (California Schoool of Professional Psychology, Alliant University de San Francisco), vient d’analyser, durant deux ans, les attitudes face au mariage et à la parentalité homosexuels de jeunes Belges, Français et Italiens âgés de 18 à 25 ans, s’auto-déclarant hétérosexuels. Il s’agit de la première étude transationale, au niveau européen, portant sur ce sujet précis.
L’enquête en ligne a été menée auprès de plus de 10.700 étudiants universitaires, provenant de ces trois pays : 4621 en Belgique, 2263 en France et 3825 en Italie. L’objectif était de comprendre les facteurs qui s’associent aux attitudes favorables ou défavorables envers l’homosexualité, le mariage homosexuel et l’homoparentalité: genre, traditionalisme lié aux rôles homme/femme, religiosité, appartenance politique et degré de contact avec les personnes, les couples et les parents homosexuels.
Les données quantitatives ont été analysées et révèlent plusieurs enseignements :- Plus de 75 % des filles et des garçons en Belgique, France et Italie soutiennent le mariage homosexuel.
- Environ 75 % des filles en Belgique, France et Italie soutiennent la parentalité dans les couples gays et lesbiens, pour 55 à 68 % des hommes.
- Les filles belges défendent davantage les droits au mariage homosexuels que leurs conseurs en Italie. Sur ce sujet, les résultats du côté des garçons étaient très semblables dans les trois pays.
- Les analyses menées dans les trois pays montrent des variables similaires en fonction de trois facteurs :
- le conservatisme politique et réligieux est corrélé avec un faible soutien envers le mariage et la parentalité homosexuels,
- le soutien envers le mariage entre personnes du même sexe et le soutien envers l’homoparentalité vont très souvent de pair,
- les filles des trois pays se montrent, de manière générale, plus favorables que les garçons envers l’homosexualité et l’homoparentalité.
- De façon générale, un grand sentiment religieux et des idées traditionnelles à propos des rôles selon le genre (« les femmes devraient être davantage tournées vers leur famille », « les hommes devraient se montrer dominants et puissants ») sont associés à des attitudes défavorables face à l’homosexualité en général, au mariage et à la parentalité homosexuels.
- Une grande satisfaction dans les relations sociales avec des personnes gays et lesbiennes est associée à des attitudes plus positives par rapport à l’homosexualité et l’homoparentalité.
- La qualité des relations sociales avec des personnes gays et lesbiennes joue un rôle plus grand dans l’attitude positive face à l’homosexualité et l’homoparentalité que la quantité de ces mêmes relations.
« Cette recherche est importante pour appréhender les attitudes qui existent dans différents pays et également pour comprendre les causes de résistance et de rejet par rapport au mariage gay et lesbien et aux droits parentaux des homosexuels. Le poids de la religion, les stéréotypes liés au genre et la reconnaissance ou non des droits civiques, selon les pays, influencent l’attitude » souligne Salvatore D’Amore.
« Selon moi, poursuit-il, la forte acceptation dont font preuve les étudiants sondés suggère que les stigmates sociaux et les préjugés historiques relatifs à l’homosexualité ont tendance à grandement diminuer dans ces pays. J’y vois des signes d’espoir, avec des générations futures plus ouvertes, et un message important pour la société et la justice ».
« Bien plus, les résultats de cette enquête font penser que la tendance positive va augmenter puisque ces jeunes personnes, actuellement aux études, sont vouées à devenir, dans le futur, des leaders et décideurs sociaux et politiques, à la fois dans leurs pays respectifs et à l’échelle de l’Union européenne ».
Cette première enquête transnationale s’inscrit dans une étude plus vaste, à laquelle ont participé environ 18.000 étudiants, dans sept pays européens (Belgique, France, Italie, Grèce, Portugal, Pologne et Espagne). Des données similaires sont par ailleurs collectées également en Turquie et en Afrique du Sud. D’autres résultats viendront donc compléter cette analyse, qui fera l’objet d’une publication internationale.Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Ethique, Famille, Jeunes, Sexualité, Société 3 commentaires -
Et si l'Eglise se modernisait ?
Ce matin, c'était l'Eglise qui était à l'ordre du jour de l'émission Connexions de la RTBF (Matin première). Avec cette question : l'Eglise pourrait-elle se "moderniser" en acceptant le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, l'homosexualité, l'avortement, le divorce... Un ami a pris part à ce débat; voici le texte de son intervention :L’Eglise doit surtout continuer à faire ce pour quoi elle existe : annoncer l’évangile et les sacrements. Pour le reste, pour reprendre les mots du très estimé père Guy Gilbert, personne ne s’attend à ce que l’Eglise dise « hommes, femmes, homos, ou prêtres, mariez-vous les uns les autres, baisez comme des castors, mais n’oubliez pas la capote ». Ça n’aurait bien-sûr aucun intérêt et il est rassurant qu’il existe dans le monde une institution prête à remettre en question nos certitudes, quitte à endurer pour cela les pires quolibets.
Pour le reste, l’Eglise doit assurément être autant que possible ouverte à la modernité, mais il faudrait déjà se mettre d’accord sur ce qu’on entend par modernité.
Prenons l’avortement par exemple. La question centrale, c’est de savoir si on élimine un être humain ou pas. Si comme moi on pense que oui, on ne peut que dire que le progrès social serait la protection de la vie et une abrogation de la dépénalisation de l’avortement, et dans ce cas c’est l’église qui est progressiste.
Sur le divorce et le mariage homosexuel, avoir une institution qui parie toujours sur la famille traditionnelle en 2014, et bien je trouve ça plutôt bien et rafraîchissant.
Et quand bien-même la modernité de l’Eglise catholique dépendrait de ces questions sociétales, rappelons que l’Eglise anglicane permet le divorce, l’ordination de femmes et d’hommes mariés, et n’a pas résolu ses problèmes de vocation et de modernité pour autant, loin de là. Au contraire, ces deux crises se sont accentuées.
-
L'ordination de femmes évêques au menu du synode de l'Eglise anglicane d'Angleterre
Lu sur Radio Vatican :
Le synode de l’Eglise d’Angleterre s'est ouvert ce vendredi et se tiendra pendant cinq jours à York. Il promet d’être historique, car lundi un vote sur l’ordination des femmes évêques sera de nouveau organisé. Après avoir été rejetée en 2012, à une majorité de six voix seulement, la motion devrait être approuvée. Même l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, s’est prononcé en faveur de cette ordination.
Mais, rassurez-vous, cela ne risque ni de provoquer un schisme au sein de la communion anglicane ni de compliquer le dialogue avec l'Eglise catholique :
Christelle Pire a interrogé Rémy Bethmont, professeur d’histoire et civilisation britanniques à Paris VIII, en Seine-Saint-Denis, sur les conséquences d’un tel changement. Il écarte le risque d’un schisme interne à la communion et ne pense pas que le résultat du vote aura un impact négatif sur les rapports entre les anglicans et les catholiques. (audio sur Radio Vatican)