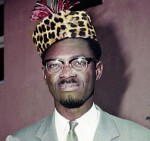 « La Libre » reprenant un communiqué de Belga et de l’AFP titre ce jour que la justice belge va enquêter sur la mort de Patrice Lumumba :
« La Libre » reprenant un communiqué de Belga et de l’AFP titre ce jour que la justice belge va enquêter sur la mort de Patrice Lumumba :
« Avant que le parquet fédéral ne puisse ouvrir une enquête, on devait déterminer si les juridictions belges étaient compétentes.
Le parquet fédéral peut ouvrir une enquête judiciaire sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba en 1961. Cette décision a été rendue par la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Selon celle-ci, l'ancienne colonie belge était à cette époque confrontée à un conflit armé et l'assassinat de l'ancien Premier ministre du Congo pourrait constituer un crime de guerre. Des fils de feu Patrice Lumumba ont porté plainte au parquet fédéral en Belgique avec constitution de partie civile, contre une douzaine de survivants, des policiers, des politiciens et des fonctionnaires. Parmi ceux-ci, seulement huit vivent encore. L'un d'eux serait Jacques Brassinne, diplomate belge au Katanga en 1961. Les autres noms qui apparaissent sont ceux d'Etienne Davignon, alors jeune diplomate, et Charles Huyghé, à l'époque chef de cabinet du ministre de la Défense katangais.
Avant que le parquet fédéral ne puisse ouvrir une enquête, on devait déterminer si les juridictions belges étaient compétentes. S'estimant compétent, le parquet fédéral s'est basé sur la loi de la compétence universelle de 1993, qui autorise la justice belge à engager des poursuites dans le cadre de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide commis hors du territoire belge. Les plaignants ou les prévenus doivent toutefois avoir un lien avec la Belgique, ce qui est le cas ici.
La chambre des mises a donné raison au parquet fédéral et a jugé que l'assassinat de Lumumba pourrait être un crime de guerre et qu'une enquête pouvait être menée dès lors en Belgique.
Les faits
Lumumba fut le premier chef du gouvernement du Congo-Kinshasa, aujourd'hui République Démocratique du Congo, et, au-delà, de juin à septembre 1960. Le 30 juin 1960, jour de l'indépendance du Congo, il avait prononcé devant le roi Baudouin un discours virulent dénonçant les abus de la colonisation, marquant sa rupture avec l'ancienne métropole.
Après la prise du pouvoir par Joseph-Désiré Mobutu, Lumumba fut assassiné le 17 janvier 1961 par des responsables du Katanga (sud-est), région minière qui fit un temps sécession avec le soutien de la Belgique. Les forces de sécurité belges ont été accusées d'avoir à tout le moins couvert l'opération, voire de l'avoir commanditée ou coordonnée.
Une commission d'enquête parlementaire belge de 2001 avait conclu à la "responsabilité morale" de la Belgique. Le gouvernement avait alors présenté les excuses de la Belgique au Congo.
"Il faut aller plus loin que la reconnaissance d'une responsabilité morale. Il faut tirer de l'établissement des faits toutes les conclusions, d'ordre pénal et juridique", avait déclaré lors du dépôt de la plainte François Lumumba, l'un des fils de Patrice Lumumba. »
La plus grande des responsabilités n’est-elle pas portée par le gouvernement et la classe politique belges qui ont jeté l’indépendance aux Congolais dans l’impréparation la plus totale, comme on jette des chiots à l’eau sans leur apprendre à nager :mais voilà, les Congolais ne sont pas des chiens. Et placer à leur tête un personnage excessif, aussi instable et inexpérimenté que Lumumba, alors même que rien n’y obligeait, pas même le résultat des élections législatives congolaises de mai 1960, ne pouvait qu’aboutir au désastre, dans les jours mêmes qui ont suivi la passation des pouvoirs, le 30 juin de la même année : un effondrement total, dont le Congo ne s’est pas encore remis un demi-siècle plus tard, mais que le premier ministre belge d'alors qualifiait de « petites convulsions » d’un nouveau-né. Qui listera le nombre des victimes (quelle que soit la couleur de leur peau) de l’aveuglement, de la légèreté ou des faux calculs du personnel politique belge de l’époque : les Gaston Eyskens, Maurice Van Hemelrijck, Auguste De Schrijver et autres Walter Ganshof van der Meersch ? Cinquante ans après, peut-être faut-il laisser les morts enterrer les morts plutôt que d'avoir la prétention d'en déterrer un, qui n'était peut-être pas le plus innocent des agneaux égorgés.
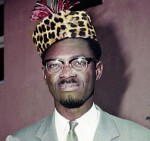 « La Libre » reprenant un communiqué de Belga et de l’AFP titre ce jour que la justice belge va enquêter sur la mort de Patrice Lumumba :
« La Libre » reprenant un communiqué de Belga et de l’AFP titre ce jour que la justice belge va enquêter sur la mort de Patrice Lumumba : Les baroqueux, avec leur souci de restitution « authentique » ont introduit la controverse au sein du monde de la musique et des interprètes du chant choral ancien. Le site du magazine « Muse baroque » consacre un article à cette question :
Les baroqueux, avec leur souci de restitution « authentique » ont introduit la controverse au sein du monde de la musique et des interprètes du chant choral ancien. Le site du magazine « Muse baroque » consacre un article à cette question : Du Père Abbé de l’abbaye bénédictine de Triors, Dom Hervé Courau, aujourd’hui dans son homélie pour la fête de l’Immaculée Conception :
Du Père Abbé de l’abbaye bénédictine de Triors, Dom Hervé Courau, aujourd’hui dans son homélie pour la fête de l’Immaculée Conception :