De Solène Tadié sur le National Catholic Register :
Exorciste depuis longtemps : Le satanisme se développe dans les sociétés occidentales
Le père François-Marie Dermine, promoteur d'un cours international annuel sur l'exorcisme à Rome, parle de son récent travail populaire sur le diable, offrant des clés de discernement sur ce sujet controversé et sensible.
4 décembre 2020
La "mort" du diable dans l'esprit des gens accélère la "mort" de Dieu dans les sociétés occidentales déchristianisées. C'est pourquoi le père dominicain François-Marie Dermine a décidé, il y a 20 ans, de recatéchiser les catholiques par différentes initiatives.
Canadien de naissance, le père Dermine est exorciste pour plusieurs diocèses italiens depuis 1994. En 2003, il a contribué à la création du "Cours sur l'exorcisme et la prière de libération", un atelier interdisciplinaire d'une semaine sur l'exorcisme. Cet événement annuel, qui se tient à Rome, rassemble des prêtres, des femmes religieuses et des experts laïcs du monde entier pour se pencher sur l'activité satanique et le ministère officiel que l'Église a mis en place pour répondre à cette activité.
Le père Dermine est président de l'association catholique italienne GRIS (Groupe de recherche d'informations socio-religieuses) et professeur de théologie morale à la faculté de théologie d'Émilie-Romagne ; il est également l'auteur de plusieurs livres sur le ministère de l'exorcisme et les dangers entourant les croyances et pratiques obscures et dangereuses de l'occultisme.
Son dernier ouvrage, Ragioniamo sul demonio. Tra superstizioni, mito e realtà ("Raisonnons sur le diable : entre superstitions, mythes et réalité"), a été écrit sous forme de questions-réponses et vise à informer le public - croyants et non-croyants - sur la nature et la portée de l'activité satanique à une époque où l'existence même du diable est de plus en plus remise en question, même par les dirigeants catholiques.
En discutant du contenu de son livre avec le Register, le père Dermine a mis en garde les fidèles catholiques contre le fait de négliger l'éducation religieuse, qui est le premier rempart contre l'avancée du diable et du satanisme dans la société.
Pourquoi avez-vous écrit ce livre, qui s'adresse à un large public ?
Tout d'abord, je l'ai écrit parce qu'il y a beaucoup de préjugés, d'ignorance et de confusions à traiter. En effet, je suis un exorciste, et cela me fait vraiment mal d'entendre les gens en général et les prêtres en particulier nier l'action concrète du diable dans nos vies. Je ne pouvais plus supporter cette situation. C'est la raison fondamentale pour laquelle j'ai écrit ce livre. La foi privée de la croyance en l'existence du diable n'est pas authentique car l'existence des anges est une vérité de foi, et le diable est un ange déchu. De ce point de vue, je suis très clair. Quiconque nie l'existence du diable est un hérétique. Il est évident que le diable n'est pas au centre de la foi, mais sa figure est indispensable pour comprendre le mystère de la foi.
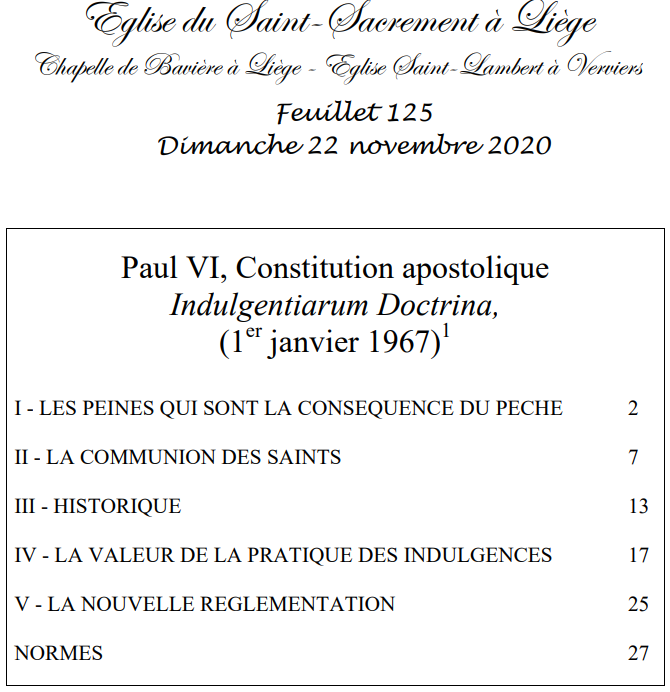



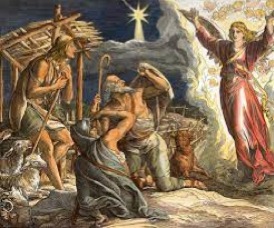

 « Clin d’œil du ciel, c’est en la fête de saint Jean-Paul II que Mgr Olivier de Germay est nommé archevêque de Lyon. Il faut dire qu’il a passé une bonne partie de sa formation à Rome, au séminaire français et aussi à l’Institut pontifical Jean-Paul II. Cette nomination très attendue – et longtemps différée – n’est pas du tout anecdotique. « J’ai hurlé de joie en l’apprenant, avoue un confrère. Il est représentatif d’une Église qui va de l’avant, attachée à la nouvelle évangélisation. » Un autre évêque salue : « la nomination d’un évêque qui a du cran et des positions affirmées sur les questions bioéthiques ou le Mariage pour tous est très symbolique. Nommer un évêque de 60 ans à Lyon, c’est poser un acte fort. » Il précise ensuite : « Je trouve intéressant que ce ne soit pas un Parisien. Il peut apporter sa liberté de point de vue. »
« Clin d’œil du ciel, c’est en la fête de saint Jean-Paul II que Mgr Olivier de Germay est nommé archevêque de Lyon. Il faut dire qu’il a passé une bonne partie de sa formation à Rome, au séminaire français et aussi à l’Institut pontifical Jean-Paul II. Cette nomination très attendue – et longtemps différée – n’est pas du tout anecdotique. « J’ai hurlé de joie en l’apprenant, avoue un confrère. Il est représentatif d’une Église qui va de l’avant, attachée à la nouvelle évangélisation. » Un autre évêque salue : « la nomination d’un évêque qui a du cran et des positions affirmées sur les questions bioéthiques ou le Mariage pour tous est très symbolique. Nommer un évêque de 60 ans à Lyon, c’est poser un acte fort. » Il précise ensuite : « Je trouve intéressant que ce ne soit pas un Parisien. Il peut apporter sa liberté de point de vue. »