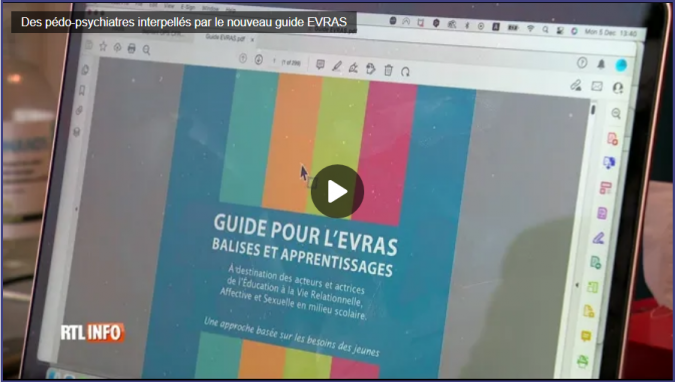Une lettre ouverte cosignée par 2500 personnes publiée sur le site de cathobel.be :
OPINION: « Non à l’hypersexualisation de nos enfants au nom d’un soi-disant progressisme ! »
Très inquiets concernant le contenu du nouveau guide EVRAS, pour l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, des spécialistes de l’enfance et de nombreux parents cosignent une lettre ouverte, rassemblant plus de 2500 signatures.
Parmi les co-signataires de la lettre, des pédopsychiatres, inquiets de certaines positions défendues dans le nouveau guide EVRAS. Mais aussi sur leur temporalité. Doit-on aborder certaines questions liées à la sexualité dès l’âge de 5 ans? Leur grande inquiétude concerne notamment le principe d’autodétermination. Peut-on dire à un enfant de 8 ans qu’il a le droit de choisir son genre? S’ils ne rejettent pas l’ensemble du guide, les spécialistes émettent donc de sérieuses réserves.
Lire aussi: Edito – Oui à l’EVRAS. Mais pas à celle-là ! et Doit-on s’inquiéter de la future éducation affective et sexuelle de nos enfants à l’école?
« Lettre ouverte » adressée aux parents et à Madame la Ministre de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir
Protégeons nos enfants qui, dès 5 ans, se verront bientôt « éduqués » dans les balises du nouveau guide Evras.
En tant que professionnels de la santé mentale des enfants et des adolescents, nous avons pris connaissance du «Guide pour l’EVRAS, Balises et apprentissages (1) – A destination des acteurs et actrices de l’éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle en milieu scolaire. Une approche basée sur les besoins des jeunes » (2).
Interpellés par certaines positions défendues par ce guide, nous avons proposé une rencontre, fin novembre 2022, avec Madame la Ministre de l’Education. Il n’y a pas été donné suite. Voici pourquoi nous recourons à cette « Lettre ouverte » afin de pouvoir espérer nous faire entendre, nous, les professionnels inquiets pour les enfants et adolescents qui risquent d’être soumis à cette éducation.
Nous dédions notre lettre à tous les parents, eux qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, en particulier en matière d’affectivité et de sexualité.
Un référentiel obligatoire
Depuis le 12 juillet 2012, l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (Evras) fait partie des missions de l’enseignement obligatoire et doit donc être intégrée au programme tout au long de la scolarité. Afin de coordonner sa mise en œuvre, la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ont conclu un protocole d’accord en juin 2013.
Un nouveau protocole d’accord est attendu pour fin 2022 avec comme objectif de labelliser les seuls et uniques acteurs ‘Evras’ qui devront utiliser ce nouveau guide comme référentiel obligatoire. Jusqu’à ce jour, la liberté est certes encore laissée aux pouvoirs organisateurs et aux directions d’écoles d’organiser l’Evras de la manière qu’ils pensent être la plus adéquate. Mais une « Commission Education » au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles se tiendra le 13 décembre prochain pour discuter notamment de cette liberté.
«Se sentir libre d’envoyer des sextos et/ou des nudes dans le consentement» (3) (dès 9 ans) Ce recueil de 303 pages est divisé en plusieurs thématiques, (relations interpersonnelles, identité de genre, expressions de genre et orientations sexuelles, les violences, …), déclinées à chaque fois en tranches d’âge. Il se veut « inclusif » et « non-hétéronormatif». Les auteurs refusent, en d’autres mots, le : « Principe de considérer le fait d’être hétérosexuel comme étant la norme, allant de soi, comme la référence par défaut et de marginaliser tout ce qui en sort (4)». Il comprend des pistes pédagogiques pour aborder ces questions avec les élèves.
Dans la thématique : « Identité de genre, expressions de genre et orientations sexuelles», dès 5 ans :
« Prendre conscience que son identité de genre peut être identique ou différente, se rapprocher, s’éloigner, correspondre, ne pas correspondre, différer, osciller, … de celle assignée à la naissance (5)».
Toujours dès 5 ans : « Consolider sa propre identité de genre » et « Identifier et exprimer son identité de genre (6) ».
Dès 9 ans, il est proposé de : « Se sentir libre de questionner les normes et stéréotypes de genre pour trouver son point de confort ». « Il s’agit de l’ensemble des éléments pouvant être mis en place par une personne transgenre afin de favoriser le sentiment de bien-être par rapport à sa propre identité de genre : adopter une démarche différente (ou pas), changer sa façon de s’habiller (ou pas), prendre des hormones (ou pas), recourir à des opérations chirurgicales (ou pas)… ». Dès 9 ans : « Se questionner sur son identité de genre (7)».
N’encombrons pas le psychisme de l’enfant avec un référentiel sexuel adulte
Nous ne rejetons certainement pas l’ensemble du guide. Il accompagne les élèves dans des questions importantes et promeut la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles, notamment via les réseaux sociaux, des combats que nous soutenons dans notre pratique. Cependant, de nombreux choix et positions nous inquiètent dans la mesure où ils risqueraient d’amener des préoccupations troublantes voire traumatiques chez les enfants.
L’autodétermination de l’enfant s’avère être une des clés de voûte soutenant la rédaction de ce guide. Littéralement, cela signifierait que, ipso facto, l’enfant saurait, mieux que personne, ce qui est bon pour lui. Son propre ressenti serait son seul guide. N’oublions pas qu’un enfant a, surtout, le droit d’être éduqué. Il a bel et bien le droit à de la transmission, tout comme il a le droit au respect des étapes de son développement.
Force est de constater qu’entre autres choses, ce module éducatif supprime la période dite de latence : à savoir cette période bien connue du développement de l’enfant, essentiellement axée sur la construction de sa socialisation et d’une compréhension plus large du monde. Travail psychique rendu possible lorsque l’enfant n’est précisément pas stimulé sexuellement, sachant qu’entre 6 et 11 ans, en moyenne, ses questionnements sur la sexualité sont alors partiellement refoulés.
Ce refoulement a une fonction capitale malheureusement de plus en plus souvent réduite à cause de l’hypersexualisation (8), tous azimuts, de notre société. Il est donc plus que jamais indispensable de respecter les étapes du développement psychique d’un enfant.
Notre société, notamment via les réseaux sociaux, impose un questionnement sur le quoi et le comment de la sexualité des enfants et des adolescents. Il serait donc utile que ce guide, au lieu d’imposer une compréhension «technique » des différents aspects de la sexualité, soutienne et protège les enfants contre une confrontation à des thématiques pour lesquelles ils ne sont pas prêts.
Car les jeunes sont aujourd’hui victimes d’une espèce d’acharnement tant la société impose ses questions, ses affirmations et insiste lourdement sur le devoir d’absolument tout expérimenter. Ces diktats sont des intrusions psychiques, source de souffrances inutiles.
Nous entendons dans les écoles secondaires, mais aussi dans nos cabinets, l’insistance avec laquelle les jeunes exercent ouvertement des pressions entre eux pour aller toujours plus loin dans l’exploration de la sexualité considérée comme un divertissement au même titre qu’un jeu ou un sport.
En conclusion, souvenons-nous que l’enfant n’est pas un adulte en miniature. Il convient donc de toujours bien faire la distinction entre l’enfant qui est sexué, l’émergence de la sexualité juvénile, et enfin la sexualité adulte. Cette distinction peine à se faire sentir tout au long du guide. Que les enfants apprennent la sexualité selon un rythme adéquat, voilà qui est souhaitable, mais ils n’ont pas à y être exposés de force.
Une vision idéologique : Parents, réveillez-vous !
Qu’en est-il in fine de l’autorisation que vous accordez, vous parents, à ce que ces thématiques si délicates soient abordées avec vos enfants de façon aussi technique où si peu de place est faite aux sentiments, aux émotions ou tout simplement à l’amour ? Le guide ne propose pas quelques balises, comme il le prétend ; il défend une vision idéologique de l’éducation sexuelle et affective, où chaque enfant jongle avec son genre et sa sexualité, selon son bon désir, pour peu qu’il y ait consentement mutuel entre partenaires (à partir de 9 ans…). Aucune place n’est laissée aux autres sensibilités sur ces sujets, aux valeurs familiales et culturelles et à leur transmission.
Ce que nous réclamons d’urgence
Rien moins qu’un moratoire sur l’imposition de ce tout nouveau guide Evras, le tout dans un esprit constructif et afin de le retravailler, cette fois-ci tous ensemble, et de manière réellement démocratique, en veillant notamment à inclure les parents ou autres gardiens, et pas seulement les enfants et les associations censées les représenter.
Premiers signataires :
Sophie Dechêne, MRCPsych, Pédopsychiatre
Diane Drory, Psychologue-Psychanalyste
Serge Dupont, Docteur en Psychologie
Nicole Einaudi, Pédopsychiatre
Catherine Jongen, Thérapeute de couple, Sexothérapeute
Beryl Koener, Pédopsychiatre, Docteur en Neuropsychopharmacologie
Jean-Pierre Lebrun, Psychiatre, Psychanalyste
Muriel Meynckens-Fourez, Pédopsychiatre
Consulter la liste complète des signataires
Les co-signataires invitent à rejoindre leur appel en signant la lettre via le lien suivant :
https://forms.gle/TdHra44hUg7J8eNc7
*******
Références
1.https://drive.google.com/u/0/uc?id=1vFmKgGq0yPCLJS6VV52wbAorWMMVg8rp&export=download
- L’éditeur responsable est l’ASBL O’Yes, ‘Safe, Sex and Fun’, producteur de la chaîne « Moules frites » et la Fédération Laïque de Centres de Planning familial. La « Déclaration des droits sexuels » de l’IPPF (Fédération Internationale des Plannings Familiaux) (2008) et la publication des « Standards européens d’éducation à la sexualité » (2010) sous l’égide de l’OMS élaborés par divers lobbies, sont à l’origine du déploiement par nos décideurs politiques wallons d’une nouvelle forme d’ «éducation à la sexualité » destinée aux mineurs à partir de la maternelle.
- P.191
- P.25
- P.160
- P.161
- P.163
- « On sait bien qu’on pourrait bloquer l’accès à beaucoup de sites pornographiques en exigeant un paiement par carte… mais personne ne se décide à le faire » M. Berger, Les Dangers de l’éducation à la sexualité pour les enfants et les adolescents p.17. Au lieu de cette mesure, les Standards européens ont comme but « de leur apprendre à composer avec le sexe dans les médias »…