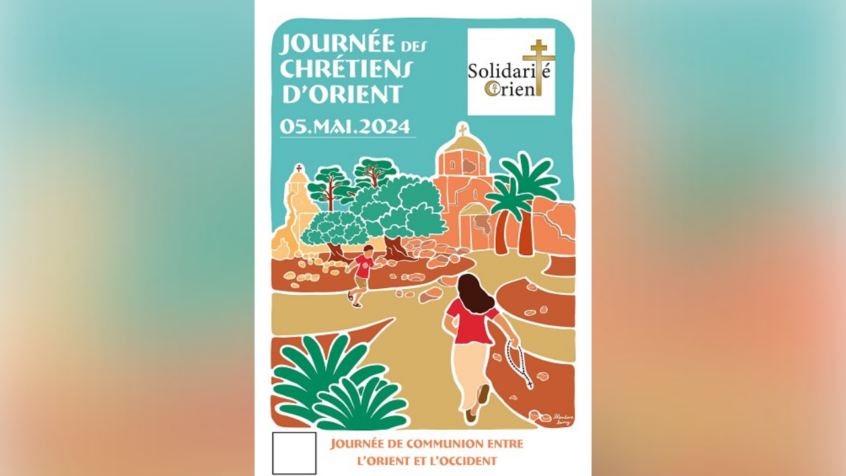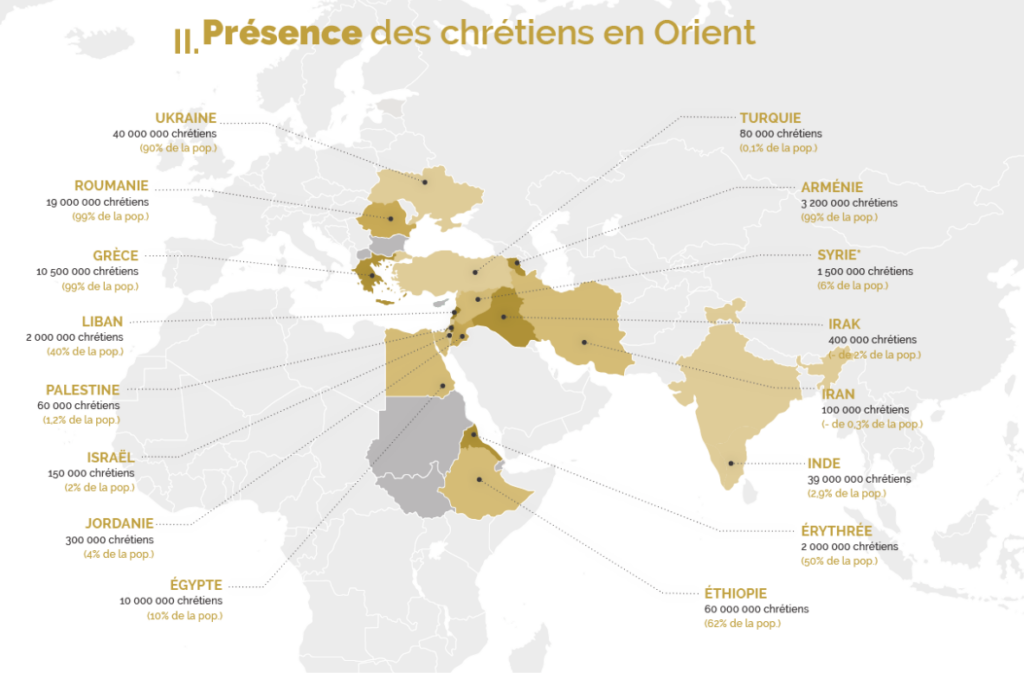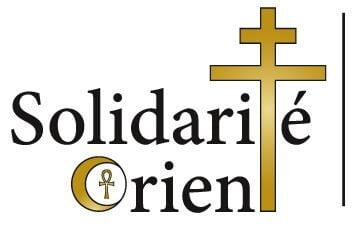De John L. Allen Jr. sur Crux Now :
Le régime hostile du Congo pourrait être le directeur de campagne idéal du candidat papal
5 mai 2024
ROME - Autrefois, les monarques et les empereurs qui gouvernaient les grandes puissances catholiques de l'époque revendiquaient ce qu'ils appelaient de manière plutôt fantaisiste un jus exclusivae, ou « droit d'exclusion », lors des élections papales, c'est-à-dire le pouvoir d'exercer un veto sur un candidat particulier.
La dernière fois que ce droit d'exclusion a été invoqué, c'était en 1903, lorsque l'empereur François-Joseph d'Autriche s'est opposé au choix éventuel du cardinal Mariano Rampolla, que les Autrichiens considéraient comme excessivement pro-français. En conséquence, le cardinal Giuseppe Sarto de Venise a été élu à la place comme pape Pie X, et l'un de ses premiers actes a été de publier le Commissum nobis le 20 janvier 1904, abolissant de fait le veto impérial.
Il est ironique de constater qu'aujourd'hui, le jus exclusivae continue d'exister, mais avec l'effet inverse : La perception des efforts déployés par les puissances séculières pour bloquer la carrière d'un ecclésiastique donné favorise sans doute ses perspectives papales au lieu de les retarder.
La République démocratique du Congo nous le rappelle en ce moment : une nouvelle enquête judiciaire sur le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa, accusé de sédition et de fomenter la désobéissance au sein des forces armées du pays, semble être une tentative plutôt transparente d'intimider et de museler le prélat de 64 ans, qui est souvent une épine dans le pied du gouvernement congolais.
En effet, le régime du président Félix Tshisekedi pourrait faire une énorme faveur à Ambongo en renforçant sa célébrité mondiale, en le transformant potentiellement en martyr et en cause célèbre. Si tel est le cas, ce serait un résultat particulièrement ironique pour Tshisekedi, dont le grand-oncle a été évêque catholique au Congo pendant 28 ans.
Malgré ce pedigree, les relations de Tshisekedi avec les hiérarques catholiques actuels du pays, en particulier Ambongo, n'ont jamais été étroites. D'une part, Tshisekedi s'est éloigné de ses racines catholiques, pratiquant son culte dans une méga-église pentecôtiste appelée le Centre missionnaire Philadelphie et s'entourant d'un groupe de pasteurs-conseillers pentecôtistes et évangéliques.
Plus fondamentalement, Ambongo et ses confrères évêques ont constamment critiqué Tshisekedi pour des raisons de justice sociale, reprochant au gouvernement de prétendues déficiences démocratiques, de ne pas s'être attaqué à une situation sécuritaire désastreuse dans l'est du Congo, du rôle des intérêts miniers multinationaux dans les affaires nationales, et d'une foule d'autres questions.
Il faut dire qu'en agissant ainsi, Ambongo perpétue une grande tradition africaine et congolaise. Dans de nombreuses nations africaines, où la société civile est sous-développée et l'opposition politique étouffée, les églises sont souvent la seule sphère de vie où une vision véritablement alternative peut être articulée. En conséquence, les chefs religieux jouent souvent un rôle directement politique qui, selon les normes occidentales de séparation de l'Église et de l'État, peut sembler excessif.
Pour prendre un exemple classique, le prédécesseur d'Ambongo à Kinshasa, feu le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, a été président d'un « Haut Conseil de la République » transitoire après la fin du régime de Mobutu Sese Seko, faisant de Monsengwo le chef d'État de facto du pays. Plus tard, il a également été président transitoire du parlement national en 1994.
Ce qui rend tout cela pertinent pour les élections papales, c'est qu'Ambongo a récemment émergé comme un nouveau papabile, ou candidat à devenir pape, principalement en raison de sa gestion habile de la résistance africaine à la Fiducia Supplicans, le document hyper-controversé du Vatican autorisant la bénédiction des couples dans les unions de même sexe.
En tant que président élu de la Conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar (SECAM), M. Ambongo a conduit ses collègues prélats africains à rédiger une déclaration commune déclarant que la Fiducie restait lettre morte sur le continent. Il a pourtant publié cette déclaration avec la bénédiction du pape François et en coordination avec le cardinal Victor Manuel Fernandez, chef du Dicastère pour la doctrine de la foi et principal auteur de Fiducia, gagnant ainsi le respect des détracteurs du document et des partisans du pape.
Après avoir fait tourner les têtes sur une question ad intra, c'est-à-dire une question relative à la vie interne de l'Église, le rôle ad extra d'Ambongo est maintenant sous les feux de la rampe grâce aux efforts du gouvernement congolais pour l'intimider et l'obliger à se taire.
En mars, le Congo a annoncé qu'il levait l'interdiction de la peine de mort, en vigueur depuis deux décennies, et qu'il rétablissait la peine capitale pour les cas de trahison et d'espionnage. Si personne ne s'attend sérieusement à ce que les procureurs cherchent à mettre Ambongo à mort, les accusations de sédition dans un pays confronté à une rébellion armée ne sont pas une plaisanterie, et il est difficile de prédire à ce stade la gravité de la menace qui pèse sur Ambongo.
Si l'enquête devait déboucher sur des accusations ou d'autres mesures juridiques, l'une des conséquences prévisibles serait de faire du sort d'Ambongo une question d'intérêt catholique mondial, ce qui rehausserait considérablement son profil.
En termes de politique papale, non seulement cela donnerait à Ambongo une plus grande reconnaissance de son nom, mais cela mettrait également en lumière les aspects de son CV susceptibles de trouver un écho auprès des électeurs de la « continuité », c'est-à-dire les cardinaux désireux de poursuivre l'agenda du pape François. Son rôle au sein de la Fiducia a été bien accueilli par les conservateurs, mais ses conflits avec le gouvernement congolais reposent en grande partie sur les motifs classiques du pape François.
Lors de sa visite dans le pays en janvier 2023, le souverain pontife a dénoncé le colonialisme économique, insistant notamment sur le fait qu'il ne fallait pas toucher à la République démocratique du Congo ni à l'Afrique. Ce n'est pas une mine à exploiter, ni un terrain à piller ».
Aujourd'hui, Ambongo confirme ce message, au prix de certains risques personnels, d'une manière que les partisans de François ne peuvent s'empêcher d'admirer.
En d'autres termes, en tentant d'étouffer Ambongo, le régime congolais pourrait par inadvertance se révéler être le meilleur directeur de campagne qu'un papabile puisse jamais avoir - qu'il le veuille ou non.