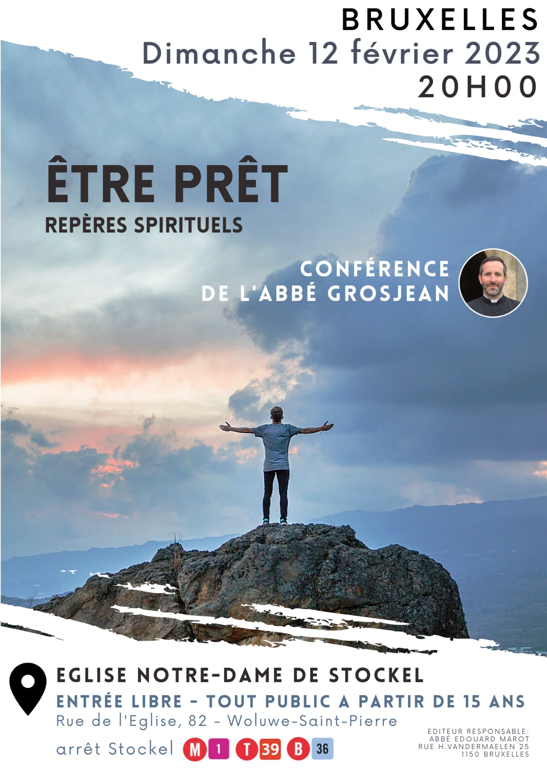De Courtney Mares sur Catholic News Agency :
Les catholiques européens débattent du résultat final de l'assemblée du Synode sur la synodalité à Prague
9 février 2023
Les catholiques européens ont débattu jeudi matin du contenu d'un document final qui influencera les discussions du Synode des évêques au Vatican à l'automne.
Lors de la dernière journée de discours publics à Prague le 9 février, il a été demandé aux 200 délégués de l'Assemblée continentale européenne si le document final de l'assemblée - rédigé par un comité de six membres - était fidèle à ce qui avait été discuté lors des trois jours précédents de l'assemblée.
L'évêque ukrainien Oleksandr Yazlovetskiy, évêque auxiliaire latin de Kiev, a été l'un des premiers à prendre la parole, soulevant une objection à l'utilisation répétée du terme LGBTQ sur "une page sur deux" dans le document, suggérant plutôt qu'il serait préférable de couvrir le sujet dans un seul paragraphe.
L'archevêque Stanisław Gądecki s'est opposé à l'utilisation de l'expression "conservateur et libéral" pour décrire l'Église, suggérant plutôt de préciser si certaines déclarations sont en accord ou en désaccord avec l'Évangile. Le prélat polonais a ajouté que le document ne communique pas la position de l'Eglise dans ses références aux personnes "LGBT".
L'évêque Georg Bätzing, président de la conférence épiscopale allemande, a déclaré que l'Église ne se trouve pas encore dans une "nouvelle Pentecôte" comme le prétend le document.
L'archevêque Felix Gmür de Bâle, en Suisse, a noté que certaines parties du texte semblaient "trop vagues" et pourraient être plus claires, notamment en soulignant les points de tension.
S'exprimant en français, allemand, italien, polonais et anglais, les délégués ont fait des suggestions sur la façon dont le texte pourrait être amélioré.
L'évêque Brian McGee a déclaré que la délégation écossaise a été surprise de voir comment le document "présentait plusieurs fois l'étiquetage ou la caractérisation de divers groupes dans une seule phrase". "Nous ne sommes pas du tout opposés à cette inclusion, mais nous pensons qu'elle pourrait être traitée de manière plus sensible", a-t-il déclaré.
L'archevêque Eamon Martin a déclaré que "nous étions un peu gênés" parce que "la voix des pauvres" n'était pas plus importante dans le document, malgré les contributions pendant l'assemblée de Caritas International et d'autres organisations caritatives catholiques. "J'aimerais simplement que le cri des pauvres, le cri de la Terre et le cri de la paix soient un peu plus mis en avant", a-t-il déclaré.
L'évêque Aliaksandr Yasheuskiy, auxiliaire de Minsk, en Biélorussie, a recommandé que le texte soit clarifié pour noter que les commentaires sur l'ordination des hommes mariés et l'ordination des femmes ne reflétaient pas l'opinion commune de l'assemblée.
Si la majorité des intervenants qui ont choisi de donner leur avis sur le texte étaient des évêques, plusieurs femmes se sont également adressées à l'assemblée. Anna Diouf, une jeune femme représentant l'Observatoire de l'intolérance et de la discrimination envers les chrétiens en Europe, a demandé comment le texte pouvait souligner le rôle important des femmes dans l'Église sans mentionner la Sainte Vierge Marie.
En raison des contraintes de temps, les délégués n'ont pas pu lire et réfléchir sur le document final avant d'entrer dans le débat. Au lieu de cela, le Père Jan Nowotnik a lu à haute voix le projet de document qui résume et synthétise les contributions offertes par les catholiques de tout le continent au cours des trois derniers jours.
La sécularisation, les abus cléricaux, les tensions autour de la liturgie et le dialogue œcuménique figurent parmi les nombreux thèmes mis en avant dans le projet de document encore non publié, qui cherche à fournir une perspective européenne sur une Église synodale.
Le texte mentionne que l'ordination des femmes au diaconat a été évoquée comme une possibilité lors de l'assemblée et ajoute : "D'autre part, il existe en Europe un net clivage sur l'ordination des femmes au sacerdoce, non seulement entre l'Est et l'Ouest, mais aussi au sein des différents pays occidentaux."
Le document mentionne également que de nombreux délégués européens ont exprimé leur crainte que le Synode sur la synodalité n'entraîne une "dilution" de la doctrine catholique. "Certains ont souligné que dans un processus comme celui-ci, il y avait un risque de se soumettre à l'esprit du monde. Ces craintes ont également été exprimées au cours de notre réunion, l'inquiétude concernant une éventuelle dilution de la doctrine ou l'utilisation d'expressions sociologiques dans les groupes de travail a été soulignée", indique le document.
Il n'y a pas eu de vote sur le texte final de la première moitié de l'assemblée. Les organisateurs de l'assemblée ont plutôt demandé si quelqu'un avait des objections à ce que le projet de texte soit rendu public. Le cardinal Jean-Claude Hollerich a assuré les délégués que leurs commentaires et suggestions lors du débat de la matinée seront pris en compte dans la formation du projet final.
À partir du 10 février, les évêques européens se réuniront en privé pendant trois jours à Prague pour la seconde moitié de l'assemblée afin de réviser collectivement le document, d'écouter les discours du président de la conférence épiscopale de chaque pays et de produire leur propre second document final pour le processus continental du synode.
L'assemblée de Prague est l'une des sept assemblées continentales du synode qui se tiendront à travers le monde en février et mars. Mgr Hollerich a indiqué que lui-même et le cardinal Mario Grech se rendront aux assemblées continentales de Beyrouth, Bangkok et Bogota, en Colombie, dans les semaines à venir.
Courtney Mares est correspondante à Rome pour la Catholic News Agency. Diplômée de l'Université de Harvard, elle a effectué des reportages dans des bureaux de presse sur trois continents et a reçu la bourse Gardner pour son travail avec les réfugiés nord-coréens.