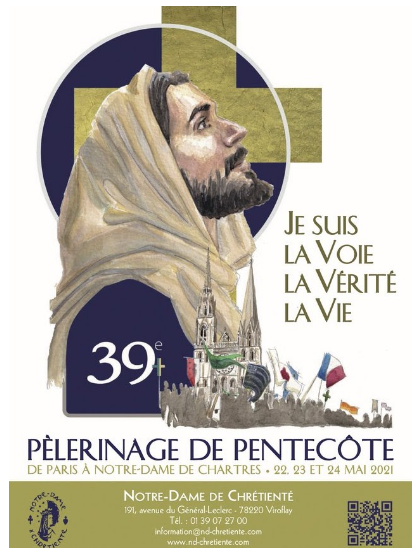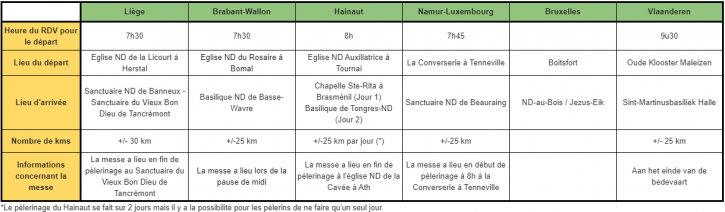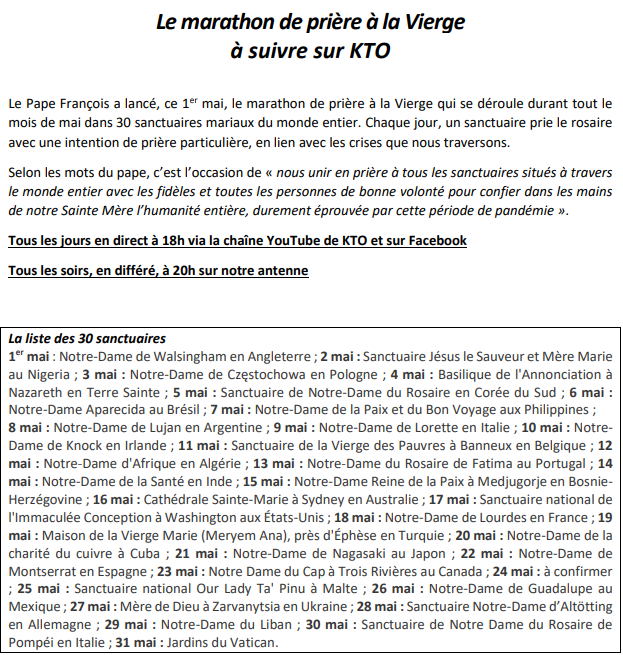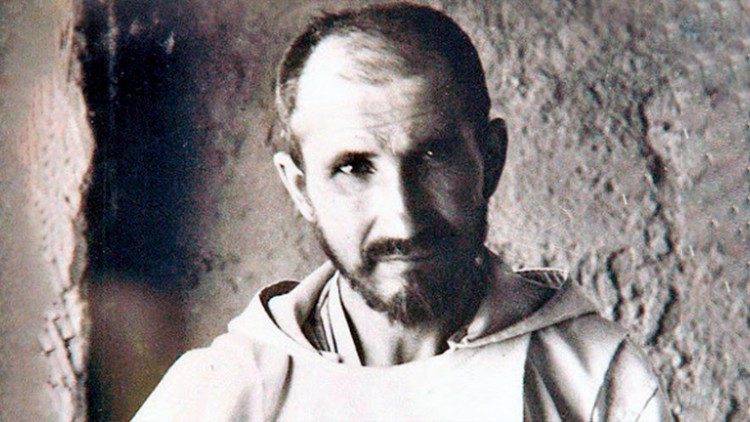Relayé par Thomas Oswald sur le site web « Aleteia » ce 8 mai 2021 :
 Mgr Paluku Sikuli Melchisédech, évêque du diocèse de Butembo-Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dénonce la faillite de son gouvernement face aux défis auxquels il est confronté. Des terroristes chassent de chez elles les populations autochtones, des trafiquants exploitent les ressources minières congolaises, sans être inquiétés. Entretien:
Mgr Paluku Sikuli Melchisédech, évêque du diocèse de Butembo-Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dénonce la faillite de son gouvernement face aux défis auxquels il est confronté. Des terroristes chassent de chez elles les populations autochtones, des trafiquants exploitent les ressources minières congolaises, sans être inquiétés. Entretien:
"Face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC), l’armée vient de prendre la responsabilité de deux provinces de l’est du pays, le Nord Kivu et l’Ituri, où les populations sont à la merci de groupes armés dont les ADF (Allied Democratic Forces), lié depuis 2019 à l’État islamique (EI). « Lors de mon intronisation comme évêque, il y a vingt ans, on parlait déjà de « balkanisation » de la région », dénonce Mgr Paluku Sikuli Melchisédech, évêque du diocèse de Butembo-Beni, dans l’est du pays. « Je constate que l’expression s’applique toujours avec la même violence ! »
Depuis le début du mois d’avril, une vague de manifestations, parfois violentes, secoue votre pays pour dénoncer l’insécurité. Quelle est votre position à l’égard de ces manifestants ?
Mgr Paluku Sikuli Melchisédech : On ne peut pas demander aux gens qu’on est en train de tuer comme des bêtes de se taire et ne rien faire. C’est leur droit de réclamer la sécurité, c’est leur droit de réclamer la liberté mais nous voulons simplement que cela soit fait dans le respect de la loi, dans la paix, pas dans la violence.
Il existe un projet de grande envergure pour islamiser ou chasser les populations autochtones.
Que dénoncent-ils exactement ?
L’absence d’efficacité de la mission de maintien de la paix de l’ONU. Mais plus largement, les conflits perpétuels, jamais réglés, qui perdurent dans l’est du pays. Lors de mon intronisation comme évêque, il y a 20 ans, on parlait déjà de « balkanisation » de la région. Je constate que l’expression s’applique toujours ! La Conférence épiscopale nationale congolaise calcule ainsi qu’il y a eu plus de 6.000 morts à Beni depuis 2013 et plus de 2.000 à Bunia pour la seule année 2020. On compte également au moins 3 millions de déplacés et environ 7.500 personnes kidnappées. Il existe un projet de grande envergure pour islamiser ou chasser les populations autochtones.
Pourquoi parlez-vous d’islamisation ? La principale organisation en cause, l’ADF, ne se revendique pas comme une organisation islamique…
Tous ceux qui ont été kidnappés par ces groupes terroristes et qui en sont sortis vivants rapportent la même histoire. Ils ont eu le choix entre la mort et la conversion à l’islam. On leur impose des noms musulmans, pour gommer leur identité. Par ailleurs, même les habitants du diocèse qui n’ont pas vécu cette expérience traumatisante peuvent constater que des mosquées poussent partout.
Qui les finance ?
En son temps, Mouammar Kadhafi se montrait très généreux pour bâtir ces mosquées. À présent, ce sont d’autres sources de financement qui permettent les constructions de ces lieux de culte.