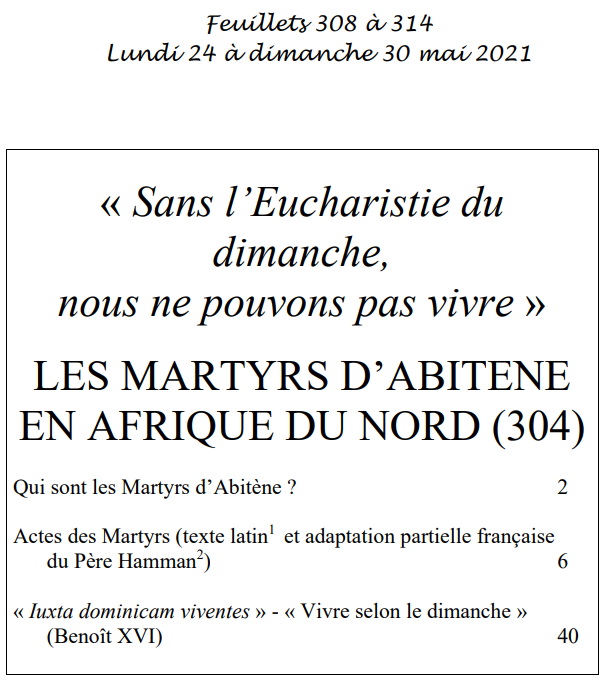Foi - Page 376
-
"Sans l'Eucharistie du dimanche, nous ne pouvons pas vivre" (Martyrs d'Abitène)
-
Le Liban peut-il se relever ?

Épuisé par ses divisions internes, la crise économique aggravée par la pandémie, la corruption endémique, le Liban, sans gouvernement, est à terre. Le cardinal Béchara Raï a proposé une solution. Une analyse d’Annie Laurent publiée sur le site web du mensuel « La Nef » :
« Depuis l’été 2020, le pape François manifeste une vive préoccupation pour l’avenir du Liban. La crise existentielle dans laquelle s’enfonce le pays du Cèdre, déclenchée en octobre 2019 (1), ne cesse de s’aggraver, menaçant même la survie de ce petit État du Levant auquel le Saint-Siège a, dès 1946, trois ans après son indépendance, reconnu une vocation unique, ce qui inspirera à saint Jean-Paul II la formule de « pays-message » (2).
Parmi les diverses interventions du Souverain Pontife, celle du 9 février dernier est significative par le choix de sa date et par son contenu. Publiée à l’occasion de la fête de saint Maron, patron de l’Église maronite, la plus nombreuse au sein de la chrétienté locale et la plus influente puisque c’est à l’un de ses patriarches, Élias Hoayek (1843-1931), dont le procès en béatification est en cours, que les Libanais doivent la création de leur État en 1920, raison pour laquelle le 9 février est une fête nationale chômée.
Dans son message, le pape a insisté sur le rôle et la responsabilité des chrétiens. « Il est plus que jamais nécessaire que le pays garde son identité unique, pour assurer l’existence d’un Moyen-Orient pluriel, tolérant et divers, où la présence chrétienne peut offrir sa contribution et n’est pas réduite à une minorité qu’il faut protéger. » Affirmant que « les chrétiens constituent le tissu conjonctif historique et social du Liban et, à travers les multiples œuvres éducatives, sanitaires et caritatives, la possibilité de continuer à œuvrer pour le bien du pays, dont ils ont été les fondateurs, doit leur être assurée ». Or, a-t-il ajouté, « affaiblir la communauté chrétienne risque de détruire l’équilibre interne du Liban et la réalité libanaise elle-même » (3).
Le Saint-Père a également demandé à ce que la présence des réfugiés, syriens et palestiniens, majoritairement musulmans, soit abordée dans cette optique. Les premiers, qui ont quitté leur pays en guerre depuis 2011, sont au nombre d’un million et demi ; les seconds, environ 400 000, sont les descendants de ceux qui avaient été chassés de Palestine lors de la création de l’État d’Israël en 1948. C’est donc une charge bien lourde que supportent les cinq millions de Libanais dont le territoire est à peine plus étendu que la Gironde. François a aussi émis la crainte qu’« en l’absence d’un processus urgent de reprise économique et de reconstruction, on risque la faillite du pays, avec la conséquence possible de dangereuses dérives fondamentalistes ». Appelant tous les responsables politiques et religieux libanais à renoncer à leurs intérêts particuliers, il les a engagés « à poursuivre la justice et à mettre en œuvre de vraies réformes pour le bien des citoyens, en agissant de manière transparente ». Il a enfin plaidé pour un engagement politique international aux côtés du Liban (4), pays où il se sait attendu et où il espère se rendre, comme il l’a confié début mars à son retour d’Irak.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Ethique, Foi, Histoire, International, Islam, Justice, Patrimoine religieux, Politique, Religions, Société 0 commentaire -
Mgr Rey : « Le grand témoignage que le christianisme peut apporter au monde, c’est celui de l’espérance »

L’évêque de Toulon-Fréjus, Monseigneur Dominique Rey, a célébré lundi dernier la messe de clôture du pèlerinage traditionnel de Pentecôte Paris-Chartes, organisé par l’association Notre-Dame de Chrétienté. Le site web « Boulevard Voltaire » publie l’interview du prélat recueillie dans ce contexte par Iris Bridier :
 « Monseigneur, vous célébrez la messe de clôture du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté lundi. Quel message adresserez-vous aux pèlerins qui auront marché ce week-end de Pentecôte ?
« Monseigneur, vous célébrez la messe de clôture du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté lundi. Quel message adresserez-vous aux pèlerins qui auront marché ce week-end de Pentecôte ?En considérant cette magnifique flèche de la cathédrale de Chartres qui se dégage à l’horizon et qui entraîne le pèlerin marchant sur les routes poudreuses, cette flèche qui lui désigne le Ciel, je dirai que le grand témoignage que le christianisme peut apporter au monde, c’est celui de l’espérance. Dieu ne nous abandonne pas. Comme le disait Gustave Thibon, « pour n’espérer qu’en Dieu seul, il faut avoir désespéré de tout ce qui n’est pas Dieu ».
Notre société traverse de nombreuses crises entraînant des inquiétudes pour l’avenir. Comment garder la confiance dans un monde où la violence, l’insécurité, le chômage, la peur du virus, les privations de liberté viennent troubler notre paix ?
« L’espérance est un désespoir surmonté », écrivait Bernanos. Ces moments anxiogènes de culture hygiénique sont l’occasion de prendre de la hauteur, de rapporter tout cela à Dieu pour essayer de trouver un sens dans ce qui n’en a pas beaucoup aux yeux de nos contemporains. Comment cette crise, avec cette question de la mort et de la fragilité qui nous éclatent en pleine figure, nous amène à du réalisme et de l’humilité. C’est toute la question de l’espérance chrétienne qui est en jeu. Nous avançons vers Dieu quand nous sommes mis à terre. Cette crise que nous traversons est une opportunité de revenir à des essentiels. Le christianisme est né de la mort, il est sorti d’un tombeau. Le christianisme a changé le tombeau en berceau. Dans un monde qui manque d’horizon, le christianisme, en nous ramenant à l’essentiel, nous offre une perspective.
La France, fille aînée de l’Église, est en proie à un double phénomène de déchristianisation et de montée de la radicalisation. L’islam, une menace ou un défi ?
C’est d’abord un défi et cela peut devenir une menace. Un défi parce que géographiquement, sociologiquement, démographiquement, une réalité s’impose à nous incontestablement. Comment se frayer un chemin entre un relativisme et un fondamentalisme qui soumet Dieu à une image de violence ? C’est sur cette ligne de crête que se situe le témoignage chrétien, qui est pour nous un défi et une crainte si on ne prend pas l’exacte mesure de notre identité chrétienne et de notre mission de pouvoir témoigner à travers l’annonce et le dialogue.
Certaines voix politiques s’élèvent pour reléguer le religieux dans la sphère privée pour lutter contre le séparatisme. Que pensez-vous de cette conception de la laïcité ?
C’est une très mauvaise réponse car le religieux a une dimension publique. Être chrétien, ce n’est pas simplement dire sa prière ou faire son examen de conscience en privé. On veut soumettre le christianisme à l’individualisme ambiant. Le christianisme fait partie de la conscience personnelle, de l’intime de l’âme, mais il implique une relation à l’autre et il s’exprime, c’est sa vocation. Ce serait renier le christianisme que de le reléguer à la conscience individuelle. Ce serait l’amputer de son expressivité et, donc, de cette dimension de mission. Dans notre patrimoine, le grand nombre d’églises est une manifestation de cette foi dans la pierre. Il ne faut pas oublier que l’ADN du christianisme, c’est d’aller dans toutes les nations faire des disciples. »
JPSC
-
Allemagne : bénédictions et blasphème
Du cardinal Gerhard Ludwig Müller sur First Things :
BÉNÉDICTION ET BLASPHÈME
24 mai 21
Le 10 mai, plus de cent prêtres catholiques de toute l'Allemagne ont procédé à la bénédiction d'unions entre personnes de même sexe. Il s'agissait d'une réponse à une déclaration de février de la Congrégation pour la doctrine de la foi réaffirmant que l'Église ne pouvait pas bénir de telles unions. Cette mise en scène de pseudo-bénédictions de couples d'hommes ou de femmes homosexuellement actifs est, théologiquement parlant, un blasphème - une contradiction cynique de la sainteté de Dieu. Saint Paul écrivait à l'église de Thessalonique que Dieu ne veut rien d'autre que "votre sanctification : que vous vous absteniez de toute impudicité ; que chacun de vous sache prendre une femme pour lui dans la sainteté et l'honneur, et non dans la passion du désir, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu" (1 Thess. 4, 3-5).
Le lieu légitime et sacré de l'union corporelle de l'homme et de la femme est le mariage naturel ou sacramentel du mari et de la femme. Toute activité sexuelle librement choisie en dehors du mariage est une grave violation de la sainte volonté de Dieu (Héb. 13:4). Le péché contre la chasteté est encore plus grand si le corps d'une personne du même sexe est instrumentalisé pour stimuler le désir sexuel. "Tout autre péché que l'homme commet est extérieur au corps ; mais l'homme immoral pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?" (1 Cor. 6:18).
Les péchés graves contre les dix commandements, qui sont résumés dans le commandement d'aimer Dieu et son prochain, entraînent la perte de la grâce sanctifiante et de la vie éternelle tant que nous ne nous repentons pas de ces péchés dans notre cœur, que nous ne les confessons pas à un prêtre et que nous ne recevons pas l'absolution qui nous réconcilie avec Dieu et l'Église. "Ne vous y trompez pas ! Ni les immoraux, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les pervers sexuels, ni les ivrognes, ni les blasphémateurs, ni les voleurs n'hériteront du Royaume de Dieu" (1 Cor. 6:9).
Dans la Bible, la bénédiction de Dieu est mentionnée pour la première fois lorsque l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. L'institution du mariage participe à la vérité selon laquelle notre création en tant que "mâle et femelle" (Gn 1,27) exprime la bonté essentielle de Dieu. Lorsqu'un homme et une femme y consentent librement et deviennent dans le mariage "une seule chair" (Gn 2,24 ; Mt 19,5), la promesse que Dieu a faite dès le début s'applique à eux : Dieu les bénit, et Dieu leur dit : "Soyez féconds et multipliez". (Gen. 1:28).
Dieu a déterminé le nombre de personnes qui, par l'œuvre générative de leurs parents, naîtront dans cette vie et qui, en tant qu'individus uniques, sont destinés "dans l'amour, à lui appartenir par Jésus-Christ, selon le dessein de sa gracieuse volonté" (Eph. 1:5). Chaque individu engendré et chéri par un père et une mère est une révélation de la gloire de Dieu, ce qui montre que la différence créée entre les hommes et les femmes et leur communion dans le mariage sont des bénédictions pour eux, pour l'Église du Dieu trinitaire et pour toute l'humanité.
La bénédiction nuptiale du prêtre dans le rite catholique du mariage fait appel à la bonté révélée de Dieu et demande sa grâce secourable dans la prière d'intercession de l'Église (ex opere operantis). Elle communique également au couple la grâce sanctifiante du mariage à travers leurs vœux conjugaux (ex opere operato). C'est pourquoi le potentiel de vie corporelle et spirituelle de l'acte conjugal et son ouverture aux enfants, dans lesquels Dieu veut révéler sa gloire et son salut, n'est pas seulement bon en soi et exempt de péché, mais il est aussi un acte procréateur méritoire qui compte pour la vie éternelle (voir Thomas d'Aquin, Commentaire sur 1 Cor. 7, lectio 1 ; Summa Contra Gentiles IV, Cap. 78).
La bénédiction nuptiale est étroitement liée au mariage en tant qu'institution de la création et sacrement institué par le Christ. La bénédiction nuptiale est la puissante prière de l'Eglise pour les époux afin qu'ils participent au salut : que leur mariage puisse édifier l'Eglise et promouvoir le bien des époux, de leurs enfants et de la société (Lumen Gentium 11).
-
Chine : un évêque, sept prêtres et dix séminaristes arrêtés à Xinxiang
D'AsiaNews.it :
Xinxiang, un évêque, sept prêtres et dix séminaristes arrêtés
22 mai 2021
Mgr Zhang Weizhu a déjà été emprisonné à d'autres occasions. Un grand nombre de policiers ont fait irruption dans l'usine qui servait de séminaire et ont arrêté les étudiants et les professeurs.
Rome (AsiaNews) - En deux jours seulement, la quasi-totalité du personnel ecclésiastique de la préfecture apostolique de Xinxiang a été anéantie dans une opération menée par les forces de police de la province de Hebei. Le 21 mai, l'évêque Zhang Weizhu a été arrêté ; la veille, sept prêtres et dix séminaristes ont été arrêtés.
Le 20 mai, en début d'après-midi, au moins 100 policiers des provinces de Cangzhou, Hejian et Shaheqiao ont encerclé le bâtiment servant de séminaire diocésain à Shaheqiao (Hebei). On y utilisait en fait une petite usine appartenant à un catholique de Hebei comme séminaire. La police a fait irruption dans le bâtiment et a arrêté quatre prêtres, des enseignants du séminaire et trois autres prêtres qui font du travail pastoral. Dix séminaristes qui suivaient des cours dans l'usine ont été arrêtés en même temps qu'eux.
Conformément aux directives du nouveau règlement sur les activités religieuses, l'usine a été fermée et le directeur de l'entreprise a été arrêté.
La préfecture apostolique du Xinxiang n'est pas reconnue par le gouvernement chinois. Pour cette raison, toutes les activités des prêtres, des séminaristes et des fidèles sont considérées comme "illégales" et "criminelles".
Après le raid, les policiers ont saisi tous les effets personnels des prêtres et des séminaristes.
Compte tenu de l'important déploiement des forces de police, on pense que le raid était prévu depuis un certain temps. Les autorités civiles pensent que d'autres séminaristes ont réussi à s'échapper et sont à leur recherche dans les environs.
La sécurité publique et la police vont de maison en maison à leur recherche. S'ils trouvent des signes de la foi catholique (croix, statues, images saintes, photos du pape, etc.), les propriétaires sont condamnés à une amende et les objets sont confisqués et détruits.
Selon de nombreux observateurs, depuis la signature de l'accord provisoire entre la Chine et le Saint-Siège, les persécutions à l'encontre des catholiques - surtout celles qui ne sont pas officielles - ont augmenté. L'accord ne concerne que la nomination des nouveaux évêques, mais il partait du principe que le reste de la situation de l'Église resterait en suspens, en attendant que les problèmes soient résolus par le dialogue entre les deux parties. Au lieu de cela, la police a assigné des évêques à résidence, imposé des amendes très élevées aux fidèles, jeté les curés hors des églises, arrêté des prêtres et des séminaristes. Pour de nombreux fidèles, "l'accord a été trahi".
-
L'Eglise à la sauce synodale
De Stefano Fontana sur la Nuova Bussola Quotidiana (traduction de Benoît et moi) :
Un calvaire synodal pour l’Eglise
Une nouveau long calvaire synodal nous attend. Trois années synodales : d’abord les synodes nationaux, puis les synodes continentaux et enfin le synode universel, le tout d’ici à 2023. Cette nouvelle Église démocratique est déjà là : nous l’avons vue à l’œuvre lors des derniers synodes. Mais c’est une démocratie imposée par la force et la tromperie, une démocratie pilotée depuis le centre. Ce sera une « démocratie totalitaire ». Après le calvaire de la » mère » de tous les synodes, c’est-à-dire le (double) synode sur la famille en 2014 et 2015, la synodalité se gonfle sur elle-même et recouvre toute l’Église sans laisser d’échappatoire. Elle la recouvre non seulement en tant que méthode (si seulement elle n’était qu’une méthode de travail, certes improductive, mais tout de même une méthode), mais aussi en tant que substance et contenu.
La synodalité – dit-on – est un chemin, elle est être en chemin, c’est le chemin en tant qu’être, ainsi l’Église synodale n’est pas en chemin mais elle est son propre chemin, elle est sa propre marche. C’est ainsi que de la synodalité naîtra la nouvelle Église, non plus une Église en chemin comme Église, mais une Église qui coïncide avec son propre chemin. En réalité, cette nouvelle Église est peut-être déjà là, dans le projet de ce nouveau calvaire synodal. Une Église en-chemin est une Église qui oriente son propre chemin à partir de sa propre essence et de son propre but, une Église qui est son propre chemin est une Église qui se réduit à son propre devenir, une Église qui devient temps, donc dans l’impossibilité de le racheter et de le sauver.
Il y a quelques années, le théologien Giacomo Canobbio a écrit que, de même que l’Église s’est autrefois inspirée de la monarchie pour sa constitution interne, elle devrait maintenant s’inspirer de la démocratie. Il n’y aurait aucun scandale – disait-il – si cela se produisait, car il s’agirait toujours, dans les deux cas, d’exemples politiques fournis par l’histoire.
Nous savons bien que ce n’est pas l’Église qui s’est inspirée de la royauté politique, mais le contraire, et cela aussi pour les versions progressivement frelatées de la monarchie qui – comme l’enseignent [Carl] Schmitt et d’autres – sont des imitations sécularisées du pouvoir divin. Malgré cela, on ne peut nier que l’Église d’aujourd’hui se veut démocratique et que la synodalité est la substance d’une Église démocratique.
Certes, c’est une démocratie imposée par la force et la tromperie, c’est une démocratie pilotée depuis le centre, c’est une « démocratie totalitaire », mais sur le fond, c’est une démocratie. Je me souviens que lorsque le synode du diocèse de Bolzano-Bressanone (2013-2015, ndt) a conclu ses travaux par des déclarations sans conteste hétérodoxes, contraires au dépôt de la foi et déviantes de la morale naturelle et catholique, l’évêque n’a pas dit un mot: qui suis-je pour m’opposer à un synode?
C’était une démocratie programmée, parce que l’évêque connaissait déjà ce résultat lorsqu’il a convoqué le synode et a convoqué le synode pour avoir ce résultat. C’est une démocratie imposée avec les motivations désormais habituelles de fidélité aux « signes des temps », de « docilité à l’Esprit », de ne pas avoir peur de la nouveauté. Cependant, elle reste formellement une démocratie parce que l’Esprit parlerait précisément dans une Église démocratique, ou plutôt dans la nature démocratique de l’Église. -
Ce 24 mai, prions pour les chrétiens de Chine
De KTO :
Le 24 mai, prions pour les chrétiens de Chine
À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour l’Église de Chine, le 24 mai 2021, KTO vous propose une programmation spéciale pour prier et méditer pour les chrétiens chinois.
Instaurée par Benoît XVI en 2007, la Journée mondiale de prière pour la Chine invite l'Église universelle à prier pour les fidèles catholiques chinois le 24 mai. Cette date marque également la fête de Notre-Dame de Sheshan, patronne de la Chine, dont le sanctuaire se trouve près de Shanghai.
Le pontife avait alors écrit une prière à Notre Dame de Sheshan pour soutenir « l'engagement de ceux qui, en Chine, parmi leurs travaux quotidiens, continuent à croire, à espérer, à aimer, afin qu'ils ne craignent jamais de parler de Jésus au monde et du monde à Jésus ». À la Vierge, il avait demandé d'aider « les catholiques à être toujours des témoins crédibles de l'amour, en restant unis au rocher de Pierre sur lequel l'Eglise est bâtie ».
À 20h50, KTO diffuse un documentaire exceptionnel sur les sœurs de l'ombre, ces ordres religieux féminins présents en Chine, qui ont apporté une aide très concrète aux malades, aux pauvres, aux enfants abandonnés, et aux réfugiés souvent au péril de leur vie.
Sœurs de l'ombre, une coproduction KTO/Saison Cinq, réalisé par Sébastien Cassen.
Le pape François porte une attention particulière à l'Église de Chine depuis le début de son pontificat. Après 70 ans de rupture et de tensions, la Chine et le Vatican ont signé en septembre 2018 un accord provisoire autorisant le Pape à nommer des évêques en concertation avec le Parti communiste chinois. « Il ne s'agit pas de nommer des fonctionnaires pour la gestion des questions religieuses, mais d'avoir des Pasteurs authentiques selon le cœur de Jésus, engagés à travailler généreusement au service du Peuple de Dieu », a écrit le Saint-Père dans son message aux catholiques chinois et à l'Église universelle, après la signature de l'accord.
Pour célébrer cette journée, KTO donne la parole à des témoins du Christ dans l’Empire du Milieu.
Des témoins du Christ en ChineL'artiste chinois Yin Xin, témoigne de son parcours et de son espérance pour la Chine, à travers la place qu'il donne au Christ dans ses oeuvres.
Père Charbonnier : « Que l'amour fraternel entre les catholiques de Chine redevienne un témoignage
Le père Jean Charbonnier, prêtre des Missions Étrangères de Paris, nous confie son expérience de l'Eglise en Chine en tant que missionnaire et son espérance pour les catholiques chinois.
Père Lepeu : « Je suis émerveillé par la créativité des jeunes qui travaillent l'Église »
Le Père Bruno Le Peu, prêtre des Missions Étrangères de Paris, coordinateur du service Chine des Missions Étrangères de Paris, nous confie son regard plein d'espérance pour l'Eglise de Chine face aux défis qu'elle doit relever.
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Médias, Solidarité, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
"Comme des coeurs brûlants" : un livre très intime et bouleversant
De Jérôme Cordelier sur le site du Point :
Le feu sacré d’Alexia Vidot

Dans un livre très intime et bouleversant, la journaliste raconte sa conversion au catholicisme à l’âge de 20 ans. À contre-courant ?
Avons-nous perdu le sens du sacré ? C'est l'antienne actuellement répétée – avec succès – par des essayistes de choc aujourd'hui classés à droite, voire à l'extrême droite, Sonia Mabrouk, Jean-Marie Rouart, Philippe de Villiers, Patrick Buisson. Déplorant l'affaissement de notre société, voire de notre civilisation, par l'effacement des héritages et des signes chrétiens, leurs écrits caracolent dans les listes de best-sellers, agitent le débat d'idées, suscitent l'opprobre des plus terre à terre qui bornent ces saillies politiques à des exaltations spirituelles et des manifestations identitaires.
Aux nostalgiques des temps anciens de la domination catholique comme à leurs contempteurs sceptiques, voire franchement antagonistes, on ne peut que recommander d'empoigner le livre d'Alexia Vidot Comme des cœurs brûlants (Artège). Vous croyez que le christianisme serait un exercice suranné, embaumant l'encaustique et l'encens, se pratiquant dans des églises-refuges hors le monde ? Que cette religion bimillénaire, qui a façonné la France mais subit depuis plusieurs décennies un déclin vertigineux, se cantonnerait désormais à des visées de restauration d'un ordre ancien, apanage de militants d'un repli passé ante-Vatican II ? Ou, a contrario, que la foi serait une affaire d'esprits tièdes qui se tiennent en retrait de la vraie vie ? Voici un témoignage ardent, bouleversant, et qui constitue un formidable antidote à nos désespérances postmodernes.
Alexia Vidot a une trentaine d'années. Journaliste à l'hebdomadaire chrétien La Vie, elle est engagée au milieu de son époque, et elle écrit avec feu, portée par l'élan d'une foi sincère qui lui est tombée dessus sans crier gare. Dans cet ouvrage, elle dresse le portrait de grands convertis au christianisme, de toutes les époques, mais surtout elle témoigne sans fard de sa propre rencontre. À l'époque de l'exhibition sur Instagram et de la mise sur la place publique de secrets intimes sordides, quel joli contrepoint !
« À 20 ans, écrit Alexia Vidot, j'étais le parfait enfant de mon siècle, pur produit de l'esprit mondain, de la modernité. J'étais donc extrêmement jalouse de ce que je pensais être ma liberté, jusqu'à me rebeller à la moindre atteinte, voire menace. Je me voulais autonome, indépendante, libérée de tout déterminisme et de tout lien, y compris celui de la nature, seul maître et seigneur à bord de mon existence. Et je pensais que mon bien-être résidait uniquement dans l'affirmation et l'épanouissement de mon petit moi émancipé – un moi absolu, qui ne dépendrait de rien ni de personne. »
Lien permanent Catégories : Culture, Eglise, Foi, Livres - Publications, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
« Synodalité »: le pape François lance une nouvelle usine à gaz ?
Non, il ne s’agira pas de singer l’esprit de l’actuel synode des évêques allemands mais d’ élargir la représentativité du synode romain, instance consultative du gouvernement pontifical composée d’évêques du monde entier, synode dont la création par le pape Paul VI remonte à 1965 . Lu sur le site de « Vatican News » cet article de Salvatore Cernuzio (Cité du Vatican ») :
« Tout partira des Églises locales. Les 9 et 10 octobre, une cérémonie solennelle en présence du Pape donnera le coup d’envoi d’un itinéraire de trois ans, divisé en trois phases (diocésaine, continentale, universelle), fait de consultations et de discernement, qui culminera avec l'assemblée initialement prévue en 2022, qui sera finalement organisée en octobre 2023 à Rome.
«Chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l'Esprit-Saint». Pour rendre concrète et visible cette synodalité souhaitée par François depuis le début de son pontificat, le prochain synode des évêques, prévu pour octobre 2023, ne sera pas célébré uniquement au Vatican mais dans chaque Église particulière des cinq continents, suivant un itinéraire de trois ans, divisé en trois phases : diocésaine, continentale, universelle.
Un processus synodal intégral
L'itinéraire synodal, approuvé par le Pape, est annoncé dans un document de la Secrétairerie générale du synode qui affirme : «Un processus synodal intégral ne se réalisera de manière authentique que si les Eglises particulières y sont impliquées. Une participation authentique des Églises particulières ne peut être réalisée que si les corps intermédiaires de la synodalité, c'est-à-dire les synodes des Églises orientales catholiques, les Conseils et Assemblées des Églises sui iuris et les conférences épiscopales, avec leurs expressions nationales, régionales et continentales, y prennent également part».
Pour la première fois, un synode décentralisé
C'est la première fois dans l'histoire de cette institution créée par Paul VI pour poursuivre l'expérience collégiale du Concile Vatican II qu'un synode «décentralisé» est célébré. Précisément lors de la cérémonie de commémoration du 50e anniversaire de l'institution du synode, en octobre 2015, le Pape François avait exprimé son désir d'un parcours commun «laïcs, pasteurs, évêque de Rome».
-
Liège : enregistrée et diffusée depuis l’église du Saint-Sacrement en direct ce matin du dimanche 23 mai 2021 à 10h, la messe traditionnelle (missel de 1962) de la Pentecôte :
Célébrant : Abbé M.-A Dor, Recteur
Chants grégoriens (L. Schyns, G. Lahaye) : aspersion d’eau bénite « Vidi aquam », propre de la messe « Spiritus Domini », Kyriale de la messe I (Xe s.), credo I (XIe s.), Hymne « Veni Creator » (IXe s.)
Orgue : Patrick Wilwerth
Pour suivre la messe, cliquez ici : https://youtu.be/SXtlSyT1a8M
La messe de la fête de la pentecôte
 La Pentecôte (d’un mot grec qui veut dire le cinquantième jour) est l’octave double et jubilaire de la fête de Pâques (7 X 7 + 1). C’est en même temps le second point culminant du cycle festif de Pâques. A Pâques, le Christ, le divin Soleil, s’est levé ; à la Pentecôte, il est à son zénith, il chauffe, mûrit et apporte la vie.
La Pentecôte (d’un mot grec qui veut dire le cinquantième jour) est l’octave double et jubilaire de la fête de Pâques (7 X 7 + 1). C’est en même temps le second point culminant du cycle festif de Pâques. A Pâques, le Christ, le divin Soleil, s’est levé ; à la Pentecôte, il est à son zénith, il chauffe, mûrit et apporte la vie. -
"Ce pays des hommes sans Dieu " sur Canal Académie
Bien sûr, c'est français. Mais outre le fait que ce qui se passe dans l'Hexagone nous intéresse évidemment, nous n'aurons aucune peine à adapter cet éclairage aux réalités de notre pays.
De Canal Académie :
Ce pays des hommes sans Dieu
Avec Jean-Marie Rouart, de l’Académie française
“Nous avons pris l’habitude en France de nier l’existence du fait religieux, de le regarder d’un œil tantôt indifférent, comme le vestige d’une arriération sinon mentale, du moins philosophique.” Dans son dernier essai, Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, s’interroge sur les causes de l’affaiblissement du catholicisme dans notre pays. Il s’inquiète des conséquences culturelles de cet abandon, dans le contexte d’un essor concomitant de l’islam.
Pour écouter cet entretien : https://www.canalacademie.com/ida12559-Ce-pays-des-hommes-sans-Dieu.html
Date de mise en ligne : 21 mai 2021
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Foi, Islam, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -
L'inclassable Thibon
De Jacques de Guillebon sur le site de La Nef :
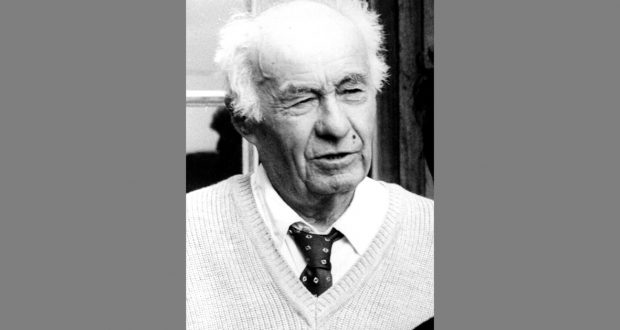 Gustave Thibon © DR
Gustave Thibon © DRThibon l’inclassable
Gustave Thibon (1903-2001) nous a quittés il y a déjà vingt ans. Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur cet immense philosophe, écrivain, poète, dont l’œuvre est plus actuelle que jamais.
C’est l’une des grandes figures du monde catholique français du XXe siècle, si grande que parfois ça l’en rend intimidant, mystérieux ou même presque incompréhensible : qui fut Gustave Thibon ? Bien malin qui saurait le résumer entièrement, certes comme aucun être n’est résumable dans aucune littérature, mais aussi que chez Thibon cette énigme ontologique se double de sa volonté d’irréductibilité à quelque statut que ce soit, et se triple même de ce que l’on ne dispose aujourd’hui d’aucune biographie complète et fouillée du philosophe-poète-penseur-paysan ardéchois, même si Raphaël Debailiac lui a consacré, il y a quelques années, un court, dense et bel essai (1).
Traversant presque entièrement le siècle de fer et de sang (1903-2001), le natif de Saint-Marcel d’Ardèche, quand bien même c’est d’un village perdu, ne vient pas entièrement de nulle part : sa famille y possédait de nombreuses terres et son père était un érudit. Aussi, si Thibon fut un autodidacte, c’est dans le sens où il ne suivit pas de cursus universitaire : mais son éducation familiale le mit très tôt, et pour jamais, au contact d’auteurs classiques, qu’ils fussent grecs, latins ou européens en général. Parti explorer le monde quelques années autour de la vingtaine, le jeune Thibon revint cependant rapidement sur la terre de ses pères, pour y vivre tel Ulysse n’ayant pas forcément conquis la toison le reste de son âge.
Lui dont on dit que sa mémoire lui permettait de se réciter quotidiennement des centaines de vers, devient tertiaire du Carmel et voue une particulière dévotion aux deux grands fondateurs, Thérèse d’Avila et Jean de la Croix. À partir des années 1930, il publie dans de nombreuses revues : Les Études carmélitaines en particulier, mais aussi Orientations, La Vie spirituelle, Civilisation. Maritain lui ouvre à son tour les colonnes de ses revues, puis c’est Gabriel Marcel qui édite son premier ouvrage, Diagnostics, en 1940.
Lire la suite sur le site de La Nef
Plusieurs nouveaux articles de La Nef ont été mis en ligne récemment, ainsi que d'autres, inédits, exclusivités internet. Vous pouvez les lire librement en cliquant sur le titre de l'article :
Faut-il commémorer Napoléon ?, par Patrice Gueniffey
Napoléon, fils des Lumières, entretien avec Xavier Martin
Napoléon : canevas pour un bilan, par Michel Toda
Thibon l’inclassable, par Jacques de Guillebon
Entre le chaos et le déclin : la renaissance, par Nicolas Kinosky
Le Liban peut-il se relever ?, par Annie Laurent
La « gueule » du progressisme, par Nicolas Kinosky
A l’origine des « fake news », par Pierre Mayrant
Revenir à Saint-Louis (à Strasbourg), par Nicolas KinoskyLien permanent Catégories : Culture, Eglise, Foi, Idées, Livres - Publications, Philosophie, Spiritualité 0 commentaire