Lu sur le site de Réinformation.tv (Anne Dolhein) :
Les fils et les gendres de M. Scalia ont transporté son cercueil recouvert du drapeau américain jusque dans la Basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington à l’occasion du service funèbre en l’honneur du magistrat décédé subitement à l’âge de 79 ans.
Devant des milliers de fidèles réunis dans la plus grande basilique des Etats-Unis, le Sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington – et des cardinaux, des évêques, des prêtres –l’abbé Paul Scalia a prononcé l’homélie à l’occasion des funérailles de son père, le juge Antonin Scalia, qui laisse un grand vide à la Cour suprême des Etats-Unis. Ce magnifique sermon a fait une très forte impression non seulement sur ceux qui assistèrent aux obsèques (mais non Barack Obama, fortement critiqué pour son absence) mais sur l’Amérique entière, puisque les images et le texte en ont été très largement diffusés.
A juste titre. L’abbé Scalia, empreint d’une sérénité surnaturelle, a su trouver des mots qui ont une portée pour chacun. Des mots sur la foi et les fins dernières, le vrai sens de la vie, la véritable espérance qui est la nôtre, sans paroles lénifiantes, sans fausse consolation, mais d’autant plus forts car appuyés sur l’insondable miséricorde de Dieu. Sans utiliser le terme, l’abbé Scalia a rappelé la réalité du purgatoire.
On peut voir une vidéo complète de l’homélie ici.
Comme le juge Scalia, habitué de la messe traditionnelle, l’abbé Scalia est connu pour son attachement à la dignité de la liturgie, et il est lui-même connu pour avoir célébré à l’occasion selon la forme extraordinaire du rite latin. Il est prêtre diocésain à Arlington, en Virginie.
En ce temps de carême, nous vous proposons ici le texte complet de cette homélie exemplaire, montrant que la foi et la sphère publique ne sont pas antinomiques, et que la grande affaire de chaque vie, c’est le salut. – A.D.

 La miséricorde n’est ni un vague sentiment de compassion à l’égard de la souffrance et de la misère des hommes, ni une fausse indulgence cherchant à faire table rase de l’injustice et du mal. La miséricorde est dans la volonté raisonnée et active de venir surmonter le mal physique et moral, d’imposer une limite au mal, le plus souvent en prenant sur soi, si possible, ce qui en est la cause, ou, à tout le moins, en écartant le mal, comme dans la parabole du Bon Samaritain. La miséricorde est, chez l’homme, la plus haute des vertus procédant de la charité ; elle est la clé de toutes les œuvres de Dieu.
La miséricorde n’est ni un vague sentiment de compassion à l’égard de la souffrance et de la misère des hommes, ni une fausse indulgence cherchant à faire table rase de l’injustice et du mal. La miséricorde est dans la volonté raisonnée et active de venir surmonter le mal physique et moral, d’imposer une limite au mal, le plus souvent en prenant sur soi, si possible, ce qui en est la cause, ou, à tout le moins, en écartant le mal, comme dans la parabole du Bon Samaritain. La miséricorde est, chez l’homme, la plus haute des vertus procédant de la charité ; elle est la clé de toutes les œuvres de Dieu.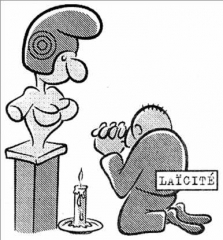 « Ce jeudi, au micro de
« Ce jeudi, au micro de 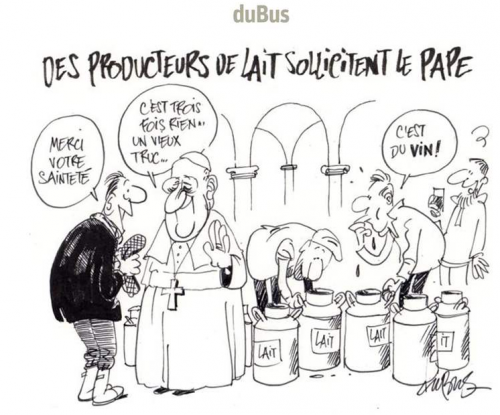 S
S