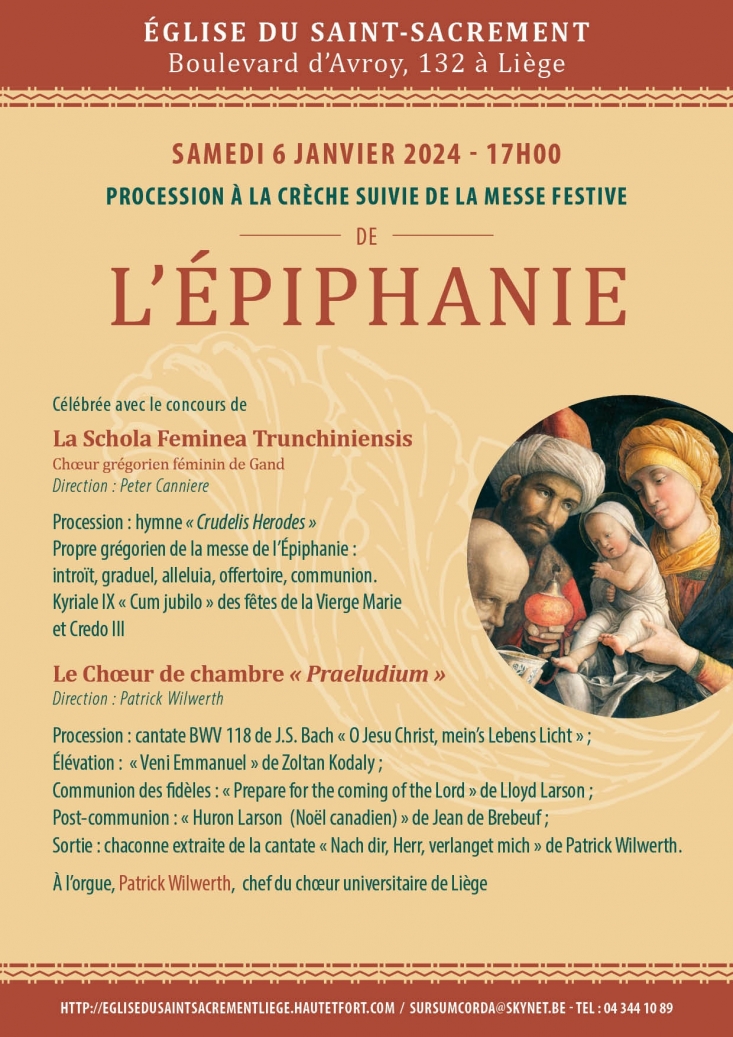On sait aujourd'hui que Fiducia supplicans est loin de faire l'unanimité et que le Vatican est amené à devoir expliquer et nuancer son propos de façon assez restrictive. Il était dès lors imprudent et prématuré d'applaudir le texte lors de sa sortie en l'interprétant de façon maximaliste comme le firent des porte-paroles de l'Eglise flamande.
De kerknet.be :
"Homosexualité & Foi" de l'Eglise catholique flamande voit dans la publication de 'Fiducia Supplicans' un "glissement de terrain"
22 décembre 2023
La possibilité de bénir les couples homosexuels témoigne d'un revirement dans le discours et la prise de parole de l'Église, selon le Point de contact "Homosexualité et Foi" (qui bénéficie de l'aval des évêques flamands).
Un 'Glissement de terrain' dans le discours et la pensée de l'Église
Dans le monde des fidèles lgbti+, la récente déclaration du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Fiducia Supplicans, est considérée comme un grand pas vers la reconnaissance des relations homosexuelles fidèles et durables. Vous êtes pleinement accepté en tant que personne lgbti+ et vous pouvez même désormais faire bénir votre relation.
Cela ouvre la porte à une église accueillante et hospitalière. L'Église est là pour tout le monde.
Para todos, todos, todos", a déclaré le pape François l'été dernier lors des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Il l'a répété à nouveau lors de la célébration d'ouverture du synode sur la synodalité sur la place Saint-Pierre à Rome, en italien : "Per tutti, tutti, tutti". Deux fois, ce furent des moments inoubliables et historiques pour ceux qui y ont assisté. Par deux fois donc, certains ont encore tenté de torpiller ou du moins de minimiser la portée de son discours. Il s'est avéré que c'était prématuré.
L'amour de Dieu et des autres êtres humains
Au cours de la première session du synode, les participants ont préconisé une approche pastorale pour ceux qui se sentent exclus par l'Église, par exemple en raison d'une situation (relationnelle) difficile pour l'Église. Il s'agit notamment des couples homosexuels et de la communauté lgbti+ au sens large. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu rencontrer des homosexuels fidèles et engagés dans l'Église au sein des points focaux "Homosexualité et foi" mis en place par l'Église flamande. Sans entrer dans les détails, il s'agit de conversations intenses et de rencontres chaleureuses qui ont toujours un point commun : un amour sans limite pour Dieu et pour les autres êtres humains. (!!!) Cet amour s'est également manifesté dans l'atmosphère chaleureuse et priante de la célébration œcuménique de la Pride d'Anvers et, récemment, de la messe arc-en-ciel à Merksem.
Option privilégiée pour la pratique pastorale
La déclaration diffusée lundi par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, gardien de la doctrine, représente donc une confirmation de l'approche pastorale des points de contact "Homosexualité et Foi" dans l'Église flamande de Belgique. Fiducia Supplicans est tout autant une conséquence de la préférence papale pour la pratique pastorale. La personne concrète prime toujours sur les règles générales et généralisantes.
Le document confirme ce que nous savons tous depuis longtemps : le droit canonique ne peut pas prévoir tous les cas.
Le discernement commun à travers la conscience formée était déjà privilégié dans l'enseignement social de l'Église. Le fait que la conscience formée prime désormais aussi en matière d'éthique sexuelle n'est ni plus ni moins qu'un glissement de terrain dans le discours et la pensée de l'Église. De plus, la déclaration de l'Église mondiale a un impact significatif sur la réflexion dans les pays où l'homosexualité est encore aujourd'hui criminalisée.
Pour ceux qui se sont demandés au cours des deux dernières années si l'enquête mondiale auprès des fidèles de l'Église catholique allait changer quelque chose, on peut d'ores et déjà considérer la déclaration de lundi comme un premier fruit de ce processus. Partout, il y a un désir de plus en plus enthousiaste d'une Église accueillante et ouverte. La vie vécue ne se laisse pas enfermer dans des règles immuables.
La vie et la mort
Ce n'est pas un hasard si, lors de sa réunion à Rome en octobre, le Synode des évêques a proposé de lancer des initiatives de discernement commun sur les questions sensibles. Le paragraphe sur ce point a été approuvé à une écrasante majorité - comme le reste du document, d'ailleurs. Les témoignages des participants au synode ont mis l'Église sur la voie. L'une des histoires qui a fait la une des médias internationaux est celle d'une jeune femme polonaise. Elle n'avait pas de relation mais s'était déclarée bisexuelle à un moment donné. Après une période d'éloignement de l'Église, elle a cherché à renouer avec elle pour faire l'expérience de la proximité et de la bénédiction de Dieu.
Le prêtre n'a pas voulu la confesser parce qu'elle était "désordonnée". Elle a été tellement choquée et désillusionnée qu'elle est passée d'une dépression à l'autre et a fini par s'éloigner de la vie. Une approche pastorale mesurée, comme le suggère la déclaration du Dicastère pour la doctrine de la foi, peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort pour certains, en particulier dans une situation extrêmement vulnérable comme celle de cette jeune femme.
Extrême droite
Ici et là, nous lisons des voix dissidentes sur les médias sociaux. Certaines tentent de semer la confusion par une lecture très sélective et légaliste de certains fragments de la Bible. D'autres, moins nombreuses, se font parfois entendre de manière grossière et bruyante. Ces appelants bruyants ont souvent des liens avec des groupes prêchant une idéologie d'extrême-droite de haine et de violence. De tels appels ne peuvent être condamnés que dans les termes les plus vifs. Même au nom de la liberté d'expression, il y a des limites.
Écouter et accompagner
À ceux qui ne sont pas d'accord, nous ne pouvons que réitérer l'appel au dialogue. Nous sommes prêts à discuter avec tous ceux qui se trouvent dans les points de contact. Si nous allons bien vers une Eglise d'écoute et d'accompagnement où chacun a sa place, cela vaut pour les couples homosexuels qui souhaitent une bénédiction, mais aussi pour ceux qui votent contre. Nous invitons donc cordialement tout le monde à une conversation ouverte, dans un "espace sûr" et de préférence aussi loin que possible de toutes les chambres d'écho des médias sociaux.
Contacts "Homosexualité et foi" de l'Église catholique flamande :
Willy Bombeek (coordinateur interdiocésain)
Werner Van Laer (Archidiocèse, Vicariat du Brabant flamand), Saskia van den Kieboom (Diocèse d'Anvers), Luc Boudens (Diocèse de Bruges), Tom Van Wambeke (Diocèse de Hasselt), Geert De Cubber (Diocèse de Gand)